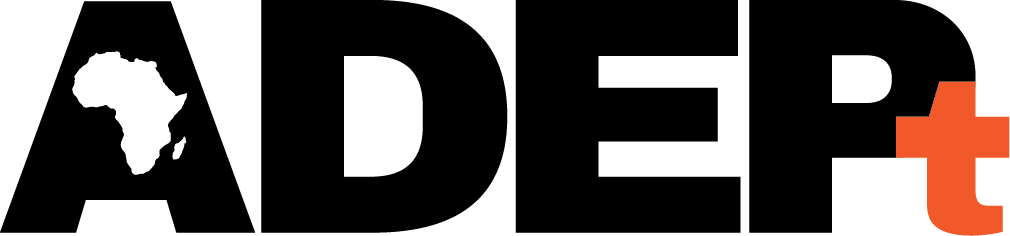INTERVIEWS
INTERVIEW DE KHADY SYLLA
ECRIVAINE ET CINEASTE SENEGALAISE
KDO: Nous sommes à Thiès et je vais faire un entretien avec Khady Sylla, réalisatrice et productrice de films documentaires. Assez brièvement elle va nous dire un peu son parcours. Je vais au fur et à mesure poser des questions sur la problématique de la production et de la distribution des documentaires ici, au Sénégal. Khady Sylla, est-ce que vous pouvez me parler de vos dernières œuvres, vos films documentaires?
KS: Bonjour je m’appelle Khady Sylla je suis écrivain et cinéaste. Mes trois derniers films sont des docu- mentaires « Une fenêtre Ouverte », « Le Monologue de la Muette » et « Ousseynou don’t Worry ». « Une Fenêtre Ouverte » je l’ai fait avec ARTE et France 2 « Le Monologue de la Muette » également. « Oussey- nou don’t Worry » est un film que j’ai produit avec mes propres moyens et ceux d’un ami qui m’a aidée. Sinon en dehors de ces trois films là, j’ai fait deux autres films, un petit court métrage de 26 min sur les jeunes filles de Dakar qui aurait pu en fait être un documentaire. Mais qui n’a pas pu être un documentaire car cela pose beaucoup de problèmes, surtout ici en Afrique. Les gens ne veulent pas forcément se mettre à nu devant une caméra. Ils n’ont pas l’habitude, ils se sentent un peu menacés par la caméra et j’en ai fait une fiction. « Colobane Express » aurait dû être un documentaire aussi, mais est devenu, en fin de compte, un documen- taire fiction pour les mêmes raisons.
KDO: Est-ce que les gens ont du mal à dire leur propre réalité?
KS: Voilà. C’est à dire, je pense que l’image n’a pas la même valeur en Afrique et en Europe. L’image est plus récente en Afrique, et si vous regardez les photog- raphies des premiers photographes africains les gens viennent très bien habillés, ils se montrent sous leur plus beau jour, se montrent sous leur plus belle face et posent devant le photographe comme s’ils posaient pour l’éternité. Donc quand vous voulez entrer dans leur intimité, montrer des côtés qui ne sont pas forcé- ment valorisants, ils se méfient. Et c’est très difficile de trouver des personnages pour des documentaires et de leur faire comprendre ce qu’on veut faire.
KDO: Parlez-nous du dernier film que vous avez produit vous même.
KS: « Ousseynou don’t worry ». Disons que ce n’est pas vraiment moi qui l’ai auto-produit. On l’a auto-produit avec un ami qui s’appelle Mathieu Cupiard et qui est sur Dakar. C’était très difficile, on n’avait pas d’argent parce que c’est un film fait dans l’urgence. C’étaient des mécaniciens qui squattaient une maison abandonnée. Je sentais que, vu la manière dont ils vivaient dans la mai- son, ils allaient bientôt en sortir. Il fallait donc faire le film très vite. On n’avait pas le temps d’écrire des dos- siers de quarante pages pour chercher le financement pendant trois ans. Il fallait faire le film très vite, sur le moment, alors on a emprunté une caméra, voilà. On n’avait pratiquement pas de matériel son. On y est allé, on a fait ce qu’on a pu et en fin de compte, on a pas mal de rushes. Mais on a réussi à faire juste un montage de 20 min et là on est en train d’essayer de chercher des fonds pour pouvoir faire un montage plus long.
KDO: Est ce que vous pouvez nous expliquer comment s’est passé pour vous la distribution de l’ensemble de vos documentaires au niveau de la télévision, ici, au Sénégal?
KS: D’abord ce qui s’est passé, c’est que pendant de longues années la télévision n’a pas du tout été récep- tive à mes documentaires. Bon, la RTS passe quand même mes films. La RTS a passé trois de mes films. S’ils payaient les droits d’auteur ce serait un peu mieux, mais déjà ils ont passé les films. Les films ont pu être vu par le grand public. Ce que je peux vous dire aussi, c’est que la télévision a une importance primordiale actuellement en Afrique car la plupart des gens pas- sent leur journée devant la télévision à regarder des telenovelas. Mais il faut absolument que nos télévisions comprennent qu’elles doivent diffuser des programmes nationaux, parce que sinon l’acculturation va continuer. Un enfant qui grandit en voyant comme exemple en face de lui des Japonais, des Hindoues – parce que les séries hindoues sont très à la mode – des Latino-Américains et d’autres nationalités, se construit dif- ficilement une identité. Si vous voulez, les valeurs qui sont nos valeurs traditionnelles, sont perdues aussi à cause de ça. Je pense que s’il y a autant de violence à Dakar et dans certains endroits de ce pays, c’est juste- ment parce que les gens sont acculturés. Ils ont perdu toutes les anciennes valeurs que nos parents – je parle des gens de notre génération – avaient réussi à nous transmettre. Les jeunes de maintenant ont perdu toutes ces valeurs. Ils ne sont que dans la violence, dans l’argent, ils sont perdus. Moi j’ai pitié d’eux, et en fait, c’est terrible parce que c’est la jeunesse, l’avenir de ce pays. C’est extrêmement important que les télévisions nationales puissent montrer des programmes africains. Ma sœur Mariama d’ailleurs a travaillé à TFM pendant quelques mois. La sœur avec qui je travaille – c’est elle qui produit mes films – est aussi réalisatrice. Elle avait initié un programme pour montrer des films africains et je crois que l’exemple a été repris après par plusieurs télévisions, mais il y a encore beaucoup à faire.
KDO: Du fait que les télévisions nationales diffusent très peu de documentaires africains et qu’il n’y a plus de salles de cinéma, comment peut-on faire pour récupérer une audience dans la jeunesse ? Est ce qu’il faut aller à la rencontre des jeunes dans des lieux publics, organiser des projections de films sur des places ou dans des stades, ou dans les écoles?
KS: Moi je pense qu’il y a plusieurs solutions. Il y a déjà le passage des films à la télévision. Si possible la deux- ième chose, c’est effectivement de faire des projections de films dans les lieux publics. Moi j’ai fait par exemple une projection de « Colobane Express », mon film sur les cars rapides, sur une place à Colobane et c’était ex- traordinaire parce qu’il y avait plein d’enfants. Ce sont les enfants qui ont posé le plus de questions à la fin de la projection et c’était magnifique. Il faut absolument aller à la rencontre des gens, créer des cinéclubs dans les quartiers parce que les cinéclubs peuvent être un moyen de relancer aussi le cinéma. Faire le maximum de projections dans le maximum d’endroits possibles dans tous les endroits où vont les jeunes. Dans leurs associa- tions, les ASC. Il faut aller faire des projections dans les ASC. Moi de toute manière je suis en train actuel- lement d’essayer de trouver des moyens de pouvoir faire le maximum de projections dans les quartiers pour que les jeunes puisent voir les films. Discuter avec les réal- isateurs, apprendre des choses, réfléchir. Je pense que ce qui est bien dans le cinéma documentaire c’est qu’il parle de nos réalités, il parle de nos problèmes, il parle de nos difficultés, il parle de nos bonheurs, de nos joies. Il parle de tout, il parle de nous, de ce que nous som- mes dans ce 21ème siècle. Je pense que voir des films documentaires c’est essentiel pour que cette jeunesse là prenne conscience de beaucoup de choses.
KDO: Notamment de son identité, parce que être con- fronté aux problèmes de la société du Mexique ou de l’Inde, c’est très intéressant, mais effectivement, si c’est le seul modèle, on a du mal à se construire. Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant des difficultés que vous rencontrez en terme de production, de coproduction avec les chaînes de télévision locales, et quelles sont les aides dont vous avez pu bénéficier ici en tant que réalisatrice de documentaires au Sénégal pour vos projets?
KS: Les télévisions locales refusent de produire des films alors que normalement selon la loi, je crois que 10% des programmes des télévisions doivent être produits localement. Cette loi n’est pas respectée – et je pense même que c’est plus de 10% – je ne con- nais pas bien les chiffres, c’est ma sœur qui s’y con- naît mieux en chiffres que moi. Donc ces télévisions sont obligées par la loi de produire des programmes nationaux. L’Etat ne met rien dans la production. Moi je n’ai jamais rien reçu pour aucun de mes films de mon pays, à part peut être pour Colobane Express où je crois que la RTS m’a prêté deux ou trois lumières ou quelque chose comme ça. Je n’ai jamais rien reçu en matière pécuniaire, je n’ai jamais reçu un franc de ce pays, ni d’une télévision, ni de l’Etat, ni d’un privé, ni de personne.
KDO: C’est assez incroyable, vous voulez dire que tous les documentaires que vous avez réalisés, ont été réalisés uniquement avec l’aide financière de l’Europe, des systèmes de coproduction européen, de chaînes de télévision européennes?
KS: Oui, tous mes financements sont venus d’Europe. Je n’ai jamais rien reçu de l’Etat sénégalais pas un franc pour aucun de mes films, pas un seul franc!
KDO: Ça c’est incroyable, c’est ce qui explique aussi le fait qu’à partir du moment où l’Etat ne s’implique pas dans la coproduction d’un film, ce n’est pas étonnant de voir que ce film n’est pas diffusé! Parce que finalement, au fond, lorsqu’une télévision décide de diffuser un film documen- taire, il faut qu’il ait une part de responsabilité. Ça veut dire qu’il faut qu’il donne au moins 10% ou 20% en copro- duction pour pouvoir insérer le film dans la programmation.
KS: Vous me faites un peu rire parce que j’ai l’impression que vous venez d’une autre planète et que vous ne savez pas ce qui se passe ici! Idéalement c’est ce qu’il faudrait, mais je vous dis que même la RTS a passé plusieurs fois mes films sans jamais me payer un seul centime de mes droits d’auteur. Donc je ne rêve même pas!
KDO: Oui, mais ceci n’est pas logique parce que, à partir du moment où il y a un bureau des droits d’auteur ici au Sénégal je ne comprends pas que tous les réalisateurs de la place, et il y a un service de la cinématographie et vous n’arrivez pas en tant que réalisateur / producteur à faire basculer les choses au niveau des droits d’auteur? Je trouve ça absolument pas logique parce que tout le monde se plaint, tous les réalisateurs globalement se plaignent du fait que les droits cinématographiques ne sont pas payés. Mais par contre les droits musicaux fonctionnent, ça veut dire le système de la musique on arrive à reverser quand même des droits pas beaucoup mais un peu, alors que dans le cinéma, les droits ne sont pas versés!
KS: Je crois que le problème du cinéma, en fait, est as- sez profond, parce que je crois que c’est un problème aussi d’être ensemble. Je crois qu’on a beaucoup de difficultés entre cinéastes à travailler ensemble, et tant qu’on ne sera pas ensemble on ne pourra rien obtenir. Il faut qu’on dépasse les intérêts personnels. Ce n’est pas parce que toi, tu obtiens je ne sais pas combien d’argent de l’Etat, que tu fais avancer le cinéma. Par contre, si on arrive parce qu’il y a eu un budget par exemple qui a été voté par Abdoulaye Wade. Il y a un fonds de trois milliards (de francs CFA) normalement qui doit être consacré au cinéma. Ce fonds n’a jamais été versé. Si ce fonds était versé ça permettrait de donner peut être à la direction de la cinématographie de meilleurs locaux, de créer peut être un petit stu- dio et d’aider quelques jeunes à réaliser leur premier film. Peut-être même d’aider à faire un long métrage par an. Si on n’est pas tous ensemble et pas en train chacun de chercher nos intérêts personnels, jamais on n’obtiendra ce financement!
KDO: Pour que vous – en tant que réalisateur d’audiovisuel – puissiez toucher des droits d’auteur, il faudrait qu’il y ait un collectif de réalisateurs qui se bat- tent pour pouvoir obtenir ça, et le problème c’est que vous n’avez pas de collectif!
KS: Voilà. Parce que les musiciens eux se sont en fait battus pour obtenir ça. Bon là, dernièrement j’ai enten- du, – moi je n’étais pas invitée je ne sais pas pourquoi -, j’ai entendu dire que des réalisateurs et des producteurs s’étaient réunis dans un hôtel pour discuter. J’espère en tout cas qu’ils sont parvenus à des conclusions qui font avancer les choses. Mais c’est déjà bien qu’ils se réunis- sent, moi en tout cas je suis disponible!
INTERVIEW DE SELLOU DIALLO REALISATEUR, PRODUCTEUR DE DOCUMENTAIRES
KDO: Sellou DIALLO, est-ce que je peux te demander de me faire un résumé de ton parcours. Et du fait que tu sois devenu réalisateur, producteur de documentaires et aussi ton passage à AfricaDoc.
SD: Mon parcours est très simple enseignant d’abord, je viens du théâtre, c’est comme ça que j’ai glissé vers le cinéma, par le théâtre documentaire d’intervention sociale. J’ai fait une première résidence d’écriture avec Ass Thiam au média centre, c’est ainsi que j’ai rencontré Jean Marie BARBE qui était venu monter AfricaDoc. J’ai été le premier, en fait, à faire le DESS en réalisa- tion de documentaires. J’avais repris mes études – j’étais déjà enseignant. Le documentaire semblait être un aboutissement de toutes les recherches que je menais et je suis devenu réalisateur. J’ai voulu que mes films se fassent et je n’avais pas de producteurs qui soient dans l’économie du documentaire. Avec Gora SECK, nous avons mis en place une société de production pour porter nos films. Nous sommes entrés en coproduction avec des amis du Nord pour mon premier film et avec Gora SECK, nous sommes des pionniers un tout petit peu, dans cette aventure AfricaDoc. Comme j’étais déjà enseignant, Jean Marie, l’université et AfricaDoc ont mis en place le master de réalisation documentaire à l’université Gaston Berger ici, à Saint-Louis.
KDO: Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en terme de production sur le documentaire?
SD: Enormes! Déjà principalement parce qu’on n’a au- cun guichet ici pour le documentaire… et il n’y a pas de politique de soutien à la production de documentaires. C’est comme si le documentaire, on le découvrait. Les télévisions n’ont aucune idée de ce que cela veut dire. Cela commence à se faire depuis une dizaine d’années avec les rencontres d’AfricaDoc à Gorée, et maintenant à Saint-Louis. Les télévisions sont invitées à Louma pour qu’elles voient les productions afin d’être sensi- bilisées. Elles sont habituées à nous voir taper à leurs portes pour leur demander des accords de diffusion. Mais la difficulté majeure c’est qu’on est dans un genre tout à fait nouveau. Ce n’est pas exagéré de le dire, et d’autre part il n’y a aucune économie en tout cas aucune politique de soutien à la production du cinéma en gé- néral. A plus forte raison du documentaire. Ce qui fait que l’on va chercher de l’argent à l’OIF, et à l’Union Européenne et d’autres fondations. Sur le plan national, il y a de petites choses qui bougent, la mairie de Dakar qui a mis en place un fonds depuis deux ans, donne un million, un million cinq cent, deux millions. C’est une très grande première que nous saluons tous, nous sommes tous super contents. Si cela pouvait faire tâche d’huile dans les autres communes et les mairies, et que les communautés puissent entrer dans le jeu et financer les productions, ce serait formidable. Le ministère va suivre pour établir une véritable commission avec des fonds, et qui attribuerait même des sommes modiques! Cela financerait quelques documentaires par an.
KDO: Sur les deux documentaires que vous avez faits, est- ce que vous avez reçu de l’argent au niveau national?
SD: Absolument pas. Le premier a été fait avec un financement donc CNC, OIF, rien de l’Afrique. Le deuxième film uniquement le CNC. D’ailleurs c’est un film où les sociétés de productions n’ont rien gagné, parfois ont perdu de l’argent. Les gens ont été très mal payés, je n’ai jamais eu de salaire de réalisateur, les pro- ducteurs n’ont rien gagné mais il fallait le faire.
KDO: Et maintenant on va passer au problème de la dif- fusion. J’aurais des questions à vous poser sur le fait que la production pose problème au niveau national, parce qu’il n’y a pas d’argent, il n’y a pas de fonds, il n’y a pas d’institutions pour aider le documentaire, mais qu’en est- il des problèmes de la diffusion?
SD: Ce qui serait souhaitable c’est que, par exemple – ne parlons pas des salles de cinéma – mais que les télévisions du service public puissent soutenir les pro- ductions de documentaires, à une certaine hauteur. Je suis sûr qu’ils peuvent trouver l’argent. Mais il faudrait quelqu’un dans l’intelligence du cinéma documentaire ayant cette culture. Peut être qu’il n’y en a pas non plus, et les télévisions continuent à nous donner des accords de diffusion, car cela ne leur coûte rien et ne les engage pas vraiment. Participer financièrement, les télévisions ne le font pas, alors qu’elles pourraient attribuer des sommes plus conséquentes dans la coproduction.
Cela pourrait régler pas mal de choses, et permettrait que ces productions leurs reviennent pour la diffusion. Cela peut être aussi un travail des producteurs que de collaborer avec les télévisions. La conscience germe de plus en plus parce que les producteurs, si nous voulons survivre, si nous voulons que nos œuvres soient vues, il va falloir que chacun sorte de son coin et qu’on se retrouve ensemble pour former une association.
On ira voir les télévisions, on ira voir les décideurs. C’est comme cela que naissent les dynamiques les plus porteuses. Mais pour le moment il n’y a que des straté- gies de diffusion alternative, comme le Ciné Ecole, il y a énormément de festivals dans des quartiers, dans des villages etc. Je trouve que c’est une très bonne chose car la cérémonie cinéma est en train d’être réinventée de manière très communautaire.
On a parlé toute à l’heure d’une société civile reven- dicative, nostalgique des origines, vraiment destinée à être partagée avec les communautés. De plus en plus cette conscience-là accompagne la production.
Il faudrait que les télévisions accompagnent. C’est toute une politique – je n’en ai pas toutes les clés – mais en tout cas je me dis qu’il faudrait que nous, producteurs, réalisateurs, nous nous associions. Il faut que nous soyons regroupés autour des associations par exemple des AfricaDoc de chaque pays actuellement en réseau, et qu’on puisse aller avec nos films vers des télévisions pour faire des propositions.
Parce qu’il faut qu’on leurs propose des projets, ils ne sont peut-être pas au courant de tout ce qui se passe. On pourrait leur mettre la puce à l’oreille, leur réin- venter une intelligence de situation qu’ils n’ont pas, parce que finalement ces gens découvrent le cinéma documentaire comme un genre tout à fait nouveau! C’est hallucinant.
KDO: Et en dehors de la télévision ? Avec beaucoup d’utopie, on peut imaginer aller aujourd’hui à la recher- che d’auditoires en dehors de la télévision, dans les salles de cinéma ou dans des lieux publics. Qu’est-ce qu’on pourrait imaginer en sachant qu’il n’y a plus de salles de cinéma en Afrique, globalement toutes les salles ont disparu. Qu’est-ce qu’on pourrait imaginer pour aller à la reconquête d’une jeunesse africaine dans les lycées, dans les universités. Qu’est-ce qu’on pourrait imaginer comme scène de projection?
SD: Moi, peut-être tu vas entendre cette réponse, elle n’a rien d’original, je suis et je découvre que je ne suis pas le seul… je n’ai aucune nostalgie des salles de ci- néma. Je ne souhaite même pas que ces salles de cinéma soient rouvertes parce que je crois que ce n’est pas ça qui fera renaître le cinéma. Les salles de cinéma pour l’expérience que j’en ai eue, en tout cas ici au Sénégal, ça n’a jamais été un lieu culturel. Si on veut ré-inventer le cinéma, il y a des types de distribution alternatifs, des ciné-écoles, des choses comme ça, j’y réfléchis. Je suis chercheur aussi à l’université, c’est vraiment la question sur laquelle je travaille. Si cela doit renaître, ça renaîtra peut être dans des écoles où il y a des salles de projec- tion. Dans des foyers qu’on bâtit partout dans les villes et dans les quartiers qui ont aussi des salles de projec- tion ou sinon…
KDO: Dans des salles communales, des salles de quartier…
SD: Même ici au Sénégal, il y en a partout. Même là où j’habite il y a un foyer, à la place des bals, il y a parfois des soirées. On peut y organiser des soirées de cinéma. C’est comme ça que le cinéma reviendra vers les gens. Les salles de cinéma, cela mettra du temps pour qu’on y revienne. Mais voyez par exemple le programme de l’éducation à l’image qui existe dans le programme scolaire…
KDO: Ici au Sénégal…
SD: Ici au Sénégal, mais tu ne verras aucun enseignant enseigner la lecture de l’image. Ils n’ont pas les outils pédagogiques.
KDO: Il leur manque les outils pédagogiques?
SD: Oui mais aujourd’hui, un de nos collègues enseigne à l’école normale la pédagogie de l’image et donc ce qui est sûr, c’est que ces gens-là iront l’enseigner dans leurs classes, et organiseront des projections…
KDO: Il n’y aurait pas une bataille à mener auprès de l’éducation nationale pour intégrer justement un pro- gramme pour l’image car on n’a jamais autant été envahi par l’image?
SD: C’est pourquoi je dis que les producteurs ont du travail. Il ne s’agit pas seulement de produire des films, mais de réfléchir à tout ça. En fait ce n’est pas aux réal- isateurs de penser à tout ça. Tu te contentes de faire ton film et de voir comment tu arrives à le diffuser, mais si on pense à tout, si on cherche des stratégies de diffu- sion, il va falloir penser à tout ça. Les salles de cinéma, ce sera dans le long terme. Mais pour le moment, ces diffusions alternatives peuvent amener le cinéma de quartier à faire découvrir à beaucoup de gens l’existence du cinéma. Le premier festival de films de quartier, initié par Ass Thiam, a fait découvrir le cinéma à beaucoup de jeunes qui sont aujourd’hui dans le cinéma documentaire à Dakar. Leur initiation a commencé dans le cinéma de quartier.
KDO: Si on veut aller à la conquête d’une audience jeune, il faudrait commencer effectivement par des projections de films à l’intérieur des écoles avec éventuellement des animateurs du documentaire ou de la fiction. Des anima- teurs formés pour parler de l’audiovisuel, de l’impact de l’image positive ou négative. Et que représente la lecture et la force d’une image. Il faudrait éventuellement impli- quer l’éducation nationale dans ce cadre là.
SD: Un travail que nous les producteurs, nous avons en charge de mener. Producteurs, réalisateurs, penseurs du cinéma, notre groupe de recherche pense à tout ça, c’est un travail à faire. Il y a de telles initiatives. Il faudrait peut être les fédérer mais elles participent à cette même dynamique. La conscience en tout cas est là. Dans une télévision de Saint-Louis, il y a une jeune critique de cinéma qui essaye de proposer une convention qui permettrait à tous les films produits ici à Saint-Louis dans le cadre du master de résidence, d’être diffusés par cette chaîne. Ce qui leur donnerait une visibilité. C’est dans ces cadres-là que vont naître ces initiatives-là, et ça va faire son bout de chemin, arriver au ministère qui va impulser une politique pour que le programme de l’éducation facilite la diffusion etc. Faire naître l’intérêt pour que même des enseignants fassent des résidences d’écriture de documentaire. Mais aussi inventer d’autres formes communautaires. Je crois que c’est cela l’avenir.
KDO: Donc nous sommes à l’ère des inventions pour con- quérir de nouveaux publics?
SD: Absolument.
INTERVIEW DE MONSIEUR KHALIL NDIAYE
PRESIDENT DU FESTIVAL IMAGE ET VIE ET RESPONSABLE DU RESEAU FAR (FILM AFRIQUE RESEAU)
KDO: Nous sommes dans le bureau de Mr Khalil Ndiaye qui est le président du festival IMAGE et VIE et qui s’occupe aussi du système de distribution FAR (Film Afrique Réseau). Il est également producteur de films. Nous allons démarrer l’entretien avec son point de vue sur la problématique de production du documentaire ici au Sénégal.
KN: Oui en fait, il s’agit de la problématique de la pro- duction tout court, c’est à dire l’accès aux moyens. Dans ce cadre, le documentaire demeure malgré tout le genre le plus accessible avec la démocratisation du cinéma liée au numérique. Des jeunes peuvent très facilement trouver un sujet, il suffit de le travailler, mais ça de- mande moins de moyens qu’une fiction, qui exige aussi des personnages. Grâce aux derniers jeunes formés par les différentes structures de formation, on a obtenu une petite production de films documentaires, Des gens se sont révélés Aicha Thiam et Fa Bakari, et quelques au- tres. La nouvelle génération s’est un peu affirmée, mais il reste à trouver le financement pour faire des films documentaires. Il n’y a déjà pas de financement pour le cinéma sénégalais dans son ensemble! Il est vrai qu’on peut s’adresser à des fonds comme Hubert Bals, ou peut être le Fonds Sud mais c’est très compliqué pour les jeunes de trouver de l’argent.
KDO: Et en plus il n’y a pas de système véritablement de coproduction au niveau des télévisions locales.
KN: Les télévisions locales, elles se complaisent dans la facilité parce qu’on en a beaucoup plus que dans d’autres pays. On a six chaînes maintenant je crois. Elles diffusent des séries de fiction plutôt que de coproduire des documentaires, ce qui n’est pas impor- tant pour elles. Elles diffusent des talk show, des clips de musique, avec invitation d’artistes dans les télés réalités. C’est tout ce qui les intéresse. Alors que le documentaire est formateur. C’est très important dans nos pays. Mais les télévisions ne le perçoivent pas ainsi. Essayer de leur faire acheter un film c’est la croix et la bannière. Donc il demeure difficile, jusqu’à présent, de faire quoi que ce soit dans ce domaine. Il est vrai que je ne comprends pas bien le système en Afrique Centrale ou au Cameroun. Je crois qu’ils ont des obligations de programmation de contenu local, certaines chaînes se regroupent pour acheter des programmes, ce qui n’est pas le cas chez nous encore.
KDO: Et vous pensez que c’est quelque chose qu’on pour- rait instaurer ici?
KN: Je le crois parce qu’avec les textes qui vont être mis en place, et la nouvelle dynamique je crois qu’on va aller vers plus d’exigence. Il faut qu’on demande aux télés de prendre leurs responsabilités, aux autorités d’appliquer la législation qui existe depuis la rencontre qui s’est tenue à Saly. Dans une deuxième phase, il faut que les opérateurs, les acteurs eux même se positionnent pour faire des propositions et exigent un cadre où leur métier puisse valablement s’exercer.
KDO: Est-ce que vous pouvez nous faire brièvement un bilan de votre festival qui a eu lieu la semaine dernière, un bilan rapide de ce qui s’est passé?
KN: A l’ouverture le Ministre ne s’est pas trop en- gagé au début, mais avec un journaliste, il s’est un peu avancé. C’est déjà une bonne chose maintenant il y a eu une bonne participation des jeunes qui étaient là et un élargissement des cercles de diffusion à d’autres structures européennes. Le délégué chargé de mission à l’Union Européenne était présent pour parler de ques- tion de diffusion en terme de lobbying ou de messages à faire passer. C’était intéressant. Maintenant il faut voir ce qu’on peut en faire. A l’issue de cette rencontre, les participants ont voulu créer un cadre qui leur per- mette d’harmoniser leurs initiatives pour la diffusion. Ce sont des possibilités qui s’ouvrent il s’agissait sur- tout de fiction mais on peut ouvrir les portes, élargir à d’autres genres. Le réseau des centres culturels français était très bien en phase avec notre réseau FAR. Ils ont soutenu nos idées et on a invité des réalisateurs qui ont aussi fait le tour de tous ces circuits de diffusion. Nous ne désespérons pas d’élargir le débat aux autres centres culturels européens. La représentante de la directrice de Douta Seck a dit qu’elle était ouverte à toute forme de collaboration. Nous avons quatorze centres culturels régionaux et nous avons, à Dakar, dix-neuf centres socio- culturels. Il y a donc un potentiel pour la distribution. Il y a aussi des liens à tisser avec les scolaires. On a agité de petites choses, il faut les formaliser et trouver une jonction pour pouvoir élargir les publics. C’étaient ça en fait les deux principaux objectifs de notre réseau construire un réseau de lieux et construire un réseau de public. En ce qui concerne le réseau de lieux on y est arrivé un tout petit peu, parce que, avec une dizaine de salles en Afrique plus cinq salles du réseau des centres culturels français, le résultat est respectable. Il reste à construire les centres culturels locaux dans les autres pays qui ont eu peut-être moins de succès dans la con- struction de ces réseaux de centres culturels. Ça n’a pas bien fonctionné mais ils y travaillent. On collabore avec un réseau de salles par exemple à Ouagadougou. Toutes les salles de quartier sont dans le réseau, il nous reste peut- être à intégrer les deux grandes salles le Normaya et le Burkina. C’est une question de mentalité parce qu’ils ont eu toujours un pouvoir dominateur sur les autres. Ils ont eu du mal à avoir le réflexe d’être sollicité par d’autres pour la diffusion dont ils avaient un peu le monopole. Et là, il faut construire autre chose. Mais je crois que les mentalités changent. On a aussi tenté une diffusion télé. On a tenté avec la télé burkinabé, malienne et sénégalaise. Ils ont accepté de diffuser des films. Il est vrai qu’on ne gagne rien mais on a de- mandé en échange une promotion sur nos sorties de films. C’était déjà un premier pas. On pourra plus tard discuter rétribution ou simplement une forme de troc, d’échange. Je ne sais pas. On verra comment trouver une solution.
KDO: Et donc vous êtes prêts aussi avec le FAR (Associa- tion Film Afrique Réseau) à pénétrer le milieu scolaire dans ces différents pays africains?
KN: Ah oui! Si on a expérimenté un peu au Sénégal, au Burkina, il y a déjà une pratique Mais, j’avoue que c’est au Mali que c’est mieux fait parce que le réseau des cinéclubs scolaires existe. Ils ont repris, je crois, deux films. Il est vrai que nous avons un petit problème avec nos producteurs africains. Notre opérateur et notre représentant sur place ont déjà fait une première redif- fusion pour le compte du CNC. On aurait pu fédérer les deux producteurs, mais c’était un peu une question de souveraineté pour eux. Ce sont eux qui ont produit, ils doivent donc diffuser mais bon, les mentalités vont changer petit à petit grâce au FAR. On a expérimenté.
On avait diffusé officiellement quatre fictions, et on a expérimenté la diffusion d’un documentaire avec « Victimes de nos Richesses » qui a été aussi très bien accueilli. C’est un film qui est très fort qui parle des questions d’immigration mais qui est vraiment très fort parce qu’il y a un discours.
KDO: C’est le film de Kal Touré?
KN: Avec un vrai discours, et des gens qui parlent de leur situation. Sans, comment dire, “caresser personne” , c’est à dire que tout le monde en a pris pour son grade. A nous de voir comment cela fonctionne, et comment il est possible de travailler davantage sur le documen- taire dans un système international.
KDO: Vous avez eu beaucoup d’entrées pour ce documentaire?
KN: Ici à Dakar on a eu, avec le réseau des centres culturels, de très bons résultats. Bon un peu moins au Burkina Faso parce que ça coïncidait avec une sortie d’un grand film de fiction burkinabé Pierre Yaméogo qui sortait son premier film traitant à peu près du même sujet. Bon cela a un peu bloqué mais le prin- cipe du FAR c’est de continuer en profondeur, c’est à dire après une sortie, d’aller chercher les clients et de prolonger la vie du film. C’est un peu ça le principe, c’est un peu difficile, mais pour nous, c’est le seul choix. Il faut aller chercher les gens là où ils sont, faire des programmations, inciter les gens à utiliser les réseaux sociaux. Par exemple avec « Le Fauteuil » on a eu, à Dakar, beaucoup de succès avec les associations de femmes. On a eu des commandes d’associations de femmes juristes, d’associations de femmes de la mé- dina, une autre ONG italienne a repris le film pour le distribuer dans des circuits féministes. « Le Fauteuil » parle des conditions des femmes, de leurs difficultés à se faire leur place avec toutes les contingences sociales.
KDO: Et ce film là, Le Fauteuil a surtout marché dans le cadre des institutions de femmes?
KN: C’est un film qui a bien marché partout. Et ça c’est intéressant. Parce qu’un film qui marche bien chez nous, ne marche pas forcément ailleurs. Il faut faire une analyse. Est-ce à cause du doublage? Ou autre chose?
Je ne sais pas mais « Le Fauteuil » est en français et il a marché dans tous les pays. C’est peut-être l’approche il est très proche du téléfilm dans sa construction, avec une meilleure qualité d’image, des dialogues succulents et cela a fonctionné!
KDO: Est ce que vous pouvez nous dire brièvement com- ment aller à la reconquête ou à la conquête d’un nouveau public, d’un public jeune qui a perdu l’habitude ou qui n’a même pas connu les salles de cinéma ? Est ce qu’on peut imaginer aujourd’hui d’aller dans les espaces publics, se déplacer, c’est à dire organiser des projections itinérantes dans des endroits qui existent. Ou est ce que vous vous préconisez plutôt un retour des salles de cinéma mais plus petites que les salles de 800 places ou de 500 places comme dans le temps ? Ou des petites salles regroupées, équipées en HD ou en système de projection numérique.
KN: Le projet c’est que le cinéma demeure aussi un divertissement. Il faut l’approcher comme ça. Les jeunes ont d’autres divertissements à leur disposition. L’idée qu’on a expérimentée au Sénégal c’est celle de petites salles dans lesquelles on intégrait un espace fast food ou resto, une petite terrasse avec une projection cinéma mais aussi de temps en temps de petits concerts de musique avec des groupes locaux. Cela veut dire qu’il faut essayer de concilier les différentes dimensions culturelles et de loisirs. Les jeunes aiment bien sortir ici dans nos pays qui sont à majorité musulmane. Mais les gens ont très vite le réflexe de devenir casanier. Quand ils se marient, ils sortent plus difficilement. Dans les autres pays, il peut y avoir une culture de sortie, mais la tranche d’âge qui sort ici c’est entre 18-35 ans et jusqu’à 40 ans. Après c’est plus difficile, sauf sur des films plus pointus ou des événements culturels qui valent le déplacement. L’idée est donc de combiner la restauration au cinéma de proximité, être proche des gens. Ils ont souvent des problèmes pour aller au centre ville, il faut faire de petites installations, de petites uni- tés, une programmation variée et attrayante, qui alterne musique, cinéma et théâtre. Cela pourrait fonctionner dans un espace où les gens pourraient simplement venir manger, regarder un film s’ils le veulent, un lieu dans lequel ils se reconnaissent, suffisamment attractif. Parce que le plus souvent on pense que dans les quartiers difficiles où il y a peu de moyens, les gens ne sont pas sensibles à la qualité. C’est totalement faux. Quand on va au Burkina on voit des gens qui s’assoient sur des bancs en ciment. Ce n’est pas parce qu’ils ne veulent pas plus de confort, c’est la seule chose qui existe. Moi dans un autre domaine, j’avais fait un très bel espace de restauration et les gens étaient fiers de dire que c’était dans leur quartier, même si on n’avait pas fait les bonnes études de faisabilité, on avait senti ce sentiment de fierté, d’appartenance et les gens venaient acheter, ils venaient parce que c’était un peu à l’image de ce qu’il y avait au centre ville, mais dans leur quartier. Si on fait la même chose dans le cinéma, toutes propor- tions gardées, je veux dire installer de bonnes lumières, des peintures rafraîchies, une bonne qualité de produc- tion en HD, une bonne programmation, un espace de restauration, à la portée des bourse, ça fonctionne.
KDO: Vous, de votre point de vue, vous pensez que la diffusion de films dans les salles de cinéma a encore de l’avenir ? Faut-il juste trouver les salles adaptées?
KN: Forcément, c’est dans l’évolution du cinéma, nous n’avons pas inventé le cinéma, nous n’avons pas apporté les réponses au moment où il fallait les apporter. On a connu le VHS ensuite le DVD, et ensuite la télévision numérique. Ailleurs ils se sont adaptés, ils sont passés par les multiplex, les espaces avec tout ce qu’il faut, in- ternet, des jeux vidéos, le popcorn et tout ça. C’est une réponse que nous n’avons pas eue. Nous, nous sommes restés sur le mono-écran dans la plupart de nos pays.
KDO: Oui le mono-écran dans des salles de quartier.
KN: Dans les salles de quartier. Dans certains pays, il n’y en a pas beaucoup en Afrique, il y a des multiplex, mais ils sont complètement consacrés à un autre segment de la population. Ils ciblent les nantis. Les autres ne se reconnaissent pas, ils pensent même qu’ils n’ont pas le droit d’y aller. Alors qu’on peut faire des investissements adaptés, réalistes afin de leur offrir le même service.
KDO: Et pourquoi pas un concept et une pensée qui soient adaptés à leur lieu, à leur quartier, pour que ça fonc- tionne?
KN: Ça peut se faire après. Maintenant je ne dis pas qu’on doive arrêter tout ce qui se fait comme diffu- sion alternative ça doit rester qu’alternatif. On ne peut pas réduire le film africain uniquement à la diffusion à la télévision et à la diffusion sur internet. La salle de cinéma est le pilier de tout le système du cinéma améri- cain et européen, donc on ne peut pas s’en passer.
KDO: De votre point de vue, aujourd’hui nous sommes à un carrefour, nous sommes dans des moyens de diffu- sion alternatifs mais en même temps, il faut penser et réfléchir à un concept réel qui soit adapté aux quartiers africains, aux quartiers populaires et aux quartiers des gens nantis?
KN: Bien sur il faut les deux. De tout temps le cinéma africain avec le CIDC a fonctionné comme ça. Il y avait ce qu’ils appelaient la salle d’exclusivité qui était consacrée à l’élite ça veut dire les tarifs et les salles de quartiers qui recevaient les films. Avant il n’y avait qu’une seule copie. Il fallait l’avoir en exclusivité. Ensuite une semaine ou deux après, la circuler dans les quartiers. Ça fonctionnait et les recettes étaient à peu près égales en terme d’entrée au box office améri- cain. Les deux se valaient en terme d’entrées. Comme dans le système français les quartiers battaient de loin les salles d’exclusivité parce que plus intéressantes en capacité d’accueil. Elles étaient aussi plus importantes en fréquentation.
KDO: On a découvert aussi qu’à cette époque-là, les gens des quartiers allaient voir le film deux à trois fois alors que dans les quartiers nantis les gens n’allaient voir le film qu’une seule fois.
KN: Bien sûr je donne une petite anecdote j’étais exploitant de salle quand on a sorti « Titanic ». Sur un mois on a fait pratiquement salle comble pendant quinze jours à raison de trois séances par jour. Après c’était la première fois dans l’histoire de la diffusion, on a livré douze copies – avant c’était une copie pour toute l’Afrique de l’Ouest – et nous, nous avions douze copies au Sénégal. Nous avions une copie dans notre salle à nous, et après quinze jours et même après un mois, on le mettait tous les jours à une séance de dix huit heures elle a fait le même nombre d’entrée pen- dant un mois. Incroyable! Et dans la programmation on savait qu’un film qui passe peut revenir dans trois mois ou dans deux mois. Vous pouvez le reprogram- mer les gens viendront le voir. Durant sa carrière il peut revenir trois ou quatre fois. Ça veut dire, ils ont envie de retrouver les mêmes sensations. Dans les quartiers, vous pouvez voir une personne qui vient peut être une fois par semaine, c’est très rare c’est ceux qui travail- lent qui viennent le weekend, ils viendront deux fois le vendredi ou le dimanche ou le samedi ou le dimanche. Il y en a qui viennent tous les jours dans les quartiers et pratiquement ils viennent aux mêmes séances. Si vous les connaissez ils s’assoient à la même place à peu près. Pour certains il y en a qui bossent très dur donc le soir c’est une manière pour eux de se relaxer. Il y a donc y a une clientèle captive qui continue encore de venir dans certaines salles.
KDO: En conclusion en fait il faut juste trouver un concept de salles de cinéma ou l’équivalent adapté, nous restons sur cette conclusion là, où il faut pour vous de votre point de vue trouver un concept?
KN: Voilà c’est ce qu’on dit salle de cinéma ou lieu alternatif payant pour construire une économie. Nous sommes contre les financements à fonds perdu sur des gens qui viennent squatter un pays, et des gens qui font un projet et s’en vont quand c’est fini. Ils ne viendront jamais quand il n’y a pas d’argent. Ils essayent de se battre pour gérer leurs trésoreries parce qu’ils ont des engagements. Il y a des personnes qui connaissent bien cela et qui vivent de ça. Tant qu’ils peuvent maintenir en équilibre le système, ils sont là mais ils ne gagnent pas d’argent. C’est juste une gestion de trésorerie, payer celui là, finir de payer les salaires le 10 au lieu le 30, jouer avec des délais sur les fournisseurs etc…
KDO: Il faut je pense un certain soutien de l’Etat qui aujourd’hui est absent en terme de distribution. En terme de diffusion, c’est l’absence de télévision qui ne s’engage pas vis à vis des producteurs réalisateurs, qui ne s’engagent pas en domaine de diffusion pour les docu- mentaires – et même pour les films de fiction – donc nous sommes bien d’accord qu’il y a beaucoup d’espoir en terme de distribution, de diffusion de films documentaires et fictions à condition que nous passions à l’étape supérieure avec une massive participation de l’Etat?
KN: Oui, de l’Etat aussi mais des autre Etats, qui in- terviennent dans notre cinéma. Moi je dis même « De quel droit vous intervenez dans notre cinéma, pourquoi vous nous aidez, je ne le comprends même pas? » Je peux le comprendre si on m’explique mais si on nous aide, qu’on nous aide juste où il faut. Je crois que c’est aberrant de mettre, je ne sais pas moi, deux millions d’euro sur un film. Il faut en même temps penser mettre cinq cent milles euro pour affiner le réseau de diffusion, le structurer. On peut à peu près remettre en état les circuits de salles dans les pays, ce n’est pas les mêmes investissements. On a fait des études même sur la diffusion numérique, on peut l’adapter on n’est pas obligé de faire la même chose que ce qui se fait à GAUMONT. On peut faire des choses de très bonne qualité avec des solutions qui sont des solutions que nous pouvons imaginer avec du bon matériel qu’on peut trouver ailleurs dans d’autres pays. Rénover nos salles, les adapter, ça va être au franc près, ça ne peut pas être un budget qu’on gonfle. Si on doit acheter un projecteur c’est un projecteur qui coûte tant. Après c’est à l’exploitant de se bagarrer pour faire vivre sa salle.
Avec la précarité de son exploitation actuelle il ne peut pas la booster et il ne peut pas faire des investissements. Il n’ose pas aller emprunter sinon on va lui saisir le peu qui lui reste car le seul repli qu’il a c’est son espace.
INTERVIEW DE GORA SECK
REALISATEUR ET ENSEIGNANT CHERCHEUR GORA SECK EST EGALEMENT PRODUCTEUR LES FILMS DE L’ATELIER
KDO: Je suis à Saint-Louis, je fais une interview de Gora Seck, producteur réalisateur et enseignant au master 2 de Saint-Louis. Voilà il va brièvement nous raconter son parcours et nous dire quels sont les films qu’il a produits et les films dont il est réalisateur?
GS: Je suis producteur, réalisateur, enseignant-chercheur ici à l’UGB et donc j’interviens au niveau du master 2 documentaire de création de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. Avant l’aventure pour le cinéma, c’était une aventure d’abord avec le théâtre, je reste toujours au théâtre, il faut le dire, je garde un pied au théâtre. Parce que tout simplement il y a mon maître qui me disait “le théâtre mène à tout à condition de ne pas le quitter” et on ne l’a pas quitté. Mon collègue et moi…
KDO: Qui est votre maître?
GS: Mon maître c’est Lucien Lemoine, c’est eux qui nous ont appris véritablement à taquiner la scène, à avoir toute la connaissance dans le domaine théâtral avant d’arriver au cinéma. Et donc tout de suite après quand il y a eu l’ouverture d’une école au niveau de Dakar, il était important pour nous en tout cas de diversifier un peu nos activités, nos études au niveau de l’université, tout en continuant aussi nos activités théâtrales. On s’est inscrit tout simplement au média centre de Dakar. C’est là-bas que j’ai fait une forma- tion de deux ans. A l’issue de cette formation, j’ai été faire plusieurs stages aussi bien pour la réalisation que pour la production à l’extérieur en me débrouillant tout seul. En essayant simplement d’exploiter des réseaux, des connaissances comme Jean-Marie Barbe. Donc en 2005 quand on commencé – euh! avant 2005 en fait – il y a eu des séries de formation qui ont été organisées par AfricaDoc. Nous avons participé à ces séries de formation-là, et nous avons été parmi les premiers à organiser, en fait, les rencontres Tënk au niveau de Gorée. Parce que moi je suis toujours régisseur général, même si je suis devenu enseignant aujourd’hui. J’ai commencé avec AfricaDoc avant d’arriver véritable- ment à la formation, en tant que régisseur général pour l’organisation du Tënk. En fait, il s’agit de recevoir les gens, les faire venir, trouver les hôtels…
KDO: Organiser…
GS: Exactement. Je reste toujours à ce poste-là, même si j’interviens dans la formation et autre, car il y a encore la confiance qui est là. Nous, à un moment, il était donc important en tout cas de porter nos films, de porter nos idées, de dire ce qu’on pense de la manière de vivre de nos populations, de montrer notre quotidien et comment notre quotidien évolue. AfricaDoc était une opportunité, on a voulu l’exploiter et j’ai fait un forma- tion là-bas pour l’écriture d’un scénario. Mais j’ai été très déçu à l’issue de cette résidence. Et à un moment, mon collègue Sellou me dit « Mais écoute, pourquoi ne pas mettre en place nous-même notre propre structure pour porter nos films, tu serais mon producteur quand moi je réalise et moi je serais ton producteur quand toi tu réalises? » J’ai dit « Mais pourquoi pas? » Mais moi, je suis issu de la fiction. Entre temps j’avais fait trois longs métrages – en fait en tant qu’acteur parce que je viens du théâtre. Et donc la proposition qu’il m’a faite a coïncidé justement avec la fin d’un de mes derniers tournages qui s’appelle « Capitaine des Ténèbres » de Serge Moati, donc j’avais amassé un peu d’argent et lui il venait de gagner le prix du CMC du meilleur scé- nario documentaire. Et donc on a rassemblé…
KDO: Pour quel film?
GS: Un film sur les aveugles, “Amma, les aveugles de Dakar” et donc tout de suite on s’est dit pourquoi pas. Et on y est allé et j’ai produit ce film-là en coproduc- tion avec une boîte française, et on a continué comme ça. On a trouvé une caméra avec l’argent qu’il y avait.
On a pu véritablement économiser dans ce film-là et après, petit à petit… on n’a jamais eu de salaire, en fait, au niveau de cette boîte parce qu’il y avait un désir d’acquérir des matériels pour être indépendant, faire le film qu’on a envie de faire, avoir notre propre regard sur notre propre quotidien, ne pas avoir une influence venant d’un autre continent qui pourrait peut-être remettre en question le regard que nous même nous aimerions porter sur notre société. Donc, petit à petit, on a commencé à acquérir un micro, une caméra. Maintenant on est à deux bancs montages, deux caméras, on est indépendant. Matériellement on est indépendant. Mais c’est financièrement qu’il y a des problèmes. Mais il faut dire que AfricaDoc nous a énormément aidés pour arriver à quelque chose parce que là, tout de suite, nous avons trouvé des alliés et des gens qui étaient décidés, en tout cas, à nous épauler.
Sinon simplement, à collaborer avec nous afin que les films puissent exister. Et donc tous les films que nous avons, nous en avons faits une dizaine entre 2005 et 2012 tous ces films là…
KDO: Que vous avez produits.
GS: Que nous avons produits, que la boîte a produits, que moi j’ai produits. Euh des films de Sellou…
KDO: Comment s’appelle votre société de production?
GS: “Les films de l’atelier”
KDO: Et vous avez produit dix films entre 2005 et 2012.
GS: Et là, on est sur le treizième et quatorzième. Parce que généralement quand on voit un projet intéres- sant, on n’attend pas d’avoir les sous, puisqu’on a les moyens de tourner. On essaye véritablement d’avoir un peu d’argent pour pouvoir manger et se déplacer et on arrive à trouver quelqu’un qui veuille bien faire, en tout cas, la caméra en attendant qu’on puisse trouver les sous parce qu’il devient difficile, tout de suite, de trouver les sous rien qu’avec l’écriture on s’est dit « Tiens! On va se lancer maintenant, faire les images, essayer d’intéresser plus les partenaires qui pourraient véritablement investir dans les projets ». Donc, c’est comme ça qu’on fonctionne pratiquement depuis un certain moment.
Mais cela ne nous empêche pas quand même, d’envoyer les réalisateurs dans des structures de formations ou bien dans des résidences d’écriture. D’ailleurs il y a une réalisatrice que je produis depuis six moi, je suis sur un projet qui est pratiquement terminé mais qu’elle est allée écrire à Bobo.
KDO: Il s’agit de qui?
GS: il s’agit de Khadi Diédhiou.
KDO: Khadi Diédhiou, d’accord.
GS: Dans le projet Songo. Donc elle revient de Ouaga et me dit être très contente d’avoir fait cette résidence. C’est comme ça qu’on a fonctionné. Pour le nom “Les Films de l’Atelier”, c’était une manière de rendre hom- mage tout simplement à l’atelier de recherche et de pratique théâtrale de l’université Cheikh Anta Diop, parce que c’est là-bas qu’on nous inculqué ce qu’est l’art, l’amour de l’art et l’art industrie. Il était important qu’au niveau de notre structure, on puisse retrouver un élément qui rappellerait aussi notre parcours. Depuis, tant bien que mal, nous essayons de faire des films.
Nous ne gagnons pas d’argent, ça il faut le dire. Mais il était important pour nous qu’aujourd’hui, on puisse poser notre regard sur notre quotidien, et aussi qu’on puisse fabriquer une mémoire, une mémoire qui serait disponible pour les générations à venir. Parce que le problème de l’Afrique, c’est un problème de mémoire et il ne faudrait pas que d’ici quinze, vingt, trente ans, nos enfants nous demandent comment les choses se passaient à telle ou telle période et qu’on ne soit pas là, ou bien qu’ils ne soient pas capable de retrouver ça dans les images. Parce que moi personnellement je conçois qu’aujourd’hui s’il y a une troisième guerre mondiale, c’est la guerre des images, donc c’est la guerre des cultures. La guerre des cultures passe par la guerre des images. Si on voit un peu le temps que passe nos populations devant les écrans, il y a lieu de se poser la question à savoir qu’est ce qu’on leur diffuse comme images, qu’est-ce qu’ils reçoivent comme images.
Je pense que sur notre propre société, sur leur propre société, il y a encore du travail à faire. Nous essayons tant bien que mal de faire exister des images qui pour- ront raconter l’Afrique dans quelques siècles, ou bien qui racontent l’Afrique tout de suite. Que les gens puissent comprendre les types d’images qu’on a tou- jours diffusées ce n’est pas seulement ça l’Afrique, il y a d’autres choses qu’on peut découvrir. Comme dans tous les autres pays, il y a le bien, il y a le mal, il y a le beau, il y a le vilain, des choses comme ça, donc il était im- portant, pour nous en tout cas, à un moment de se dire « Tiens! Nous avons le bagage qu’il faut, intellectuel, nous avons le matériel qu’il faut. Il est de notre devoir de fournir des éléments qui restent et qui resteront gravés dans la mémoire des populations ». C’est parti pratiquement de ça.
KDO: Et je voulais vous poser des questions sur les dif- ficultés que vous rencontrez aujourd’hui en terme de distribution et de diffusion des documentaires?
GS: De distribution vous dites?
KDO: Oui, de distribution.
GS: Oui, en fait de distribution ou de diffusion, moi je ne comprends pas qu’il y ait autant de télés au Sénégal et que le documentaire soit si peu diffusé. Ou dif- fusé à des heures où il y a presque personne devant la télé, alors qu’il est important aujourd’hui de passer par un genre comme le documentaire, non seulement pour donner du plaisir aux populations, mais aussi les informer, les nourrir spirituellement du quotidien que ces populations-là vivent. Il faut dire que toutes les fois que nous avons eu besoin d’avoir des financements, nous avons été pratiquement dans l’obligation d’aller trouver une chaîne de diffusion. Le papier c’est nous même qui le faisions parce qu’on mettait de l’argent.
On disait que, voilà, nous sommes d’accord pour la diffusion de ce film, qu’on va mettre de l’argent dedans au nom de la télé, et la télé signait afin qu’on puisse disposer du peu de fonds qu’on pourrait avoir dans un guichet pour produire le film. Après la difficulté, vous savez c’est que ces télés là récupèrent les films auprès de nous, parce que ces télés là ont le droit de diffu- sion. Moi, j’ai trois films qu’une chaîne de télévision est censé diffuser et que cette chaîne de télévision, trois fois de suite, j’ai eu à appeler le responsable pour qu’il vienne chercher les films, il n’est jamais venu. On se pose la question mais qu’est-ce qui se passe au niveau de ces chaînes de télévision? “The right man in the right place” comme on dit en anglais, mais il y a aussi des problèmes de compétence. Donc en dehors de cela, nous avons essayé de mettre en place des systèmes de diffusion, qui malheureusement ne fonctionnent pas comme on aurait voulu que cela fonctionne. Comme par exemple, organiser un mini festival au niveau de l’Institut français, parce que l’Institut français, non seulement met en place toute la technique et l’infrastructure pour que les diffusions puissent se faire, mais en plus achète. Au moins il y a cinquante euros pour chaque film. Et pendant le week-end, on essaye de diffuser – mais, c’est pas ce public qui est notre pub- lic cible. Notre public cible c’est la population locale, quand on fait un film et qu’on diffuse ça deux ans plus tard dans l’endroit où le film a été fait, nous ça nous fait mal. Si on termine un film, c’est pour qu’il soit dif- fusé tout de suite et pour ces populations-là.
KDO: Et est-ce que vous imaginez comment faire pour faire adhérer des lycéens, des jeunes des universités au niveau de la visibilité du documentaire parce qu’il n’y a plus de salles de cinéma. Comment peut-on envisager d’aller à la reconquête d’une audience et d’un public?
GS: Moi je pense qu’ il est extrêmement important aujourd’hui avec le nombre de chaînes de télévision qu’on a, qu’on puisse déjà commencer par là, et après, tout simplement organiser des séances de projections dans les différentes écoles, dans les différents lycées, dans les différentes universités. Il y a une demande, il y a une attente et quelque part aussi on pourrait les inté- resser aux films documentaires. Organiser un festival du documentaires scolaires, je ne sais pas moi, intéresser des gens qui sont dans l’école qui pourraient véritable- ment plancher sur un sujet, le développer et après, peut-être, techniquement, être accompagnés par une boîte de production et créer un festival où il y aurait par exemple un certain nombre de produits provenant de ces écoles-là. En plus de cela, faire des diffusions ne serait-ce qu’une fois par mois dans ces écoles là. Moi je sais qu’il y a une attente, il n’y a presque rien qui se passe du point de vue culturel, au niveau des écoles.
Si aujourd’hui, on crie à tort et à travers qu’il y a une perversion de la jeunesse, c’est parce qu’on ne les oc- cupe pas sainement. Il y a lieu véritablement de faire en sorte qu’il y ait, en tout cas, des activités qui pourraient remplacer certaines activités qui sont dites perverses au niveau des écoles. Il y a cette possibilité qui est là, je pense qu’on peut l’exploiter.
KDO: Vous pensez qu’on peut s’appuyer énormément, peut être éventuellement sur des partenariats avec l’éducation nationale pour un type d’audience au niveau des écoles, des lycées, des universités?
GS: Moi je suis convaincu que c’est ce qu’il faut faire. Parce que faire du documentaire c’est aussi intéresser ceux qui vont à l’école…
KDO: Pour faire des débats…
GS: Et ne pas oublier les autres populations, celles qui comprennent peut être à un niveau moindre que ceux qui sont à l’école ou bien à l’université. Je pense qu’il faut commencer d’abord au niveau des écoles. C’est extrêmement important parce que c’est cette popula- tion là, sinon cette jeunesse là qui, quelque part, est en contact avec d’autres horizons, d’autres cultures et qui a besoin véritablement de s’informer de pénétrer sa propre culture avant d’aller ailleurs et cela ne peut passer que par des images mais des images qui sont disponibles hic et nunc (ici et maintenant) voilà.
INTERVIEW DE FATOU KANDE SENGHOR
REALISATRICE, PRODUCTRICE
KDO: Je suis dans l’atelier studio de Fatou Kandé Sen- ghor, qui a fait partie de ces jeunes réalisatrices pétries de vidéo clips qui connaissent très bien l’impact de la musique sur les images. Née le 09 Janvier, 1971 à Dakar, au Sénégal, Fatoumata Bintou KANDE a fondé un e plateforme de recherche artistique nommée Waru Studio à Dakar qui fonctionne comme un laboratoire d’expérimentation – Art- science-technologie – Ecolo- gie et Politique du changement. Nous allons faire un entretien sur la formation à la production et à la dis tribution du documentaire, très brièvement, je vais lui demander son point de vue sur les problèmes de formation concernant le documentaire. Je sais qu’il y a plusieurs courants, qu’il y a différentes écoles et que les gens ne sont pas toujours d’accord, j’aimerais avoir son point de vue là-dessus.
FKS: Toutes les formations sont bonnes à prendre, quand on y réfléchit. Quand il n’y a pas d’école formelle, on a l’opportunité parfois d’avoir des stages mais malheu- reusement venant de l’extérieur. Je dis malheureuse- ment, parce que chaque peuple a une manière de narrer différente. Quand l’histoire est bonne et qu’il y a une sensibilité assez forte, originale, que l’histoire que l’on a à raconter est bonne, il faut une méthode de restitution qui ne soit pas une recette de pizza, ou un truc qu’on peut reproduire partout. Le film chinois, le film japonais ont leurs particularités, et personne ne va changer cela.
Même le film moderne japonais a ses particularités. Et quand le film arrive à nous, on se dit waaw! C’est une autre manière de raconter, parce que même si les his- toires peuvent être universelles, quand on a une sorte de formatage, comme ça arrive aux jeunes africains qui n’ont pas pu se former localement, et qui prennent ça à la lettre, et qu’ils le réappliquent de cette manière, on voit tout de suite que c’est du copié collé, que c’est pas intéressant et que ça n’a pas d’âme en fait.
KDO: Il y a une déperdition?
FKS: Complètement, parce que chez nous, dans le transfert de connaissance, dans le transfert d’histoires, on ne parle pas beaucoup, au fond, parce que tu es dans un rapport avec tes aînés, de connaisseur à d’apprenti. Parfois l’apprenti reste tellement longtemps apprenti, qu’on se dit « Mais quand est-ce qu’il va voler de ses propres ailes? » Chez les japonais, aussi, on reste un apprenti longtemps, et on est bon, et ce n’est pas que l’apprenti soit toujours dans une position d’infériorité, c’est que l’apprenti devient la béquille du maître, et la béquille du maître, ce n’est pas une position d’infériorité, au contraire, parce que sans la béquille, le maître ne fonctionne pas. Le Maître est amené à partir et on devient l’héritier, on devient le fils, donc on continue de faire vivre le maître. C’est un rapport humain qui est très particulier, et par conséquent dans la narration d’une histoire du fin fond du Fouta, où il y a du vent, où il y a du souffle, où il y a des sons, où il y a des senteurs, des couleurs, on ne peut pas transgresser ces lois-là, et arriver dans une histoire, gros plan, moitié plan, et avoir tout de suite un découpage technique, parce qu’on se perd. Et les formations qui arrivent en Afrique, sont de courte durée et elle sont corrigées. Il y a un business plan, voilà à quoi ça ressemble, voilà où on est censé aller, et donc il n’ y a pas de place pour la création, à mon humble avis. n’est pas toujours une main sincère, n’est pas toujours une main généreuse, c’est une main avec un objectif chiffré, de journées de budget, surtout que tout de suite il y a la machine de production qui se met en branle.
Ces jeunes que j’ai vu formés et mis dans des produc- tions, qui ont produit des films – ce n’est pas la qualité qui est la question – mais ils se sont souvent arrêtés à ce seul film-là.
KDO: Parce qu’en terme de production, il n’y a pas eu de suivi?
FKS: Il n’y a pas de suivi. Pour avoir fait partie d’une expérience où on nous flanquait avec des producteurs étrangers qui avaient très bien compris qu’il fallait leurs signatures pour qu’on sorte 30 000 ou 40 000 euros, et qui n’ont pas fait leur part. Et puis quand ils l’ont faite, ils l’ont mise dans leur caisse, parce que de toute façon, la production, c’est un business, pas de pitié! Donc, j’ai compris, que la formation, c’est faire la courte échelle, on aide ces jeunes à faire le premier pas. Maintenant, s’ils sont doués, ils vont arriver à la suite, ils vont rentrer dans le rang. Sinon, on ne les entendra plus, et puis après tranquille! Mais toutes ces personnes qui ont des catalogues de films, qui leur appartiennent, qui ne sont pas la propriété des gens formés, je demande à voir leur deuxième film. Et jusqu’à présent, je ne vois pas les deuxièmes films arriver.
KDO: Et pourtant, il me semble que l’énergie qui a été mise à produire un catalogue de films, cette énergie aurait pu être mise aussi dans la formation; et la tenta- tive de faire localement des coproductions Sud-Sud, et de trouver des partenariats à l’intérieur du continent. Peut-être un système de production différente, nous ne sommes pas en Europe, où effectivement, il y a des guichets et on obtient de l’argent quasi gratuitement, en tous cas non remboursable. Je pense qu’aujourd’hui, sur le continent africain, nous avons les moyens financiers. Il y a des entreprises qui vivent sur le continent et il y a des possibilités de trouver des systèmes à la fois de mécénat et de partenariat, tout en faisant aussi du busi- ness avec des sociétés qui existent sur le continent, et en étudiant les moyens de faire des coproductions Sud-Sud. Donc je pense qu’il y a moyen de faire à la fois de la for- mation, d’instaurer un système de production sur place, et un système de distribution.
FKS: C’est le péché capital, de toute notre organisation. Le mécénat local, ne peut être mis en branle que si il y a une dynamique locale. Toutes les formations dont j’ai parlé qui gravitent autour du Sénégal, et d’autres pays, et qui reviennent régulièrement, sont étrangères. Qu’est ce que fait le local? C’est une question de sou- veraineté nationale, on n’y peut rien. C’est un gouverne- ment, à travers un Ministère, ou un bureau ou whatever, qui structure tout ça, et qui invite les protagonistes à dire « OK, maintenant, on organise! » Et son association de cinéma, qu’elle soit des aînés, des milieux, des derniers, ça aussi c’est une organisation particulière, qui s’assoit à une table, et qui dit « Ok, on prélève une taxe, sur quoi?» On avait toujours dit qu’il y avait des taxes sur l’alcool ou je ne sais pas trop quoi, qui était reversée à la culture, c’est dans l’idée générale. Tout le monde se plaint. On ne sait pas si cela existe vraiment, et on ne va pas jusqu’au bout des tables de discussions, parce que nos Etats sont tellement politisés, qu’ils n’ont pas une compréhension claire de la culture, encore moins du domaine du cinéma. Vraiment je trouve que le cinéma souffre d’un problème de compréhension très sévère. Parce que tout ce qui est l’art contemporain, qui s’exporte, qui fonctionne, c’est parce qu’il s’agit d’individus, tous seuls, mais ce cinéma là, ce documentaire, on est obligé de l’organiser. Il ne peut pas fonctionner tout seul. Et donc, on n’a personne qui y croie, et qui soit assez puissant, intellectuellement, financièrement et relationnellement, pour inviter les gens à une table et dire « Ok, maintenant, la formation, on sait ce que c’est, n’importe qui ici, qui a une certaine indépendance de production, que ce soit Moussa Sene Absa, Mansour Sora Wade, n’importe qui peut être formateur à un moment donné, avec un minimum de budget. Et un minimum de budget, dans ce pays, ça existe. Qui va créer cette caisse là? C’est justement ce carnet d’adresses là où on pourra convaincre les gens de mettre de l’argent. C’est ce rassemblement de deniers qui pose toujours un problème, parce qu’il y a toujours un problème pour l’argent, et cette personne qui va rameu- ter tout le monde. Donc on a un problème de Human ressources. Dans la musique, on avait Mamadou Conté qui était cet espèce de mec, 1,90m, qui avait sillonné le monde, et qui, quand il parlait dans une salle, on avait peur de se retourner. Qui pouvait dire les choses, qui avait un espace, qui avait produit des vieux, des jeunes, du traditionnel, du moderne et Mamadou Conté était un homme que tout le monde adorait, il était fêté et respec- té, et nous on n’a pas eu de Mamadou Conté. Dans le ci- néma, on a eu des gens très versatiles, très individualistes, très auteurs à la française, qui réfléchissent avec les potes de Paris, en groupe, c’est l’époque des “Deux Magots”, c’est l’époque derrière Douta Seck, tu vois, on était des Blacks à Paris. Ca me rappelle “La Grande Bouffe”. On est dans le film de Truffaut, tous là, et avec eux, on ne peut rien faire, et en plus, ils ont bouché le système, parce qu’ils parlent, ils s’expriment, tu vois? Ils étalent leurs connaissances, blablablabla, et ils font rien avancer. Et ce sont ces gens là, qu’on aurait dû canaliser, d’une certaine manière qu’ils n’amènent que des contenus, que des plus jeunes aimeraient entendre, parce que ce sont des récits de vie fantastiques, mais ils ne peuvent rien organiser, parce qu’il faut qu’ils l’acceptent. Parce qu’ils veulent être de toutes les tables, de toutes les discussions, ils refusent qu’on les évince, mais ils ne sont pas capables d’amener quelque chose de concret à la table parce que ce n’est pas leur moment. Ce sont des gens à organiser, maintenant, s’ils sont organisateurs, ils ont des formations particu- lières, ils n’ont même pas besoin de connaître la créativité, vraiment, ils peuvent aller vendre du riz le lendemain. C’est cette roue, là, qui manque…
KDO: Un genre de management, culturel efficace, si j’ai bien compris – je pense qu’on partage le même point de vue de ce côté là. Il manque des personnes ressources qui aient des capacités de mettre en liaison les gens du cinéma d’auteur, et des gens qui soient capables de mettre en rela- tion ces gens-là, avec le monde – à la fois de la télévision – à la fois des grandes sociétés et entreprises qui pourraient participer. Et qui favoriseraient en même temps une collaboration, par exemple, entre le ministère de la communication, et le ministère de la culture, parce que là aussi, je trouve que – de mon point de vue -, il y a un paradoxe et quelque chose d’antinomique lorsqu’on voit la scission entre le monde cinématographique, qui appartient au monde de la culture, et le monde de la télévision qui appartient au ministère de la communication. On se retrouve dans des situations où il y a très peu de coproductions entre la télévi- sion nationale et le cinéma d’auteur.
FKS: Ça ne s’explique pas, ça prouve encore une fois qu’on ne réfléchit même pas à la chose, les Etats sont politisés – on y revient – l’artiste est un griot, quelle que soit sa discipline. En 2012, l’Etat a sa série d’artistes. On choisit, dans chaque discipline, un gars qui ne va pas nous emmerder vraiment, qui sera de tous les voyages, de toutes les réunions, pour avoir une couleur locale par département, mais de quoi est-ce qu’on va discuter avec lui? Si ce n’est pas quelqu’un qui a une vision et une connaissance particulière du métier, de l’avenir, et justement du management. Un artiste ne peut pas arrêter sa carrière et tous ses inté- rêts et aller parler au nom des autres artistes, ce n’est pas vrai. On le fait aujourd’hui, parce qu’on est obligé de se battre en amont, sur le front, dans la résistance et on se dit en même temps, qu’on ne s’est pas battus pour que tout le monde rentre, et pas nous, donc le problème de confiance revient – je ne vais pas prendre 10 euros, pendant que je me bats pour que les autres en aient cent cinquante mille, juste par humilité, de faire partie du truc. L’Etat doit être plus clair, sur cette dichotomie là. Alors qu’il a permis à des télévisions de voir le jour, et qu’il voit bien qu’il y a un vide, qu’il y a une place à prendre.
KDO: Il ouvre les vannes très larges pour les chaînes de télévisions privées, alors qu’il n’y a aucun recensement ne serait-ce que des films qui existent aujourd’hui. Moi, je suis dans l’incapacité d’avoir une liste des films, docu- mentaires, courts métrages, longs métrages, exhaustive, du début du cinéma jusqu’à nos jours.
FKS: Parce qu’il n’y a pas de statuts non plus. Normale- ment, quand tu fais un film, tu dois être capable de le répertorier quelque part, ce doit être une étape obliga- toire. Au moins on sait quelle durée, quelle année. Et si nous n’avons pas de copie, qu’on en ait une trace, un scénario ou une lettre qui demande une autorisation.
Et ce n’est pas le cas. Parce qu’ils ne s’en occupent pas, ils n’en font pas un truc sévère comme en musique, où tu peux trouver tout cela. Le bureau des droits d’auteur est là, il est capable de te sortir tout cela, l’AMS, l’Association des Musiciens est très solide, mais chez nous, ce n’est pas possible.
Les guichets, la coopération, donc, française en particu- lier, y est pour beaucoup fautive, mais aussi encore une fois, leur compréhension de ce pays là, de l’Etat, de leur rôle dans ça. L’Etat est invité systématiquement à ou- vrir des cérémonies organisées par les autres. Les autres se substituent à son rôle tout le temps. Il est tranquille tant que les autres contribuent, comme cela ça garde tout le monde content, les artistes ne viennent pas vous emmerder, parce que de toute façon, il y a des blancs qui s’occupent d’eux.
KDO: On peut faire autre chose pendant ce temps.
FKS: On ne peut pas avoir tous les gosses qui tapent à notre porte « Aide-moi, je veux être stagiaire! » On ne peut pas! On n’a pas besoin de stagiaire! On embarque tout le monde, tout le temps. « Bon venez! Toi tu as une histoire? » Tu regardes les endroits d’où ils vien- nent, mais chacun a une histoire que tu seras incapable de filmer, parce que tu n’y as pas accès. Et il s’y révèle matin, midi et soir. C’est dans ton intérêt qu’il ait accès à ton matériel. Le matériel, ça a une vie, ça meurt. Ils font des projets, et ils ne demandent pas aux gens qui savent, ou sont très actifs, et productifs. On remonte toujours, vers ceux qui ont eu des possibilités, dans les grands guichets de faire des films. Maintenant, on va quand même s’intéresser à pouvoir leur donner de l’argent localement, pourquoi?? On sait qui ils sont, on sait comment ils vivent, comment sont leurs produc- tions, on est sur leurs films. Et dans chacun de leur long métrage, ils auraient dû obligatoirement produire dans la foulée, pendant qu’il y avait du matériel, pen- dant qu’il y avait des techniciens, un petit film de six minutes, de dix minutes, de vingt minutes d’un jeune qui monte. Ce n’est pas à eux qu’on va apprendre ça, dans toutes les maisons africaines, ton boubou, tu le mets une année, l’année suivante c’est ton frère qui le met. Donc cet égoïsme et cette rupture, je me pose la question tous les jours « D’où ça vient? »
KDO: Oui, j’ai entendu cela.
FKS: Non, mais on arrête là! Et, eux ils étaient où, pen- dant ce temps là? Association dirigée ou non?
KDO: Ils ont laissé faire.
FKS: Ils ont laissé faire, parce qu’ils ne pensent qu’à eux. J’étais au Panaf, à Alger, au Panaf, les Sénégalais se sont sentis évincés, par rapport à la festman qui ne démarrait pas. Ils n’ont même pas géré cela, tous les billets venaient d’Alger, il y avait plus de fonction- naires qui ont voyagé que n’importe qui! Il y avait plus de gens d’une certaine génération, il y avait tous les fonctionnaires mourants! Trois semaines à l’hôtel, à bouffer gratuitement, aux frais de l’Algérie! C’était n’importe quoi! Et pour moi, voilà la photo dont on ne se défera jamais, et ça fait mal, on est obligé d’avoir des initiatives privées.
KDO: Toi, tu as pu y aller?
FKS: Ils m’ont invitée pour montrer mes films, et le Panaf, s’est organisé de manière très particulière, parce que les invitations sont parties à tout va. Et il y a eu beaucoup de cas où les gens ont été invités à des événe- ments qui n’étaient pas très existants dans ces parties du monde. Donc nos familles ont toujours peur de là où on va. J’ai un peu ignoré l’invite. Pour moi c’était un peu comme une affiche, qui arrivait régulièrement dans ma boîte mail, j’ai pas percuté. A l’époque j’étais dans un village des arts, où justement, ma discipline, le cinéma et la vidéo, n’était pas en challenge avec qui que ce soit, donc je me suis dit, dans les arts plastiques, ce village, je peux essayer de leur apporter du mouvement, au moins, qu’ils comprennent que les jeunes ne sont pas un danger. Erreur, c’est la mentalité du pays. J’ai fait neuf mois au village des arts, accouché d’un gamin, baigné ce gamin là, dans mon atelier, fait vivre ce gamin là, dans cet atelier, dans cet environnement paludéen, en organisant quelque chose tous les mois, avec des copains imprimeurs qui suivaient les affiches, même pour l’exposition du mois local où il y avait toujours les travaux des gens. Mais ce qui les intéressait, c’était que des blancs viennent acheter des trucs et repartent. Les workshops, les trucs, tu as toute la dynamique pour créer quelque chose, pourquoi tel et pas moi, pourquoi je ne suis pas dans le coup, voilà. L’ego, l’ego trip qui était toujours étalé, je me suis dit, on ne va pas s’en sortir! Et puis, Fatou, qu’est-ce que tu pensais? Le vil- lage des arts, c’est le microcosme du village Sénégal, il y a des gens de cultures différentes, il y a des imposteurs, il y a des gens qui copient les tableaux des autres, il y a des gens qui n’ont que cet atelier pour vivre, et moi j’essayais en plus, qu’ils sortent au bout d’un moment pour avoir du sang frais, non, je faisais tout faux, moi. J’avais un planning digne du village des arts du Dane- mark. Je prenais des idées partout…
KDO: Ça ne pouvait pas fonctionner…
FKS: Ça ne pouvait pas fonctionner. Ils sont là depuis dix ans, pour eux ils se sont battus, il faudrait même qu’on leur aménage des trucs, pour qu’ils construisent et qu’ils y restent à vie! Attention, ils ne sortent pas en se disant qu’un président, un jour va venir leur don- ner, parce que c’est la logique de bourbi, le roi, il donne tout le temps. Abdoulaye Wade, qu’est-ce qu’il n’a pas donné? Mais je découvre la mentalité, et je découvre que plus on travaille, et plus en se fait tirer dessus.
KDO: Et plus on a de nouvelles idées et plus on se fait détester.
FKS: Absolument! Je dis Ok, les artistes là, j’ai organisé ma relève, à la veille d’une visite du premier ministre canadien, qui est une dame, d’origine haïtienne, qui m’aimait bien, qui avait beaucoup d’estime pour moi, qu’est-ce qu’elle n’aurait pas fait, pour soutenir une femme, féministe, journaliste… Pour te dire, ils sont allés à ce niveau là. A se dire, non, this is too much, ça va peut-être enlever des choses mais ça va la mettre en lumière. Mais bon sang, le manager… Je ne peins pas, moi, je suis la seule à faire de la vidéo et de la photo, j’ai une documentation, des caisses pleines de cassettes, des morts, des vivants, j’ai des photos de tous leur tableaux, toute la base de données d’une certaine création séné- galaise, c’est moi qui l’ai, depuis vingt ans. Alors, j’ai compris, je me suis dit “ Ça, même dans le cinéma, ils ne l’ont pas. Je me suis positionné ensuite dans le docu- mentaire et la vidéo d’art, en me disant “Je produis les miens !” Je produis ceux de tous ces petits gars, là, qui circulent, pour qu’ils aient quelque chose dans la main, je m’organise pour que dans leur tête aussi, ils com- prennent où prendre l’argent, quoi en faire quand ça arrive, pourquoi, comment, et si c’est ce qu’on a choisi de faire, voilà le trajet. Voilà comment discuter avec les grands, ils faut aller à leurs événements, il faut se taire et écouter, et comprendre la dynamique. Et pour moi, ça a marché, ils ont compris quand ils vont dans tous ces événements mais qui fait quoi? Quatre films dans ta vie, ça fait de toi quelqu’un qui peut emmerder tout le monde? Alors que tu vois, les gars qui sont dans l’institutionnel, donc ils gagnent de l’argent, le film institutionnel a du budget, dans l’année, ils font énor- mément de films, ils soutiennent des familles, ils sont plus aptes à cotiser, dans ce pays, en impôts en trucs, que n’importe quel grand nom, ici, qui serait allé à Ber- lin, à Cannes où je ne sais pas où, faire de la figuration. Alors, ce mépris, là, on comble ça comment? Mainten- ant, il y a encore mieux, c’est que toute la gamme de monteurs ou d’assistants aussi qu’on a formés, qui est montée, qui travaillent dans les télés, ils ont envie de mettre leur nom à la télé! Ils font du soap opéra, ils font du brésilien, du mexicain, amélioré, parce qu’ils n’ont pas les querelles de bonnes femmes, là, mais, ils mettent du peps dans leur films et il y a une génération de jeunes acteurs, et d’actrices qui font tomber le haut, donc il y a du mouvement, il y a une gamme de manne- quins, complètement disjonctées, tu leur donnes un gun dans la main, elle tournent sans complexes, elles te font un 100 mètres dans la rue, à courir derrière quelqu’un et toute la ville se retourne! Ce que nous on arrivait pas à faire avec les grands, sur les plateaux de Sembène Ousmane, ou quand ils s’acharnaient sur des acteurs, les acteurs disaient “Moi je suis un personnage public, oui on est dans la rue, je peux pas jouer telle chose!” Donc ces gens là qui arrivent, on va en faire quoi? On va se bloquer, on a les mêmes problèmes dans nos amis, dans nos couples, et dans notre travail créatif. On n’est pas sortis de l’auberge. Après, il faut se parer contre nos ennemis, qui sont nos propres politiques, les politiciens et puis la coopération. La substitution à nos choses, ou mieux, à un moment donné, bon, on sélectionnait quelqu’un dans la rue, voilà, tout était en copinage. Mais mieux maintenant, la France a des débordements de techniciens, faut descendre les gars, toute la pub aus- si, elle est gérée par des français, oui quand tu n’a pas ton blanc pour faire ton film, ta série, ton machin, ton shoot, et bien non, chez les photographes, c’est comme ça. Donc on est encerclés.
KDO: Revenons un peu sur les problèmes de production pure de documentaires. Par exemple, vous, avec votre société de production, où vous trouvez des partenaires et quels sont-ils pour produire un documentaire ici, au Sénégal?
FKS: Au niveau local, depuis quelques années, deux ou trois ans, depuis que la mairie est passée dans l’autre camp, en fait, il me semble que c’est la seule initia- tive locale qui offre de l’argent pour faire des choses. Les budgets ne sont pas géniaux, mais encore une fois, avec du pas génial, on fait du génial. On n’est pas des Africains pour rien. Mais sinon, il n’y a rien, le mécé- nat n’y croit pas, et c’est une question d’accès aussi, parce que c’est très francophone, les accès, tu vois, c’est des étages… Ce n’est pas le sens contraire où les gens descendent à vous, parce qu’ils aiment bien ce que vous faites, vous devez vous frayer des passages dans leurs soirées dans leurs trucs. Tu vois, il y a un travail mar- keting à faire pour l’ascension, et pas un travail de créa- tion qui fait que les gens descendent vers vous… pour le documentaire, franchement il n’y a rien, nous on s’est positionnés dans le film institutionnel, et on a décidé ce qui ferait bouillir nos marmites, et ce qui de l’autre côté irait dans notre production. C’est comme ça qu’on fait des documentaires. Maintenant quand les docu- mentaires quand ils sont assez bien faits, et qu’on arrive à faire des ventes, TV5 chez les francophones, Arte, et chez les anglophones BBC, ou Al Jazeera? Al Jazeera, c’est plus difficile, parce qu’ils ont une habitude c’est le documentaire un peu tu vois, d’investigation, etc, qui n’est pas un style francophone, il n’est pas le “style” que l’on apprend dans toutes ces formations là, parce que il y a une base journalistique très forte, et avec des com- pétences que les gens qui sont cooptés pour être formés n’ont pas.
Donc il y a un problème de niveau. Le documentaire, ce n’est pas de la fiction, le documentaire requière d’autres capacités intellectuelles en toi…
KDO: Et puis il y a plusieurs courants de documentaires.
FKS: Et même chez les aînés qui se sont essayés au docu- mentaire, quand on voit leur documentaire, on sait qu’ils ne sont pas compétents en la matière. Cette légèreté, ne peut pas fonctionner, c’est redondant, il y a des choses qu’ils aiment bien dans leur fiction. Dans une fiction, il y a des traces, des signatures que quand tu les retrouves dans le documentaire, il faut arrêter, là. Donc, on sait qui est qui, et qui est capable de faire quoi. Mais l’école documen- taire, à Dakar, elle souffre, parce qu’on peut compter sur les doigts qui en fait, et qui en fait de bons qui tiennent la route. On n’est pas en fiction, le style peut être semi- fiction, etc, parce qu’on touche à tout, toutes les méthodes pour faire du documentaire, mais le fond, le propos, dans le fouillis il y a encore du chemin à faire. Ils refusent d’accepter, parce qu’ils confondent intellectualité, acadé- mie, tous les complexes sont là “Ah moi je suis autodidacte!” La notion d’autodidacte, tu vois ils nous cassent les pattes avec ça, un autodidacte a une tête comme tout le monde, ça ne l’empêche pas de descendre au fond et savoir ce qu’il faut. Mais le documentaire de nos télés, le report- age, il faut qu’ils admettent le style, c’est des magazines, on ne dit pas que c’est mauvais, au contraire.
KDO: Comment envisagez-vous en tant que société de production documentaire, et fiction, aujourd’hui, en partant du constat qu’il n’y a quasiment pas de salles de cinéma, aujourd’hui au niveau national, avec une absence étatique vis à vis de la distribution, de film documentaire ou fiction, si on envisageait les possibilités de créer un nouveau système de distribution, pour aller vers des auditeurs, vers une audience. Comment peut-on créer, ou envisager de créer d’avoir des relèves en audi- ence, pour d’éventuelles salles de cinéma ou d’éventuels lieux publics pour faire des projections de films. Parce que si on fait des films, c’est pour aller vers les spectateurs. Nous nous rendons compte qu’il n’y a pas de lieux. Alors, que peut-on imaginer, en étant optimiste, que pouvons nous imaginer comme possibilité de diffusion, au niveau des documentaires?
FKS: L’Etat a construit des centres culturels régionaux dans les quatorze régions, je ne parlerai pas de Dakar, parce que pour moi, il y a d’autres sources pour Dakar. D’autres plateformes de rencontres, mais pour moi, les centres culturels régionaux sont d’une importance capitale, parce qu’on y trouve la musique, la danse, la lecture, tout y est, et que justement, on ne peut pas badiner avec ça. Il y a du matériel, dans la liste des matériels déposés dans chaque centre culturel. Il y a un superbe télé-projecteur, avec du son, donc ça devrait être possible d’y envoyer systématiquement des coffrets, dont les droits sont acquis auprès des jeunes qui font de la production, des vieux des jeunes, mais donc il y a moyen d’avoir des séances régulières, où les films vont rencontrer un public, de toute façon. Dans ces zones là, le centre est le poumon, tout le monde vient, tout le temps, quand il y a un événement il y des espaces qui sont destinés aux mariages, et aux célébra- tions de la communauté.
KDO: Donc, vous pensez que l’on peut utiliser ces salles là, ces platesformes?
FKS: Absolument, elles sont équipées pour. Il faut que les techniciens soient formés pour utiliser correcte- ment le matériel. Et les fonctionnaires qui gèrent ces centres là, ils soient triés sur le volet, des gens qui ont étudié aux Beaux Arts, qui ont choisi comme branche le management culturel, quelque part. Donc c’est au niveau de la formation, qu’il y a un problème. Il faut de l’engouement, il faut de la passion, etc., et ce n’est pas le cas pour la moitié d’entre eux, franchement.
Qu’il n’aient pas à se battre pour remonter sur Dakar, quand ils sont au fin fond de Matam, ou que les choses arrivent à eux, quand ils reviennent pour une réunion d’évaluation. Ils repartent avec tout, ils ont des véhi- cules, des chaises, il y a tout, dans ces centres là. Et qu’ils aient la possibilité d’avoir des formations, nous on l’a fait, on a montré des expositions on a formé des gens, mais ce sont des initiatives personnelles. On les a contactés directement, parce que, comme j’ai dit, ils sortent des écoles, on les connais. Quand ils arrivent à accéder à ce type de poste-là. Mais c’est long. C’est l’Etat! Ok tu as un centre, boum! Voilà la liste, voilà ce à quoi tu as droit, fais nous ta programmation, parce que tu travailles avec le local, tu ne fais pas venir tes orchestres de Dakar ou de je ne sais pas où, mais dans l’année tu sais que tu auras un choix d’orchestre bien connu, qu’on voit à la télévision. Et qu’ensuite que tu auras tous les jeunes et tous les ateliers. Mais il y a un programme à mettre en place, qui nécessite quasi- ment rien, tout est sur place. Et le cinéma, on reçoit la matière, ça dynamise le tout, et la relation commence à être concrète parce qu’il y a des espaces pour montrer. Cela c’est au niveau étatique, avec des espaces qui ex- istent. Parce que ces centres, ils sont construits, ce sont de vrais bâtiments, avec des esplanades avec un restaurant qui fonctionne, avec du mouvement le soir, c’est les restaurants, c’est le café, l’orchestre local qui joue, c’est la vie, tu vois?
Et à Tambacounda, quand tu vas au cinéma, c’est ma- man, le bébé, c’est tout le monde. On met la natte, les gamins dorment, quand on a fini, on emballe tout le monde et puis on repart. C’est tous publics, tu imag- ines là, la notion de connaissance qui circule, à tous les niveaux, ça c’est un idéal. Les platesformes des capital- es, le Hip Hop s’est débrouillé tout seul, il est présent, et il a de grands rendez-vous. Les platesformes sont là, avant le concert, on peut regarder un documentaire, les gens ils arrivent dès 19 heures, les vedettes pas avant minuit, on peut projeter toute la journée parce que maintenant il y a du VGing et les scènes passent des images en même temps.
INTERVIEW DE JEAN-MARIE BARBE
CREATEUR D’AFRICADOC
KDO: Nous sommes à Saint-Louis et je suis à la rési- dence de l’Université Gaston Berger, en présence de Jean-Marie Barbe qui est le créateur d’AfricaDoc. Donc je vais converser avec lui pour faire le point sur l’état des lieux du documentaire en Afrique en général et par rapport à tout travail qui a été fait avec AfricaDoc et aussi la difficulté de ce qu’il a évoqué hie en ce qui concerne les achats de documentaires globalement par les chaînes de télévision africaine et aussi l’absence de participation des gouvernements sur la participation de coproduction de films, tout dans le domaine du documentaire.
JMB: Oui, je vais peut être aller hyper vite sur l’histoire de la fondation AfricaDoc mais en gros si tu veux, il y a eu un concours de circonstances. Il y a eu une invitation qui m’a été faite parce que je m’occupais en 2000 des états généraux du documentaire à LUSSAS. Une fille passe pendant les états généraux et ensuite elle est à Dakar sur un poste d’un an. Elle va travailler au Centre Culturel. Donc elle m’invite avec François Belorgey pour venir montrer des films des états gé- néraux. Moi, j’accepte parce que, à ce moment là, on est dans une crise entre la télévision et la diffusion de documentaires de création de chez nous, il y a un divorce, selon moi, entre la télévision et le documen- taire de création. En gros la télé a décidé de manière définitive que la question de l’art ne l’intéressait pas et ce qui l’intéressait c’était de faire des objets de com- munications efficaces et des films dossiers efficaces. Et il fallait que ces films répondent aux attentes supposées d’un public. Et la règle de l’audimat et de médiamét- rie dominent. Ce qui fait que toutes les illusions que nous avions au début des années 90 de la télévision comme partenaire,comme troisième partenaire d’un film l’auteur, le producteur et le producteur télé, tout ça s’est envolé. Bien sûr, il faut de la résistance, bien sûr les gens vont se battre, mais le salut est ailleurs et il faut anticiper sur leurs télévisions en ce qui concerne le doc- umentaire de création. Je passe sur tout ce que ça impli- que. Et du coup donc, là c’est un moment charnière de ma vie. Je me dis que pour le documentaire de création, avec la révolution du numérique, l’outil n’appartient plus au Nord, il appartient à tout le monde. Il s’est allégé considérablement donc ce qui était l’apanage du Nord – et d’une certaine manière un pouvoir néo-colonial – même si on peut l’appeler autrement – ça c’est fini et si c’est fini, on peut maintenant apprendre à faire du cinéma et faire du cinéma partout dans le monde sans la barrière de la technique. Mais par contre, il y a la barrière de la compétence. Il faut donc qu’on transmette ce qu’on a appris avec l’idée qu’au delà des frontières et des nations il y a une espèce d’humanité, qu’il y a des besoins fondamentaux communs, et qu’on arrive dans des sociétés où l’image est le vecteur de la pensée et le vecteur de la connaissance. Il faut absolu- ment que toutes les sociétés du monde puissent prendre en main le récit de leur existence par le film, voilà. Et le film documentaire qui est le cinéma de la mémoire et qui est le cinéma de l’altérité doit être au cœur de ça, et du coup, partant de là, le cinéma c’est la pensée. Mais il n’y a pas de raison, on va aller là où c’est le plus difficile, là où il n’y a rien, plus rien quasiment à part un copain Samba Félix Ndiaye, ou Jean Marie Teno.
Il n’y a quasiment rien en terme de production docu- mentaire. Allons voir si on peut faire quelque chose, si, à partir des compétences qu’on a, on peut transmettre un certain nombre de choses pour que les gens devi- ennent autonomes, pour que naissent une génération de documentaristes et une industrie de l’audiovisuel indépendante avec laquelle on travaillera. On tra- vaillera avec un ami au Canada, un ami en Chine, un ami voilà, puisque les banques, l’économie n’ont pas de frontière, il n’y a pas d’horizons, l’art n’en parlons plus. Il faut arriver à être dans le monde. Donc ça c’est le point de vue politique qui structure la démarche. Et il y a dix ans, de manière un peu empirique avec les outils expérimentés en France au niveau de Jacques Bidou, on a mis en place Eurodoc. Par l’intermédiaire d’Eurodoc on a produit en région pendant quatre ans, on a formé les producteurs etc. Par ailleurs j’ai mis en place avec des collègues de LUSSAS des résidences d’écritures, un master avec l’Université de Grenoble, un festival, une histoire, une compétence. Il n’y a pas de raison qu’on n’aille par rechercher ces outils là ail- leurs dans le monde. Voilà, de manière schématique et évidemment un peu simpliste, le parcours! Ensuite ta question est sur la production. C’est à dire comment faire pour qu’un tissu de producteurs indépendants naissent dans des pays du Sud qui, au demeurant, n’ont pas d’économie disponible et pas d’histoire et pas de formation parce que pas de formateurs. Donc sur la production, on a très vite vu – les collègues qui sont autour de la table Gora et Sellou pourront témoigner – que les producteurs qu’on rassemblait chaque année, sé- négalais mais aussi de quelques autres pays rassemblés à Gorée, étaient incompétents pour ce qui est de produire des documentaires. Ils étaient dans une autre logique culturelle et parfois uniquement dans le business et souvent dans la malhonnêteté, des voyous etc. Donc finalement il n’y avait rien à faire avec les producteurs sur place, quand ils existaient. Pour différentes raisons – tout le monde n’est pas voyou évidemment. De manière empirique on s’est dit « On rassemble, parce que c’est ça la méthode, tout est fondé sur la formation à Afri- caDoc, former, former, former, former ». Former des gens qui vont créer des relations, organiser des filières, organiser un réseau et à la base, former, transmettre, former, dès qu’on sait quelque chose, on le transmet voilà et c’est ça qui va faire leur puissance. Parce que tu vois, eux, ils n’ont même pas dix ans d’expérience professionnelle et ils sont tous les deux dans la forma- tion. Alors évidemment c’est aussi pour gagner sa vie mais parce qu’on sait que c’est par là que le réseau va se constituer et que c’est à plusieurs que la chose se bâtira. On ne fera pas quelque chose seul. Les aînés ont fait des choses seuls parce qu’ils n’avaient pas le choix, in- dustriel, historique et politique et ils sont morts de ça. Maintenant que l’outil est ici, on peut et on doit faire des choses à plusieurs. Donc la production, les pro- ducteurs, il n’y en avait pas, on s’est dit on met en place des résidences d’écriture. Premier acte de la formation c’est à dire partir du désir des jeunes gens; qu’est-ce que j’ai envie de raconter, de ma vie, de mon voisin, de mon pays; quelle colère j’ai en moi, quel cinéma pourrait m’aide à raconter, à exprimer. Pendant quinze jours on voit des films, c’est collectif, qui embrassent des gens de différents pays, parce qu’au fond – c’est ce que je n’ai pas dit dans l’introduction – l’idée ce n’est pas de venir ici seulement avec cette idée internationaliste, c’est de reprendre les thèmes et les thèses des aînés dans ce qu’il y avait d’essentiel. Et l’essentiel c’était le panafricanisme et l’idée que les peuples ont accédé à l’indépendance, et en accédant à l’indépendance, ils doivent accéder à la représentation de ce qu’ils sont. Et pas y accéder de manière nationaliste mais accéder au de là même des ethnies, au de là des frontières natio- nales sur des principes de civilisations communes et donc le panafricanisme est né d’une conscience continentale, d’une conscience politique. Donc cet axe là, il est au cœur d’AfricaDoc, que ça c’est leur héritage et c’est aussi l’héritage mondial, c’est qu’il y a une pensée remarquable et quand il y a une pensée remarquable il est du devoir, du besoin ou du désir de chacun de l’accompagner, de l’admirer voilà. Qui n’admire pas Mandela, qui n’admire pas les grands chefs historique, les Lumumba, les…enfin bon on ne va pas s’étendre la dessus mais… pareil les Gandhi, les etc. Donc il y a des figures du monde, et il y a des points de vue du monde qui sont admirables et qu’il faut entretenir et c’est un devoir international. Donc ça c’est la base politique.
De manière pratique, une résidence d’écriture quinze jours, douze résidents qui se retrouvent de cinq, six pays, qui sont là à partir d’un désir et on travaille leurs désirs, on les accompagne. Il y a deux coach pour douze personnes. De là naissent des projets plus accomplis qui constituent des scénarios documentaires. Et dans ces porteurs de films, il y a des gens qui ont déjà créé leur boîte pour produire leur propre film. Et bien comme ils sont en collectif, ils voient le copain d’à côté et ils travaillent sur le film du copain d’à côté. Parce que les résidences, c’est aussi ça, on se nourrit de la critique des uns et des autres. Il y a une démarche collective et indi- viduelle mais pas d’individualisme. L’individualisation est collective, donc à partir de ça, les gens émergent, voulant produire leur propre film, et ils ont encouragé à produire les films du copain, parce qu’il y a un intérêt artistique, et humain, et économique à produire l’autre. Et de là est né tout un tissu de producteurs bricolés, sans histoire, sans expérience mais avec une morale du métier. Et deuxième élément, un certain goût pour l’art, pour l’œuvre d’auteur, pour quelque chose qui transcende les clichés, les formes classiques. Raconter quelque chose qui n’a jamais été raconté, quoi. Partant de là bon! Les producteurs sont nés et ces producteurs, il y en a une quinzaine aujourd’hui sur la douzaine de pays avec lesquels on travaille beaucoup. A mon avis d’ici trois, quatre ans, il y en aura une trentaine. Donc le mouvement est en marche. Donc ça c’est du côté des producteurs. Mais il n’y a pas de production, d’œuvres d’artistes, d’œuvres audiovisuelles cinématographiques fussent elles non artistiques, sans trois maillons néces- saires auteur, réalisateur et technicien. Auteur maillé aux producteurs indépendants et ce couple là, ce mail- lage là, si un des deux maillons n’est pas, il n’y aura jamais de créations et jamais d’histoires audiovisuelles du cinéma dans aucun pays du monde. Et tu as beau avoir un enseignement brillant comme en Russie où on travaille en ce moment, ou au Kirghizstan ou en Géor- gie où il y a des universités qui apprennent le cinéma, il n’y a pas de producteurs indépendants. Des jeunes gens sont esseulés, les films n’aboutissent pas. Il n’y a pas de producteurs indépendants.
KDO: Il n’y a pas le couple producteur – réalisateur?
JMB: Il est indispensable, mais producteur indépen- dant, pas producteur dans des studios d’Etat comme c’est au Gabon, comme c’est en Arménie, comme ça a été dans beaucoup de Républiques. Et beaucoup d’Etats sont héritiers du fait que le cinéma est une affaire d’Etat et il faut un organisme d’Etat, genre CNCM pour produire des œuvres. Ça ne marche pas, ça marche mais dans des conditions très difficiles. Par contre, on sait que les producteurs indépendants avec des règles d’Etat et avec une exigence artistique, ça donne des œuvres, ça donne des techniciens, ça donne l’économie, ça donne l’art industrie. Ce maillage là, c’est le maillage de l’art et de l’industrie. Mais il y a un troisième maillon c’est la diffusion, la distribution.
Donc il faut ce troisième maillon, s’il n’y est pas, c’est difficile. Pour l’instant il n’y est pas. C’est difficile mais pas impossible si on est auteur-producteur on peut ar- river à terme à créer le tissu de distributeur-diffuseur. Ils sont dans cette problématique, comment faire naître aujourd’hui des diffuseurs-distributeurs sur le continent qui permettent deux choses d’une part aux peuples africains, aux populations de voir les films africains, et d’autre part de créer une économie qui alimente la production…
KDO: C’est ça qui manque.
JMB: Voilà. C’est ce qui manque. Sur le terrain, il n’y a quasiment plus de salles de cinéma. Moi, contraire- ment à Sellou, je pense que les salles de cinéma ont une fonction symbolique et mythique, et que l’art a besoin du symbolique et du mythique. Mais avoir des salles de cinéma dans les pays sauf que c’est du luxe, cela demande de gros investissements. Il faut cinq cent millions pour une salle de cinéma, vingt trois salles de cinéma correctes dans beaucoup de villes africaines.
Bon! Si l’UEMOA décidait je mets trois milliards pendant dix ans chaque année pour soutenir la création d’une salle par pays, et au bout de cinq ans ou dix ans, il y a dix salles par pays. On créera une habitude du public parce qu’on sait que partout dans le monde que se soit en Chine pays pauvre, que se soit aux Etats-Unis pays super riche que les populations vont au cinéma c’est l’art populaire par excellence. Donc il faut…
KDO: Ils ont été au cinéma…
JMB: Et ils y ont été, on le sait. Evidemment il n’y a pas de raison que les africains soient différents des autres peuples de ce point de vue là. Et ce type de rituel est un rituel symbolique et intéressant. Il crée du mythe et une communauté culturelle d’esprit, il crée de l’élévation, il est d’une certaine manière le pendant de l’église, du temple, de la mosquée et tout ça dans le champ des im- ages. Donc il est nécessaire d’avoir des salles de cinéma mais pas en ne programmant que des films hollywoodi- ens ou parce que la question de ce qu’on y montre est très importante aussi. Mais laissons ça de côté, ce n’est pas l’essentiel de la bagarre, il ne faut pas l’oublier.
L’autre élément c’est qu’il y a depuis maintenant une dizaine d’années des cinémas numériques ambulants qui se multiplient en Afrique. C’est une excellente idée, ils en sont à la deuxième étape de leur histoire. Au début ces pionniers, diffusaient des films d’ONG, d’abord pour exister en tant que technique de diffusion et aller dans les villages. Ils sont maintenant un groupe costaud, ils sont assez représentés. Toutes les haines et les attaques, les violences contre eux, des gens qui étaient contre, qui trouvaient que c’était de la gabégie, tout ça ne pèse plus. Ils ont gagné cette bagarre. Pas finie, on ne la gagne jamais totalement, mais comme nous, on ne peut plus rien contre eux. Parce qu’ils sont nés, ils ont grandi, ils en sont au stade de l’adolescence. Maintenant ils doivent passer au stade où ils génèrent une économie pour les ayants droits. C’est l’enjeu de ces deux, trois prochaines années, plus leur multiplica- tion, plus leur professionnalisation et tout. S’ils créent une économie, les ayants droits auront des sous et les peuples africains, les populations africaines prendront l’habitude de voir les choses pour lesquelles il faut payer un peu, où l’idée de gratuité n’est plus. Mais où l’idée de « on voit des choses payantes mais pas chères, qui nous font plaisir et qui nous font grandir et qui nous ouvrent sur le monde ». Donc ça c’est capital, c’est une grande réussite de l’Afrique, c’est une grande réussite et il y a une autre grande réussite qui est méprisée moi j’étais au Congo, il y a trois semaines. Je leur dis vous faites deux erreurs majeures, vous utilisez un point de vue occidental ou un de vue point élitiste qui n’est pas faux dans l’absolu mais qui est absurde et bête dans l’application sur le terrain. Vous méprisez les gens qui vendent les DVD à huit cent francs CFA dans la rue et ceux qui ont de petites télés pour montrer de la daube, mais qui réunissent des gens qui viennent voir ces daubes et qui s’entassent dans de petites pièces sur- chauffées, où il y a un peu de collectif, où on dispense sa solitude, où on est un peu enthousiasmé. Ça c’est un tissu qu’il ne faut pas tuer. C’est un tissu qu’il faut infiltrer, qu’il faut améliorer, fermenter en qualité…
KDO: Améliorer les conditions de diffusion et les condi- tions de projection.
JMB: Et la qualité et le film dedans. Et pour ça il faut que l’Etat et les professionnels jouent un rôle en amont et il y a des techniques. On a vu pour Brazzaville, com- ment on pouvait faire. Je ne vais pas pouvoir raconter maintenant, ça prendrait un quart d’heure. C’est passionnant, c’est comment on transforme quelque chose qui fait en gros la sous-culture mais qui est une initiative du peuple. C’est comme la Grameen Bank en économie, c’est le même principe, ne pas tuer une initiative du peuple, mais la faire grandir comme une pousse qui germe vers quelque chose qui va produire. Des choses intelligentes, des choses qui vont produire de l’économie, qui sont de l’initiative, qui sont de la vie mais qu’il faut amener vers quelque chose, d’intelligent, de brillant qui va nourrir le tissu audiovisuel et montrer les films africains. On doit pouvoir dans cinq, dix ans montrer tous les films africains de qualité dans tous ces réseaux et on doit gagner ce marché, on doit le gagner. C’est des bagarres mais il faut être malin, il faut avoir l’alliance de l’Etat sur un programme de cinq, dix ans, ce qui fait que vous deviendrez, c’est vous qui aliment- erez le marché noir. Il ne faut pas les brûler les trucs, il ne faut pas les tuer…
KDO: Et quelle est l’alliance de l’Etat en termes de documentaire, en terme de production au jour d’aujourd’hui sur le continent?
JMB: Alors, revenons voilà, je vous ai parlé du cinéma itinérant, je vous ai raconté d’autres choses sur les salles de cinéma, je vous ai raconté d’autres choses sur ces petits réseaux qui sont des réseaux médiocres en contenu mais qu’on peut utiliser, qu’on peut trans- former et ce sont des choses possibles. Maintenant pour terminer avec la diffusion-distribution, la télévi- sion, je ne parlerai pas de la VOD, je ne parlerai pas de l’édition des DVD qui sont très importantes, qu’il faut aider mais je n’en parlerai pas. La télévision, qu’est ce que nous avons expérimenté dans l’organisation du Louma pendant deux ans à Saint-Louis? Première hypothèse, nous nous sommes dits, on sélectionne les cent soixante films documentaires produits sur le continent de qualité qui doivent être montré dans les télévisions africaines. Sur les cent soixante, il y en a la moitié qui sont fait par les Africains et la moitié qui sont fait par des gens d’ailleurs mais qui ont des regards justes, donc des œuvres intéressantes pour l’Afrique.
Le regard des autres quand il est juste, il faut y aller. On en a besoin, il ne faut pas uniquement le regard des autres. C’est juste ça le problème de l’Afrique, il n’y a que le regard des autres. Donc sur ces cent soix- ante films, on a invité trente cinq télévisions, vingt d’Afrique, de partout. Lusophones, francophones et un peu anglophones. Mais beaucoup francophones, le reste c’était des expériences et on s’est aperçu à la fin qu’on avait mis les tarifs trop haut et qu’ils avaient tous vu des films en trois jours, ils visionnaient dans des box et venaient nous dire celui là me plaît, celui là me plaît. Ils avaient des choses comme ça, mais personne n’a acheté. Pourquoi? Parce qu’on n’était pas bon. On demandait trop, le tarif était trop élevé. Il était élevé parce qu’il ne faut pas perdre d’argent, c’est fait aussi pour dégager une économie. Mais on a compris, on a analysé et on s’est dit, l’an prochain, on invite moins et on va se débrouiller pour créer des tarifs où ils pourront acheter. Et on a fait une typologie des télévisions. Il y a trois types de télévisions des télévisions qui ont de l’argent (le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Cameroun) ce sont des gens qui peuvent payer un documentaire au moins 450 euros les cinquante deux minutes. En dessous de 450, c’est quand même prix plancher qu’on a étudié tout le monde perd de l’argent. Donc il faut un seuil où tout le monde va en gagner peu mais tout le monde en gagne. Et ce seuil, tu ne peux pas descendre en-dessous parce que si tu descends dessous, tu créerais une spirale de perte pour tout le monde. Il ne faut pas, c’est bête de vendre en dessous, c’est bête parce que tout le monde perd bien sûr. Mais il faut – on est économie et art – il ne faut jamais l’oublier, donc il faut que ça dégage une économie. Donc quatre cent cinquante euros, on s’est dit au Cameroun ils peuvent acheter, au Sénégal ils peuvent acheter, en Côte d’Ivoire ils peuvent acheter…
KDO: Au Gabon ils peuvent acheter…
JMB: Au Gabon ils peuvent acheter, oui, c’est sûr. Au Maroc ils peuvent acheter etc. Par contre au Mali, au Niger, en Guinée, en Centre Afrique et à Madagascar non quatre cent cinquante ça va leur faire trop, c’est à dire qu’ils peuvent acheter, pas au tarif, plutôt genre 200 euros.
Bien sûr, on ne peut pas faire une télé au minimum acceptable, si on n’a pas un minimum de moyens, mais bon! Ainsi va la vie. Donc typologie trois télés. Là on s’est dit comment faire? Et bien! On s’est dit cette an- née le Louma (un marché du documentaire africain) va expérimenter encore, et on espèrera que l’Europe nous donnera de l’argent pour trois ans après, et là, au delà de trois ans, on gagnera. Mais il nous faut du temps, mais on va expérimenter cette année. Donc on a dit au Séné- gal Ah! Vous voulez acheter, euh! Bon! Et bien est ce que vous seriez d’accord pour acheter des films, les mêmes que votre collègue du Niger et les mêmes que votre col- lègue du Mali si vous êtes d’accord sur les titres. On nous a dit pourquoi pas. Donc pendant les deux premiers jours du Louma, ils ont tous vu des films. Il y en avait cent vingt et ils ont vu des films et sont revenus dire, ça c’est bien, ça c’est bien et on leur a demandé de faire une liste en deux jours, de vingt, trente films. Et ils ont vu sou- vent des films qui étaient pareils parce que c’était le titre, c’était le thème qui les intéressait bon! On a demandé à Canal France International de se joindre au groupe et on a dit voilà, on se met en accord avec Canal France In- ternational, on leur dit vous en achetez dix que vous leur refilez puisqu’ils sont abonnés à vous et qu’ils payent un abonnement. Mais vous en prenez dix sur les vingt qu’ils ont choisis et eux, ils en prennent dix chacun. Le Sénégal qui a plus d’argent, on lui demande de mettre trois cent euros, le Niger qui n’a pas un rond on lui demande de mettre cent euros, et les autres, on leur demande, au Mali, de mettre cent cinquante ou deux cent euros, mutualisation des achats et vous avez l’exclusivité dans votre pays pendant dix huit mois pour passer ces films sur trois multidiffusions. Ça s’est passé et on a eu un achat qui, quand même, il y avait vingt films, ça faisait cinq cent euros chaque film donc deux fois cinq dix, ça faisait dix mille euros pour un achat de trois pays. Si on multiplie ça par des groupements d’achat comme ça, on a calculé qu’on pouvait en faire entre douze et vingt. On arrive à cent mille, deux cent mille euros de vente sur le continent en deux ans. Et avec deux cent mille euros de vente de films, vous remontez aux ayants droits, soixante pour cent, quarante pour cent est gardé par le Louma pour qu’il puisse organiser tout ça, se structurer, parce que c’est quand même un métier, il faut trouver les films. Les ayants droits vont toucher des sous, les producteurs, vont toucher des sous et les populations africaines voient les films et les télévisions africaines mettent de l’argent, les télévisions africaines peuvent dire nous nous avons les droits, nous les avons payés nous ne sommes plus dans l’illégalité, donc nous mettons en marche un système vertueux et un système économique. Et ça c’est impa- rable, ça marche…
KDO: Ça permet aux producteurs, aux réalisateurs de repartir sur des projets. Est-ce que ça fait démarrer un début de production?
JMB: L’expérience au bout de ce deuxième Louma c’est qu’il ne faut pas vingt films, mais il faut en proposer entre quarante et soixante de manière à ce que ça constitue une programmation hebdomadaire d’une télévision. Donc ça c’est la règle, vous leur en proposez soixante, parmi ces soixante, il y a trente à quarante films issus des ateliers de coproductions AfricaDoc. Et il y a vingt, trente films sélectionnés dans le meilleur de ce qui se fait ailleurs, et là dedans, vous proposez un bouquet par chaîne. La chaîne va choisir via le net, vous leur proposez en streaming, ils ont les films et vous leur proposez un abonnement. Vous leur dites on vous envoie via le net les soixante films. Vous pouvez les télécharger parce que vous avez un code d’accès, et vous payez annuellement pour les quarante deux films ou trente six si vous voulez trente six ou cinquante deux si vous en voulez cinquante deux, une somme qui est l’ordre de dix à quinze mille euros, voire vingt mille euros quand vous en prenez cinquante deux, pour arriver à toujours quatre cent cinquante euros par film. Et à ce moment là, si vous n’y arrivez pas, nous on accepte que, puisque vous êtes dans une télévision du chiffre trois et du chiffre deux, que vous créez une mutualisation d’achat par contre vous, qui êtes dans le chiffre un, les télévisions comme la RTS2, vous, vous devez payer les 450 euros parce que vous avez les budgets des télévisions publiques, vous les avez. Il n’y a pas de raison que vous payez en dessous parce que vous touchez les impôts des citoyens de votre pays. On vous donne l’argent, vous le dilapidez ailleurs ce n’est pas normal, mais ça fait de l’argent, ça fait une vraie économie qui peut démarrer aujourd’hui sur ce conti- nent. Si c’est de l’économie, ça fait de l’argent aux producteurs. Mais ça fait des films vus par des Africains on l’a dit aussi. Ça fait une autre chose, c’est que ça crée une appétence, et ça crée une concurrence et le docu- mentaire devient un objet de convoitise parce que ça va faire de l’audimat. Ça va marcher. En plus le gros avantage c’est que pour l’instant les télévisions afric- aines ne formatent pas. Donc ils ont dix ans devant eux pour faire toutes les expériences de cette équivalence.
Des fois il y a des films qui ne vont pas marcher en terme d’audimat mais comme il y en a cinquante dans le lot, comme on vend un abonnement sur soixante films, les films difficiles ils ne vont pas être pénalisés, ils sont mieux même s’ils sont moins difficiles, il n’y a qu’une ou deux télés qui les passent. Ils ramèneront tant d’argent, et ils auront une existence en tant qu’œuvre au milieu des autres. Et on laisse aussi l’expérience et l’expérimentation exister totalement au milieu de tout ça. Donc, voilà, c’est une des idées. Et l’autre idée clé pour la diffusion et maintenant pour la production, il y a une idée centrale, la création de fonds de soutien dans chaque pays mais pas des fonds de soutien uniquement nationaux, des fonds de soutien qui sont alimentés par deux financements, l’Etat et un autre financeur. Soit le regroupement des Etats qui peut être l’UEMOA qui peut mettre un euro, un franc CFA quand l’Etat Sénégalais met un franc CFA, ça fera deux francs CFA pour la cagnotte. Mais l’UEMOA va faire pareil à Bamako, à Niamey, à Conakry et tous ces fonds, admettons que ces fonds aident vingt films par an dans chaque pays, vingt films de création. On aide l’art industrie, pas les films de bas étage. Je ne dis pas qu’il ne faut pas aider le reste mais d’abord ça. Vous aidez vingt films par an et dans les vingt films, il y a dix documentaires. On en aide dix à Bamako, dix au Sénégal, dix à Conakry… Vous avez sur l’Afrique de l’ouest une centaine de films produits, ou admettons, la moitié, cinquante, parce que Bamako va s’allier avec le Sénégal pour produire un même film, regroupant leurs deux fonds de soutien. Dans les fonds de soutien, il y a un ensemble de clauses très précises qui ont été élaborées par les réalisateurs, les producteurs au dernier Fespaco qui indiquent les règles. Et les règles c’est qu’il faut qu’il y ait au moins deux critères sur trois réunis, et ces trois critères sont que le producteur soit du pays, que le film soit tourné sur le pays, que le réalisateur soit du pays. Quand vous en avez deux sur trois, vous pouvez avoir l’argent. Donc si moi pro- ducteur, je suis à Bamako et que j’ai des collègues du Film de l’Atelier qui ont un super beau projet à Dakar qui m’intéresse comme producteur, ils me renverront l’ascenseur la fois d’après. Moi je vais dire ah! Moi je suis producteur à Bamako, eh bien le film se tourne, en plus, en partie à Tombouctou. Donc j’ai droit à mon compte de soutien j’ai dix mille euros sur mon compte de soutien, eux il le dépose à Dakar, ils ont dix mille, ça fait vingt mille euros on n’a plus besoin du Nord déjà, seuls on peut faire le film. Maintenant si on dit que ce film a une densité, c’est intéressant, on va au des rencontres Tënk à Saint-Louis pour chercher des partenaires du Nord. Des partenaires sur la base d’une charte de coproduction équitable ce qui fait que le producteur du Sud n’a jamais moins de quarante pour cent de la valeur industrielle du film, c’est à dire qu’on construit un immeuble avec le producteur du Nord.
Mais à la fin quand l’immeuble est fini, le producteur du film n’aura jamais plus de soixante pour cent de l’immeuble, même si moi je n’ai pas amené un radis en argent. Ça c’est important parce qu’après, quand le film est vendu, s’il y a une économie de la vente, c’est en fonction des parts que j’ai dans la maison que je toucherai une part. Donc c’est très important, mine de rien. Si moi, un film de l’atelier je vais au des recontres Tënk avec mon collègue Jean Marie de Bamako on va ensemble, on trouve un partenaire du Nord qui lui va amener admettons vingt mille ou trente mille euros de plus. Bien, on fait un film de cinquante mille euros. On paye un peu plus les personnes, on garde un peu plus pour notre structure pour pouvoir faire d’autres films qui sont moins riches etc. Et là, je parlais de dix films par pays mais on peut arriver à cinquante films par pays très vite. Si au lieu de passer d’un fond de soixante mille euros comme c’était le cas à Niamey, on passe au Sénégal par exemple un fond de un milliard d’euros par an, je peux vous garantir que dans les cinq ans on a cent films par pays, on en a cent par pays. Et du coup il n’y a aucun problème. Vous aurez de la création, vous aurez de la daube, vous aurez des grands réalisateurs, des moyens, des pas bons, mais vous aurez une industrie de l’audiovisuel, une puissance et une structuration des professions. Ce qui est gênant aujourd’hui c’est que nous, on est une élite consciente de l’enjeu, mais on n’a pas les outils politiques pour faire passer ces enjeux dans la société, l’idée que la formation ici soit faite par des images et que ça décuplerait d’une manière incroy- able la conscience du monde, la culture des jeunes gens, la connaissance et la conscience de l’état des sociétés africaines rien qu’en montrant les films d’AfricaDoc ou d’ailleurs. Et bien ça ne passera pas encore aujourd’hui parce que le rapport de force n’est pas favorable il faut être plus nombreux. Pour être plus nombreux, il faut produire plus de films et être plus de réalisateurs, et à ce moment là, dans la bagarre, on y va. C’est aussi pour cela que nous avons pensé qu’il fallait dans le mouve- ment d’AfricaDoc, créer des cités documentaires qui sont d’une certaine manière – il ne faut pas le dire partout – des citadelles, c’est à dire des places fortes où il est question de concentrer la puissance. Là on est presque dans une stratégie militaire où, puisqu’on n’est pas si nombreux et que ça va mettre dix ans, il faut concentrer les acteurs sur des projets bien précis, cibler des actions et des buts et vous allez voir, vous créez une pépinière d’entreprise nurserie à Saint-Louis. Il y a six structures, il n’y a aucun pays sur le continent africain qui regroupe six structures de production de films audiovisuels documentaires dans le même lieu, aucun…
KDO: Et là, il y en a six?
JMB: Il y en a six à Saint-Louis qu’on va mettre en place à l’automne prochain ou l’hiver ou enfin au mois de janvier prochain. Et bien ces six structures je peux vous garantir qu’elles recentrent une puissance qui va tout démolir sur son passage. Pourquoi? On a vu la même chose, moi j’ai vu de mes yeux et on l’a fabri- qué à Lussas et j’ai vu de mes yeux les gens à Liège, les Dardennes faire la même chose. C’est le principe de, c’est pas la peine d’être immense et nombreux et dispersés, il faut être concentrés et forts, sinon ça va prendre du temps. Donc il faut se regrouper, il faut s’entendre, il faut avoir des projets, des programmes et être très précis sur les objectifs. Mais là, assis à Saint-Louis, on crée un fonds de soutien au Séné- gal dans les deux ans qui viennent, j’en suis persuadé parce qu’on est malins. On apprend à s’appuyer sur le maire, sur tel ministre – qui va voir quel ministre – qui va venir à Saint-Louis et on va faire une alliance avec l’UNESCO, on va être malins. Et c’est une lame inde- structible.
KDO: Et c’est le système que vous voulez installer ici…
JMB: Ici à Tamatave c’est une cité mais il n’y a pas que la pépinière. Les cités doc, elles partent d’un principe, le documentaire c’est socratique. C’est l’idée du débat, c’est l’idée que chaque cas est unique et que c’est un lieu où les convergences entre les humains favorisent la différence, la contradiction.
KDO: Le partage d’idées qui donne le dynamisme…
JMB: Qui donne du dynamisme voilà, avec des gens différents, avec des cultures, des religions différentes, et ces gens là, ils ont besoin obligatoirement de ces cités, d’avoir l’université parce que c’est la fabrica- tion d’une élite, c’est une pensée complexe, c’est une culture difficile à acquérir, il faut avoir une conscience du monde. Il faut avoir fait des études pour faire du doc, donc en tout cas au niveau de la réalisation et de la production. Et puis le documentaire, ça part du réel, ça renvoie au réel, ça crée le débat dans les sociétés, ça crée la conscience du monde. Donc il faut y aller. L’université c’est la clé, le deuxième élément; pépinière, nurserie; favoriser la création de petites PME, d’une deux personnes malignes, astucieuses, débrouillardes, ayant des point de vue, du goût, du désir et qui sont prêtes à s’associer avec d’autres. Ça c’est la pépinière.
Autre élément, développer une filière montage, là une filière cinéma d’animation, une filière web doc, une filière Saint-Louis du Sénégal, le doublage, le son, le sous titrage pour les populations. C’est leur idée ça, que les populations africaines aient accès dans leur langue quand elles sont analphabètes et même dans leur langue au fil même si on trahit un peu, même si en doublant et que c’est compliqué donc il faudrait le faire bien. Donc une filière, et, troisième élément un évènement annuel à Saint-Louis c’est clair, c’est le Tënk, plus un festival. Pour créer de l’écho, une onde de choc, un rayonnement, un évènement, une visibilité voilà. Et ça tu le fais ici, tu le fais à Bobo-Dioulasso, tu le fais à Tamatave. L’idée c’est qu’on fasse ça un peu partout dans le monde, tous ceux qui sont porteurs de ça, et voilà, parce qu’on crée une communauté de pensées.
KDO: Et après le quatrième point…
JMB: Ce sont les fonds de soutien, ça c’est un point très important. Ces fonds alimentés non seulement par l’Etat et des commissions qui sont paritaires, c’est à dire avec autant de professionnels que de gens venant des institutions, des cultures et si possible venant des pays voisins de la commission, un malien au Sénégal par exemple, et aussi quelqu’un qui fait autorité, un Gaston Kaboré qui viendrait à la commission deux fois par an à Dakar. C’est bien d’avoir ce genre de regard et pareil qu’au Burkina c’est ce qu’on devrait faire chez nous. On n’est pas encore capables d’aller chercher des regards qui viennent d’ailleurs de façon paritaire – qu’il y ait autant de professionnels que de gens du milieu – et que l’argent ne vienne pas seulement de l’Etat. Il faut aussi qu’il y ait une lisibilité, une transparence des fonds, que ce soit publié dans la presse, qu’on sache qui a obtenu quoi, les montants doivent être publics. Il faut que l’argent dans le mois qui suit l’attribution soit dans les caisses de la structure une partie de la somme dans un premier temps et la deuxième partie quand le film est fini. Et il faut que les films, une fois finis, soient mis dans un lieu qui va être un lieu mémoire qui correspon- de aux archives nationale. Et le prolongement de tout ça, c’est la création de société d’auteurs de manière à ce que les auteurs puissent toucher des sous… touchent des sous à la diffusion. Parce qu’en audiovisuel, en cinéma, ils ne touchent pas d’argent à la diffusion, c’est le producteur qui touche, donc il faut que les auteurs touchent de l’argent. Ils en ont besoin pour bouffer, quoi, donc voilà ce n’est pas plus compliqué.
INTERVIEW DE MONSIEUR BABA DIOP PRESIDENT DE LA FEDERATION AFRICAINE DE LA CRITIQUE CINEMATOGRAPHIQUE INTERVENANT A L’UNIVERSITE GASTON BERGER DE SAINT-LOUIS
KDO: Je fais un entretien avec Baba Diop qui est jour- naliste et critique de cinéma, qui intervient aussi à l’université Gaston Berger dans le cadre de l’écriture, et qui fait aussi des ateliers d’écriture pour des films pour enfants. Nous démarrons sur les problèmes de distribu- tion et de diffusion des films documentaires sur les chaînes de télévision publiques et privées du Sénégal.
BD: Il faut rappeler que je suis aussi le président de la Fédération Africaine de la Critique Cinématographique. Je crois qu’un petit rappel est néces- saire puisque au début des indépendances, ici, il n’y avait que des actualités sénégalaises comme il y avait des actualités maliennes. Avant cela il y avait des actualités françaises et c’est dans ce cadre là qu’après les indépendances, ces actualités ont été rattachées au Ministère de l’Information qui avec Paulin Soumanou Vieyra a commencé par faire des documentaires. Mais des documentaires de sensibilisation, des documentaires de préservation du patrimoine culturel et oral. En marge tout cela, comme il n’y avait que l’Etat qui avait du matériel de tournage, c’est après que des réalisateurs comme Sembene Ousmane et d’autres sont venus. Ce n’étaient pas des fonctionnaires mais ils profitaient du matériel des actualités sénégalaises pour faire des films de fiction. Mais à la base, la vocation des actualités, c’était avant la naissance de la télévision, de faire de l’information.
KDO: Il faut rappeler aussi que ces actualités étaient en super 16mm, 35mm et même inversibles à une certaine époque.
BD: Oui, on tournait comme au cinéma avec du maté- riel de cinéma et des techniciens formés aux techniques cinématographiques. La vidéo en était à ses balbutie- ments et n’avait pas encore envahi l’Afrique. C’était le support film et ce sont ces techniciens, les Baye D, qui ont aidé les réalisateurs de fiction à tourner. C’était les mêmes techniciens, donc les actualités étaient des films institutionnels qui devaient retracer les actions des gouvernements, et qui faisaient aussi des documentaires de sensibilisation sur l’agriculture, sur la santé et sur le patrimoine culturel. C’était tout ce qu’il y avait au ministère de l’information. Ce qui montre très bien les rapports que l’Etat avait avec le cinéma. Cela a continué, mais parallèlement, il faut dire qu’il y avait aussi une autre institution qui permettait à de jeunes réalisateurs, à ce moment-là, à l’époque des années 60, de faire des films documentaires, c’était le centre culturel français qui avait aussi son petit matériel. Et c’est là où on va retrouver cette lignée de jeunes réal- isateurs, les Djibril Diop Mambety les Samba Félix Ndiaye. Mais à la fin des années 60 début 70, époque qui coïncidait avec la vague de nationalisation des salles commencée avec le Burkina puis le Mali, et ensuite le Sénégal, on a créé la société nationale de cinématog- raphie, la SNC qui a produit quelques documentaires si ma mémoire est bonne. Je crois quelque cinquante six courts documentaires, plus trois fictions. Ensuite cette société a connu une certaine léthargie et a été mise en liquidation à la fin des 60s. L’Etat n’était pas intervenu. Dans le domaine du cinéma, ceux qui faisaient des documentaires ont continué d’en faire comme Samba Félix Ndiaye. Par leur arrivée, Samba Félix Ndiaye, Moussa Bathily, William Mbaye etc. ont donné de l’impulsion au documentaire. C’était ces jeunes réalisateurs, au début des années 70, qui ont tous commencé par réaliser des documentaires avant de se tourner vers la fiction. Seul Samba Félix Ndiaye a continué et n’a pas dévié. Il est vraiment devenu l’une des figures phares du documentaire en Afrique, surtout en Afrique Subsaharienne. Il y a Willy Mbaye qui revi- ent aujourd’hui au documentaire. Il y a aussi Jo Gaye Ramaka qui revient aussi un peu au documentaire. Tant qu’il y avait des salles de cinéma avec des actualités – puisque en première partie des projections, vous vous rappelez que jusque dans les années 80, il y avait une double programmation dans les salles, et tous les longs métrages étaient précédés d’actualités qui remplaçaient la télévision etc. – ces salles étaient le lieu de diffusion des documentaires. Bien qu’il y ait eu plus tard des accords entre la cinématographie et la télévision je crois que ces accords n’ont jamais fonctionné, ni dans la participation de la télévision au financement des films, ni quant à leur diffusion. Les rares fois où il y a eu quelques soubresauts, la télé a effectivement diffusé des documentaires, mais comme il n’y avait pas de budget consacré à la production, je crois que l’affaire est restée en l’état. Et puis il faut dire aussi que le cinéma a bougé de ministère en ministère. Je vous ai dit qu’au départ c’était le Ministère de l’Information, ensuite ça a été le Ministère de la Culture ensuite ça a été le Ministère de la Communication. Aujourd’hui on est retourné à la Culture et avec le nouveau gouvernement, au Ministère de la Culture et du Tourisme. Ces valses là n’ont pas permis au cinéma de bénéficier d’une stabilité en terme de production, de diffusion. Il y a eu effectivement, à la fin des années 80, la SNPC la Société Nationale de Promotion Cinématographique où Sembene Ousmane était PCA, et puis Johnson Traoré qui était le directeur général, ce qui a permis de faire quelques films. Mais là aussi l’affaire est morte de sa belle mort et depuis l’Etat n’est pas intervenu. C’est la coopération, c’est l’union européenne, ce sont à un certain moment quelques té- lévisions comme Channel 4 ou ARTE qui ont appuyé un peu cette production.
KDO: Aujourd’hui est ce que vous pensez qu’il y a une nouvelle vague, en tout cas une jeunesse du documentaire parmi les jeunes réalisateurs sénégalais?
BD: Il faut dire que la venue du numérique a beaucoup aidé les jeunes, mais dans les années 90, c’est ce qui a retardé justement cette résurgence du cinéma séné- galais. C’est que dans les années 90, on s’est perdus dans la bataille entre les réalisateurs qui avaient leur association, et les jeunes vidéastes qui tenaient bon et qui étaient un peu méprisés. Il faut le dire qu’ils n’étaient pas cinéastes, et donc ils n’avaient pas accès à l’association des cinéastes. Cette bataille du numérique cinéastes vs vidéastes a beaucoup retardé l’émergence du numérique. Aujourd’hui malheureusement, avec la disparition de pas mal de réalisateurs du Sénégal, les pionniers sont partis. La génération suivante com- mence aussi à se dégarnir. Samba Félix Ndiaye s’était beaucoup impliqué aussi. Il a servi de modèle aux écoles de formation que sont le FORUT (Media Cen- tre Dakar), qui avait quand même une bonne politique, même si le FORUT au départ n’était pas pour for- mer des documentaristes. Il s’inscrivait plutôt dans le documentaire de sensibilisation contre la drogue contre l’alcoolisme. Beaucoup de ces jeunes qui ont été formés, sont devenus des documentaristes, et notamment avec l’appui des femmes. C’est ça qui est la grande innova- tion. La formation était donnée en certaine priorité aux jeunes filles qui ont pu bénéficier de cette formation.
Cela permet aujourd’hui d’avoir un quota de réalisatri- ces quand même impressionnant. Avant il n’y avait que Safi Faye, quand on parlait de réalisatrice, il n’y avait que son nom qui venait à l’esprit, mais aujourd’hui la liste s’est beaucoup allongée. L’Etat comme je vous l’ai dit, n’a pas mis de fonds pour soutenir le cinéma. Ces jeunes-là ont créé des collectifs. On peut en distinguer trois il y a le camp des Arfan qui travaillent justement avec des ONG et qui font aussi des films. Il y a le camp de Fa Bakari Coly, qui travaille aussi dans la culture ur- baine. Et aussi Aziz Cissé du Ministère de la Culture et de la Cinématographie. On a là des jeunes qui forment des “écoles”, disons entre guillemets, qui s’inscrivent dans une démarche documentaire. Leurs regards sont des regards de questionnement tournés vers la ville, vers le bâtiment, vers l’environnement et les relations sociales. Mais aussi les arts urbains. Ce regard là est très intéressant parce que lié, par exemple, avec le mouvement Hip Hop qui est bien ancré aujourd’hui au Sénégal. En plus de ça, on s’était battu pour que Saint- Louis qui est le pôle, quoi qu’on en dise, de la nais- sance du cinéma, le reste. Quand on parle du quartet que constituaient Paulin Soumanou Vieira, Georges Caristan, Jacques Moly Kane et Moustapha Sarr, on se rend compte que trois d’entre eux étaient presque des Saint-Louisiens Moustapha Sarr était Saint-Louisien, Jacques Moly Kane vient aussi du fleuve. Georges Caristan bien qu’Antillais, sa famille avait fini par s’installer à Saint-Louis. On peut dire qu’ils sont vrai- ment des Saint-Louisiens. Il y avait aussi l’église avec le Père Vast qui était vraiment un révérend mordu de cinéma. Avec une bibliothèque formidable de docu- mentation cinématographique. Et avec la naissance du master de documentaire, d’abord à Gorée, reporté ensuite sur Saint-Louis et avec l’université Grenoble qui sont nées ensemble pour créer ce master là, je crois que nous avons une bonne base maintenant de valorisa- tion du documentaire, de sa visibilité. Et c’est ce qui a permis aujourd’hui à des pays comme le Niger à avoir des jeunes formés à Saint-Louis, qui commencent internationalement à avoir des noms. Ils ont fait des documentaires, mais aussi donné envie d’en faire à des jeunes Nigériens. Le cinéma Nigérien est en train de repartir grâce à ces jeunes qui ont été formés dans le documentaire.
KDO: Est ce que vous pouvez nous parler maintenant de votre action?
BD: Ce qui est paradoxal au Sénégal c’est que, quand vous interrogez les gens, on vous répond qu’il n’y a pas de salles de projection, que le cinéma ne marche pas. Or il y a sept ou huit festivals au Sénégal. Effective- ment les salles ont fermé et la télévision n’a pas de budget de production. Il y a multiplicité de télévisions privées, mais ces télévisions ne diffusent pas de docu- mentaires et elles n’ont même pas de budget de produc- tion. Toutes leurs productions sont des productions de studio ou de musique, qui prennent le pas sur la réalisa- tion de grands reportages ou de documentaires ou de participation à l’élaboration de films. L’un des lieux de diffusion c’est la télévision. Et si les télévisions ne jouent pas le jeu, c’est vrai que ces jeunes là n’ont que le cadre des festivals pour montrer leurs films. On compte au Sénégal quelque sept à huit festivals de cinéma. Il y a Moussa Invit qui est quand même un lieu de projec- tion de documentaires. Il y a les films de quartiers avec le Forud il y a le festival IMAGE et VIE qui montrent aussi des films. Il y a même des jeunes qui font des festivals à Foundiougne et un peu à Saint-Louis. Et également, le rendez vous d’AfricaDoc. Dans la situa- tion actuelle il y a des jeunes, beaucoup de jeunes main- tenant qui s’inscrivent dans le documentaire et dans le court métrage.
KDO: Maintenant je vais vous poser une question à pro- pos de votre intervention au niveau de l’écriture sur les films d’enfants.
BD: Je me suis battu et j’ai toujours attiré l’attention des réalisateurs en leur disant que les enfants quand même sont les grands oubliés de notre cinéma, parce que tous les sujets étaient tournés vers les adultes. A un certain moment c’était la politique la dénonciation, ensuite il y a eu ce qu’on appelait tradition et modernité. Les sujets c’étaient des sujets qui intéressaient uniquement les adultes mais le cinéma pour enfants n’avait pas de place. Il y a eu effectivement des tentatives faites avec les films d’animation au Mali, et aussi au Burkina avec Dao. Ici il y a Momar Thiam qui a essayé de traduire ef- fectivement quelques contes de Leuk le Lièvre, mais aussi de Birago Diop. Ça s’est arrêté là. Et puis il y a eu au milieu des années 90, un projet qui s’appelait Africa Pinocchio. Il s’agissait de réunir, pour la première fois, sept réalisateurs et sept scénaristes pour qu’ils puissent travailler ensemble à l’élaboration de films pour enfants. C’est dans ce cadre là que j’ai travaillé avec Thior sur une histoire qui était une expérience vraiment formidable. Pourquoi? Parce que Thior est Sérère, moi je suis Wolof j’ai écrit en français et le film a été traduit en Poular et s’est appelé Maël. Voilà une collaboration qui était vrai- ment très intéressante, et puis il y a eu l’EPSAC mis en place par l’Union Européenne qui a financé effective- ment le scénario Africa Pinocchio.
En tout cas, le film Maël a été financé pour les droits de scénarisation et la préparation. Il y a eu un atelier entre réalisateur et scénariste en résidence d’écriture. Il y a eu un second volet où il y avait maintenant réal- isateur et producteur sur le même projet. C’était une expérience formidable. Il devait y avoir un deuxième coffret, mais malheureusement le deuxième coffret n’a pas pu sortir. Ce projet était fait pour alimenter les télévisions. Il continue de circuler dans les télévisions. Sinon, j’écris pour la fiction moi-même et je réalise des documentaires. J’en ai fait douze, qui sont majori- tairement des portraits d’artistes. Ce sont les rapports que les artistes entretiennent avec leurs œuvres qui m’avaient fasciné. Il me reste un troisième film à faire sur le rapport des artistes avec le corps. Pourquoi ils peignent le visage? Pourquoi le corps accueille aussi l’art par le biais des tatouages, par le biais de la carica- ture? Que représente la caricature?
KDO: Et vos films ont été diffusés?
BD: Oui, dans le cadre d’une émission qui s’appelait « Raconte un Peu «. C’est une vitrine qu’on avait à la télévision, qui a duré deux années, où il s’agissait de diffuser du documentaire. Moi j’avais le volet artistique. C’était donc SUDCOM une structure de Sud Com- munication qui avait cette vitrine là, à la RTS. Comme je vous l’ai dit, cette émission était hebdomadaire.
Pendant deux ans, la télévision n’a jamais mis un sou dedans. A un certain moment on s’est essoufflés. Il fallait chercher de la pub pour financer afin de diffuser ces films. Ils ont bénéficié pendant deux ans de pro- grammes gratuits, on ne pouvait plus continuer comme ça. C’est comme ça que l’expérience malheureusement s’est arrêtée. Et c’est dans ce cadre là que je faisais la majeur partie de mes films.
KDO: Que préconisez vous au niveau des documen- taires qui sont réalisés, car je pense qu’il y a un souci, entre effectivement le Ministère de la Communication et de l’Information et le Ministère de la Culture pour pérenniser à long terme le fait d’instaurer un système de diffusion et un système de co-production entre les télévi- sions et les sociétés de production sénégalaises. Ceci avec les réalisateurs, pour que les films soient vus. Alors, est ce que vous pensez qu’il y a une politique à préconiser pour qu’effectivement il y ait un lien entre la production des documentaires et leur diffusion. Pour que ces documen- taires qui concernent nos sociétés et expriment le point de vue de nos réalisateurs sur nos sociétés, soient vus à la télévision publique et privée?
BD: La chance que nous avons, c’est qu’aujourd’hui le cinéma et le tourisme font partie d’un même ministère. Je disais que le nouveau code cinématographique a traîné dans les tiroirs à l’Assemblée Nationale, mais ce code a déjà été voté. Les décrets d’application, ef- fectivement, ont été publiés, et on vient d’avoir une grande rencontre à Saly, il y a de cela deux semaines, au début du mois de juin. Ce qui est intéressant, c’est que ce n’était pas une rencontre comme on en faisait dans le temps. J’ai toujours dit que le cinéma sénégalais, malheureusement ou heureusement, était porté unique- ment par les réalisateurs qui en ont fait leur affaire et qui ont tracé l’avenir du cinéma. Ils en parlaient entre eux. Avec cette dernière rencontre de Saly, non seule- ment il y avait de jeunes réalisateurs mais aussi des réalisateurs confirmés; il y avait des gens qui appar- emment n’avaient rien avoir avec le cinéma mais qui ont une implication; des représentants des groupes de convergence qui s’occupent un peu de comment voir les niches ou de développement, comment sup- porter des industries etc.; Il y avait le BSDA (Bureau Sénégalais des droits d’auteur) qui était là. Se posait la question du numérique parce qu’il y a une donne politique pour le numérique pour les années 2015. Les juristes étaient là, et on a eu un échange. Ça a ouvert les possibilités de notre cinéma quant aux sources de financement. Il n’y pas que l’Etat dans le rapport qui va être publié bientôt. Il y avait pas mal d’institutions qui aidaient un peu le cinéma. Il s’agit maintenant d’avoir une visibilité sur toutes les possibilités de financement. L’idée c’est qu’il faut que le cinéma sénégalais soit financé par le Sénégal, et ça je crois que les perspectives sont là, et ça a permis aux gens de savoir que, quand même, pour faire du cinéma il faut avoir des structures viables, et pas seulement du point de vue de l’Etat; mais aussi du point de vue des producteurs. Les gens des impôts étaient là pour donner un éclairage etc. et des juristes aussi étaient là. Disons que la concertation s’est vraiment élargie et c’est la première fois que j’ai senti l’implication de l’Etat pour asseoir une véritable industrie cinématographique qui toucherait tous les aspects. Qui ne serait pas seulement une cagnotte que l’on remettrait aux réalisateurs en disant « Gérez votre fonds! » Non, mais il y a aussi la possibilité mainten- ant de créer un CNC – peut être on l’appellera autre- ment-, mais un Centre National la Cinématographie coordonnant toutes les activités cinématographiques et établissant aussi une véritable politique de production. Il y a de jeunes producteurs qui sont là. Si, avant, les réalisateurs eux même s’improvisaient producteurs, ce n’est pas leur vocation aujourd’hui. On peut dire qu’il y a deux ou trois producteurs vraiment importants au Sénégal. Cela veut dire que ces producteurs ne sont pas seulement des producteurs locaux. Quand je vois Omar Sall qui a produit le dernier film de Alain Gomis, primé à Berlin, et qui est impliqué aussi dans d’autres productions étrangères, je me dis que l’avenir se trace avec des perspectives quand même radieuses. Et qu’on peut faire confiance à ces jeunes là, qui connaissent bien leurs domaines, parce qu’ils ont été formés pour cela.
Ils ont montré leur expérience en collaborant à d’autres grandes productions cinématographiques. Je crois que les festivals vont être ici des vitrines d’émergence de ces films. Mais maintenant, il faut aussi que les télévisions privées – elles sont sept, peut-être huit- comprennent les enjeux du cinéma. Elles peuvent effectivement être des partenaires et elles peuvent aussi dans leurs “pack- ages”, vendre leur production ailleurs. A Ouaga, il y a un marché du film où les télévisions viennent acheter, elles aussi. Mais malheureusement, il me semble que ceux qui ont créé ces télévisions, n’avaient pas pensé à l’origine, à l’aspect production et la mise en place d’un budget pour la production. On trouve de plus en plus de réalisateurs de documentaire ou de courts métrages face à des télévisions qui ne bougent pas beaucoup, mais qui ont aujourd’hui une ferme volonté de le faire, on l’espère. Surtout que c’est un culturel qui est à la tête du Ministère de la Culture et du Tourisme, qu’il est connu, et que lui même a produit des films et a été co- médien. Grâce à ce fameux film anglais où il jouait un rôle très important. Il a fait aussi la musique de plusieurs films. Donc il est sensible. Il est propriétaire aussi d’une salle de cinéma qu’il a achetée à Saint-Louis et qui va être rénovée parce qu’on veut faire de Saint- Louis un vrai pôle de développement culturel. On veut vraiment que Saint-Louis soit la vitrine du documen- taire en Afrique la salle de documentation du Père Evrard, à savoir le master 2, l’association Saint-Louis Doc et aussi l’implantation d’Africa Doc. On veut effectivement faire de Saint-Louis un pôle de dével- oppement et d’attraction du cinéma avec également des groupes industriels qui permettent à des jeunes d’avoir des unités de doublage, de duplication, etc… sur Saint- Louis. Nous avons en tête de faire de Saint-Louis un grand foyer d’attraction du documentaire.
KDO: Baba Diop va nous faire un petit point sur le festi- val qu’il est en train d’organiser avec le groupe Baobab et puis au centre culturel Blaise Senghor, ils font un festival assez intéressant. Donc il va nous faire le point.
BD: Centre Blaise Senghor. Déjà le nom veut dire quelque chose. De toute façon Blaise Senghor est un des premiers cinéastes. Il a réalisé Grand Magal à Touba, l’un des premiers documentaires sur le magal de Touba. Il n’y a pas très longtemps, j’ai eu cette idée avec Baba Ndiaye qui est le directeur du centre culturel
Blaise Senghor actuel. La question était « Comment est ce qu’on peut valoriser le travail des reporters photog- raphes? » Ils sont spécialisés dans les films de mariage, c’est à dire quand il y a des cérémonies de mariage dans les quartiers, on les appelle. Ce sont eux qui filment, et ils ont une vision du montage d’exposition de ces mar- iages que j’ai trouvé assez intéressante. Ils sont de plus en plus nombreux, puisque avant, dans les mariages, on les appelait pour faire des photos. Maintenant, ils se sont reconvertis à la vidéo. Ils font pas mal de films qui sont commandés et ils gagnent aussi de l’argent. Mais ces films qui sont des productions familiales ne sortaient pas. Alors, j’ai dit à Baba « Mais écoute est ce qu’on peut faire un festival de films où ces jeunes là vont venir montrer leurs films? » Avec une formation, qui sait, un jour peut être que parmi eux, il y aura certains qui vont sauter le pas et devenir réalisateurs de documentaires ou de fictions. Donc c’est une pépinière mais au delà de ce fait, c’est que le mariage est une institution. Il y a des sociologues qui travaillent sur les rites de mariage. C’est intéressant de les consulter. Il y a aussi un bouquin, sorti ici qui montrait même le taux de divorce à Dakar, au Sénégal. C’est phénoménal. Ce serait l’occasion d’inviter de vieux couples pour qu’ils parlent des secrets du couple « Comment conserver son couple? » etc. C’est aussi l’occasion de montrer le travail de certains photographes dans les studios des quartiers qui peuvent s’exprimer sur leur travail.
KDO: Et cela aura lieu quand?
BD: Du 12 au 17, donc au début du mois de juillet 2012. C’est fait en collaboration avec le centre culturel Blaise Senghor pendant trois jours. Les matinées sont des matinées de formation de ces jeunes dans la prise de sons et dans la prise de vue. Dans l’après midi, il peut y avoir des discussions autour de l’institution de mariage, ensuite la diffusion de témoignages de vieux couples et puis il y aura des projections des films, avec trois projections dans l’après midi et ensuite en début de soirée, suivies d’animations et de débats.
INTERVIEW DE MONSIEUR AZIZ CISSE
CHEF DE LA DIVISION DES ETUDES DES INDUSTRIES TECHNIQUES DE LA FORMATION ET DE LA PLANIFICATION.
KDO: Monsieur Aziz Cissé j’aimerais s’il vous est possible de vous présenter, de dire clairement vos fonctions ici à la direction de la cinématographie et faire un petit parcours de votre trajet dans le cinéma, et m’expliquer quelles sont vos objectifs pour les deux prochaines années, en ce qui concerne le documentaire.
AC: C’est une question qui peut paraître anodine mais c’est une grosse question pour moi. Actuellement je suis à la direction de la cinématographie et j’occupe le poste de chef de la division des études des indus- tries techniques, de la formation et de la planification. C’est un gros libellé qui fait peur parce que c’est vrai- ment lourd mais bon, parallèlement à cette fonction là, j’ai quand même plusieurs casquettes. J’ai été membre fondateur de plusieurs associations qui s’occupent de la promotion du film au Sénégal. Dans ma tête il y a un travail d’activisme à faire sur le terrain et à la base, parce que faire du cinéma, ce n’est pas faire que du film, c’est aussi éduquer le public, c’est créer les conditions d’environnement pour que le cinéma marche et ça ce n’est pas que le rôle de l’Etat. L’Etat a un rôle impor- tant à jouer mais je pense qu’on est dans un secteur avec plusieurs parties prenantes, et chaque partie prenante, quelle que soit sa spécificité, a son rôle à jouer. Voilà donc j’ai beaucoup travaillé pour le décollage d’une association comme Imagerie. J’ai beaucoup collaboré à un festival qui s’appelle le Festival du Film de Quartier qui a été pendant très longtemps le fleuron du cinéma sénégalais. Je contribue jusqu’à présent à créer des as- sociations qui vont émerger, je l’espère. Parallèlement à cette casquette, j’ai une autre casquette de formateur, je travaille beaucoup dans la formation des jeunes cinéastes de ma génération. On échange, on discute, parce que je pense, quand même, que c’était presque un privilège qu’ils n’ont pas eu. Ce n’est que très tôt j’ai eu à côtoyer un monsieur qui s’appelle Jean Ba qui a créé à Saint- Louis un centre magnifique qui s’appelle le Centre de Communication Daniel Brothier. Ce centre a com- mencé par être un cinéclub, et, au fil des décennies, il est finalement devenu une véritable école de cinéma et une école de cinéma qui n’offrait pas tout simplement une formation rapide, comme ça se fait ici, il s’agissait d’une formation de quelques mois sur la technique. Comment filmer comment prendre des sons. La question de la culture cinématographique, la question du background a été extrêmement importante, on a énormément travaillé sur ça, et j’ai passé dix ans dans ce centre pour apprendre comment faire un film. C’est quoi le cinéma? C’est pour- quoi je dis que ce background, je voulais en faire profiter les cinéastes de ma génération et jusqu’à présent, tous les jeunes qui rentrent chaque année. On essayait même en dehors des actions de formation de prendre le temps de s’assoir de discuter et d’échanger. Mais dans ma cas- quette de faiseur d’image, je suis beaucoup plus spé- cialisé dans le documentaire. Il m’arrive aussi d’avoir une casquette de producteur parce qu’il y a des copains qu’il faut aider à faire des films, donc là, je deviens producteur mais mon domaine de prédilection c’est véritablement le documentaire.
KDO: Est ce que vous pensez que le documentaire a de l’avenir sur les prochaines années, notamment auprès d’un public africain, un public sénégalais en particulier, en sachant que les télévisions africaines diffusent très peu de documentaires, et que les salles de cinéma sont fermées? Est-ce que, dans l’absolu, on peut imaginer un autre système de distribution? C’est à dire en étant optimiste, est-ce que vous pensez qu’on peut inventer un système de distribution pour aller vers le public?
AC: Je pense, comme je le disais tout à l’heure, que nous sommes dans une phase de résistance et le docu- mentaire est le genre de résistance – par essence je vais juste vous raconter une anecdote. Mon premier film je l’ai fait en 2001, à l’époque c’était encore assez dur. On faisait des films, les salles commençaient à fermer donc on n’avait pas la possibilité de passer ces films dans les salles. Les chaînes de télévision apparemment s’en fichaient complètement. Il nous est même arrivé de leur offrir les films à diffuser gratuitement, et ils ne l’ont pas fait. Donc à un certain moment on en a eu marre on s’est regroupés en collectif. On a été trouver du matériel de projection et nous sommes partis dans les quartiers populaires de Dakar, dans les autres villes du Sénégal, dans les villages aussi et on a montré ces films. 75% de ces films étaient des films documentaires et généralement les séances de projection se faisaient en plein air le soir vers 20h. C’était toujours ou les same- dis, ou les dimanches, et pour qui connaît la spécificité du Sénégal, c’est vraiment la période du “prime time” pour toutes les chaînes de télévision. C’est les moments où on met les blocksbusters américains, les grands shows, les choses comme ça. Mais paradoxalement, on s’est rendu compte que, dans chaque quartier où on ar- rive et on installe les dispositifs pour projeter les films, plus personne dans le quartier ne regarde la télé, tout le monde sort. Et il nous arrivait d’avoir presque un mil- lier de spectateurs. Et tu voyais les gens qui montaient sur le toit des immeubles et tout pour suivre les films. A la fin de la projection des films, le public restait pen- dant très longtemps pour échanger avec les réalisateurs parce qu’ils étaient toujours présents et la question qui revenait tout le temps c’était « Mais comment ça se fait que des films de ce genre soient produits au Sénégal et que la télé ne les diffuse pas? » Aujourd’hui c’est la question qu’on se pose, et quand on pose une ques- tion comme ça sur l’avenir du documentaire je pense qu’il a tout son avenir dans un pays comme le Sénégal. Parce que finalement le public à force d’avoir été sevré des longs métrages fictions faits par nos grands frères et tous ont fini par se retrouver dans une autre réalité. C’est la société, c’est la société médiatique où la télévi- sion est très présente, et ce public voit très bien qu’il y a un travail à faire sur son réel à lui. C’est un public qui reçoit une avalanche d’images qui viennent du monde entier. Si tu rentres dans une maison dakaroise ou sénégalaise, tu retrouves au moins une cinquantaine, ou une centaine de chaînes de télévision parce qu’ils sont connectés sur un système de câble plus ou moins légal.
Ils reçoivent toutes les chaînes du monde, mais il n’y a aucune différence entre les chaines de télévisions sénég- alaises et les autres, parce que ces chaines se contentent tout simplement de reprendre les programmes des autres chaînes de télévisions. Donc à force de recevoir cette avalanche, ils finissent par se dire « Mais, et nous dans tout cet espace là, où sommes nous? » et ce sont ces films que nous faisons, ces documentaires qui leur montrent leur réel à eux et qui les font parfois rêver. Cela leur rappelle plein de choses. L’histoire du cinéma africain subsaharien ou francophone a cette particu- larité que, dès le départ, on a voulu en faire un cinéma miroir. Aujourd’hui je pense que dans l’évolution de cette cinématographie, l’effet miroir est en train de migrer de la fiction vers le documentaire. C’est cela dont le public africain a le plus besoin, à mon avis, et c’est le travail que nous sommes en train de faire. C’est assez difficile pour le moment parce qu’on n’a pas de subvention véritablement, on n’a pas d’appui, le système de diffusion pose problème, mais on sait très bien que dans l’avenir ce genre va s’imposer d’avantage.
KDO: Je voulais juste vous poser une dernière question en ce qui concerne l’avenir du cinéma VOD distribué en HD à travers les ordinateurs, est-ce que vous pensez que c’est le cinéma d’avenir et comment vous voyez ça sur le continent africain?
AC: Je ne sais pas si on doit parler d’avenir, mais on ne peut pas le faire sans le système VOD, parce que dans la plupart de nos pays, les salles sont en train de disparaître. Le circuit des salles est en train de rétrécir comme peau de chagrin et on se rend compte que l’économie du cinéma ne tourne plus exclusivement au- tour de la salle, il y a une chronologie des médias. Que ce soit de manière horizontale ou verticale on est obligé de tenir compte de ces différents types de support. Que cela soit la salle de cinéma, que cela soit la télévision, que cela soit les vidéogrammes, que cela soit internet, c’est un programme beaucoup plus global que tout simplement le système de vidéo. Il faut qu’on occupe toute cette chaîne de valeurs, qu’on en tienne compte pour que l’industrie cinématographique africaine puisse enfin avancer. Sinon, on passera beaucoup de temps à dépenser énormément d’énergie, énormément de res- sources pour un combat qui est presque perdu.
INTERVIEW DE MOUSSA SENE ABSA,
REALISATEUR
KDO: Je fais une interview de Moussa Sene Absa réal- isateur et producteur de longs métrages de fiction, et aussi de documentaires. Il va brièvement décrire son parcours et nous expliquer comment il est passé de la fiction au documentaire. Comment cela s’est fait pour lui, et quelle est l’importance pour lui de faire des documentaires, tout en sachant qu’à la base il est plutôt réalisateur de films de fiction.
MSA: En fait oui, j’ai commencé par la fiction, c’est vrai les gens me connaissent plus pour la fiction. Mais j’ai fait « Papisto Boy », mon premier documentaire, j’ai fait « Dieuf Dieul », « Blouse pour une Diva », « Ngoyane les Chants de Séduction ». J’ai terminé « Yollé le sacrifice » et je suis en train de finir « Sango- mar » En fait, j’ai fait plus de documentaires que de fictions, mais comme le documentaire n’est vu nulle part, les gens ne connaissent que ma fiction. Parce que, demandez à n’importe quelle chaîne de télévi- sion ici, quels sont les films qu’ils ont de moi, ils n’en ont pas, pour la bonne et simple raison que, un, ils ne sont pas au départ quand je fais les films parce qu’ils ne co-produisent rien du tout; et deux, ils ne sont pas intéressés par la diffusion, parce que même s’ils sont intéressés c’est pour te proposer des miettes que moi je n’accepte pas. Pour monter un documentaire, je fais tout moi même. J’ai des caméras, je m’occupe du son, de l’éclairage. Je sais utiliser le matériel, je paie tout moi même. « Yollé le sacrifice » je l’ai financé moi même.
J’ai mis deux ans à le faire et sur les deux ans, je n’ai reçu aucun soutien de qui que ce soit. Voilà l’état des lieux. En résumé ils ne montrent pas nos images parce qu’ils ne connaissent pas l’existence de ces films. Vous demandez à n’importe quel directeur des programmes la liste de mes documentaires ou de mes fictions, ils ne l’ont pas. Voilà un outil de diffusion qui est complète- ment tourné vers l’extérieur; si j’allume la télévision sénégalaise – à Poponguine, je n’ai que les chaînes de télévision sénégalaises – il n’y a pas de documentaire. Parfois tu peux tomber par hasard sur un film de fic- tion, c’est du réchauffé mais la grille documentaire est inexistante. Je parle de contenu local. Mais évidemment tu vas voir des documentaires animaliers, tu vas voir des documentaires sur les autres pays. Il n’y a aucun docu- mentaire sur l’Afrique. En 2012, en Afrique du Sud, en novembre, on avait mis en place le DNA Documentary Network Africa. Je suis membre de ce réseau. On s’est retrouvés à ce séminaire là, People to People (P2P), et tout le monde s’est mis à se plaindre « On ne montre pas nos films, personne ne voit nos films! » Je me suis levé et je leur ai dit « Il y a tellement de documentaires en Afrique, qui sont déjà produits mais pas montrés.
Pourquoi ne pas créer une chaîne de télévision afric- aine qui soit spécialisée dans le documentaire comme la chaîne HISTOIRE ou la chaîne ENTERTAIN- MENT? Ou d’autres chaînes internationales spéciali- sées comme NATIONAL GEOGRAPHIC? Sur ces chaînes, quand elles montrent quelque chose sur l’Afrique, c’est de leur propre point de vue. Car ce ne sont pas des films qui sont faits par des Africains, mais des films avec un point de vue occidental sur notre so- ciété. Comment renverser la tendance en poussant à ce que les documentaires africains soient vus par les Afric- ains? C’est une réflexion à avoir. Tant qu’on n’aura pas réglé ce problème de qui raconte l’histoire de l’Afrique, jamais l’Afrique ne sera regardée de manière objective, de manière respectable. Moi j’ai honte parfois, quand je vois des documentaires faits sur l’Afrique. Ils ne mon- trent que ce qu’ils voient en nous, et ce qu’ils voient en nous, ce n’est pas beau! Est-ce que l’Afrique doit continuer à garder ce regard de l’autre sur elle, ou bien l’Afrique doit-elle retourner le miroir sur elle même?
Vous voulez savoir qui je suis? Pourquoi je me suis mis dans le documentaire? Parce que je trouve que c’est le travail le plus important à faire aujourd’hui.
Pour plusieurs raisons, d’abord parce que les Afric- ains ne se connaissent pas. Avant hier, je faisais avec ma fille, Mame Khar Betty, ses devoirs en histoire. Ils apprennent l’Europe du 9e siècle avec les souverains, les vassaux. Qu’est-ce qu’ils apprennent de l’Afrique?
Rien! Même le système d’éducation qui est la base de l’individu, le système d’éducation est tourné sur l’extérieur. Je me suis rendu compte que plus je prends de l’âge, plus le documentaire me passionne. C’est là que je peux montrer le véritable visage de mon pays, de mon continent, avec un regard imprégné de respect et de considération et de critique, sans être voyeur. Le côté voyeur qui nous fait tellement de mal, le voyeurisme des Occidentaux c’est une obsession, et les jeunes Africains qu’ils ont réussi à pousser, qu’ils ont formatés pour avoir le même regard qu’eux, regardent leur conti- nent avec mépris. On leur demande de ne regarder que ce qui n’est pas beau, et de ne montrer que ce qui n’est pas beau, parce qu’ils ne savent pas ce qu’est un film.
Le travail du documentaire est extrêmement fonda- mental, ce sera notre prochaine constitution, si je peux l’appeler comme ça. Ce sera notre constitution, dans la mesure où ce seront les actes constituants notre iden- tité et notre véritable image à montrer au monde. Et pourquoi les télévisions et les salles -je ne parle même pas des salles de cinéma- ne montrent pas de documen- taires? Parce qu’ils ont abruti l’audience de telle sorte que dès que tu mets un documentaire, c’est certain, il ne parle que des problèmes. Pour eux le documentaire c’est de voir l’humiliation en direct. On te montre des filles violées, des mendiants dans la rue, des femmes battues, le SIDA, les guerres, les génocides, ils ne te montrent que cela. Mais il y a plus intéressant, il y a les success stories; des histoires à succès extraordinaires.
L’autre jour, je me suis dit qu’en fait, tout le monde sait que l’avenir est en Afrique, tout le monde le sait. Nous avons un taux de croissance qui est supérieur à l’Europe, nous avons des ressources beaucoup plus importantes que l’Europe. Le travail qu’ils sont en train de faire c’est de crétiniser les Africains, c’est de leur faire comprendre que, eux-même, par eux-même et pour eux-même, ils ne peuvent rien faire et que « nous Européens, nous allons venir vous apprendre ce qu’il faut faire ». Comme Des- mond Tutu le disait « Avant l’arrivée des missionnaires, ils avaient la bible et nous on avait la terre. Quand ils sont arrivés ils nous ont dit, on va prier. Nous on a fermé les yeux, quand on les a ouverts nous on n’avait plus la terre mais on s’est retrouvé avec la bible. » C’est le même système qui est entrain de s’installer. C’est un système qui vise les ressources.
Il faut s’en accaparer, et la meilleure façon de s’en ac- caparer, c’est de pousser ces peuples vers l’éducation fondamentale. L’éducation fondamentale, c’est de savoir qui tu es, d’où tu viens, où tu vas et quelles sont les choses importantes. Tu penses que ma sœur, ma fille, s’intéresse à connaître l’Europe du 9e siècle? Qu’est-ce que ça peut lui apporter d’apprendre par cœur l’Europe du 9e siècle? Cela ne lui apportera rien du tout. Par contre, à cinquante kilomètres de chez elle, à Thiès, il y avait un roi qui s’appelait Mboy Ciss dans le Diom- bass. Je lui ai parlé de Mboy Ciis , j’en parlé avec son prof d’histoire, il ne connaissait pas Mboy Ciis. Par conséquent, le travail de documentaire est un travail de formation d’une identité.
KDO: Et comment vous expliquez que justement on est en 2013, le continent africain n’a jamais été autant envahi par l’image? Aujourd’hui au Sénégal les gens peuvent capter une cinquantaine, voire une centaine de chaînes du monde entier. En même temps, il n’y a aucun programme au niveau de l’éducation nationale pour expliquer la force de l’image. Ca veut dire que les enfants, la jeunesse africaine est abrutie de toute sorte d’images. Vous avez les chaînes arabes, les chaînes chinoises, toutes les chaînes européennes, toutes les chaînes des autres pays africains, et vous avez une jeunesse qui zappe tous les jours au quo- tidien il n’y a aucune explication, aucune responsabilité de l’Etat d’interdire certains types d’image, il n’y a rien, c’est le vide.
MSA: Mais parce que, justement, je pense profondé- ment que l’Afrique n’a pas encore les dirigeants qu’elle devrait avoir. Je pense que quand on aime un pays, on doit profondément aimer sa culture et en aimant sa culture, on aime son peuple, on défend son peuple, on connait la fragilité des cultures. Il y a des cultures qui ont disparu, il y a des civilisations qui ont dis- paru, et si on n’y prend pas garde la culture africaine va disparaître. Il y a des pans entiers de notre culture qui foutent le camp sans que personne ne dise rien du tout. Aujourd’hui l’invasion des télévisions étrangères poussent à une certaine paresse intellectuelle. On ne te donne même plus le temps de réfléchir sur toi. Tu peux voir ce qui se passe en Inde, tu peux voir tout autour du monde, mais tu ne verra rien autour de toi. Et si tu ne vois rien, si tu n’as pas tes propres images, tu as les images des autres. Je dis souvent à mes étudiants « Vous savez la culture, c’est comme l’armée. Ou vous avez une bonne armée pour vous défendre, et les autres ne vont pas vous attaquer, ou bien, si vous n’avez pas une bonne armée, vous allez avoir l’armée du voisin qui va venir s’installer, va vous dicter ses propres lois. Moi, je demeure convaincu que ce bouquet télévisuel qui en- vahit l’Afrique fait partie d’un agenda bien précis. On ne peut plus coloniser aujourd’hui, parce que le monde a tellement avancé, tu ne peux plus venir quelque part et dire « Tu es ma colonie ». Mais y a une autre forme de colonisation, il y a une façon beaucoup plus subtile de coloniser les gens, c’est de coloniser la tête, c’est de faire qu’on va recopier tout ce que l’autre fait. On va dire tout ce que l’autre dit. C’est bien, parce qu’on ne voit jamais ce qu’on fait chez soi. Alors ce qu’on fait chez soi, c’est des vidéos clips vulgaires, des telenovelas à la petite semaine qui n’apportent rien. On entend à longueur de journée des gens qui chantent le coran, qui parlent en arabe. Personne ne parle arabe, ou tu vois des gens qui le parlent, parce qu’il y a une manifesta- tion religieuse toute une nuit. On n’entend que ça, mais le peuple a besoin de pain, mais aussi de roses, le peuple a besoin d’une projection identitaire, d’une réflexion sur lui-même, d’une façon de regarder le monde et de s’affirmer, et d’être beaucoup plus ancré dans sa propre civilisation. Ça ne veut pas dire qu’il faille rejeter les autres civilisations.
KDO: Etant donné que nous savons que la télévision ne diffuse pas les documentaires, que nous savons qu’il n’y a plus de salles de cinéma, comment peut-on envisager d’aller à la recherche ou à la reconquête du public?
MSA: Ça, c’est la tâche énorme à faire, parce que nous avons devant nous une armée avec les armes les plus sophistiquées. Le combat est inégal, c’est un combat à mort et un combat inégal parce que tout est une ques- tion de domination. Le reste devient tellement aisé et si nous restons dans le schéma actuel où il n’y a plus de cinéma, il y a des jeunes de vingt ans qui n’ont jamais été dans une salle de cinéma.
KDO: Et moi dans ma jeunesse ici sur Dakar, il y avait une cinquantaine de salles de cinéma!
MSA: Aujourd’hui il n’y a plus de salles de cinéma. Nous faisons un métier qui a besoin d’un public dans un pays où il n’y a plus de salles de cinéma et où nous n’avons pas accès aux télévisions. S’il y a des parias en Afrique, c’est vraiment nous. Et pourtant, on fait un métier extrêmement important pour un pays, un métier formateur d’une culture. Ce qui fait que les peuples se différencient. Moi je donne souvent l’exemple du Cuba, parce que voilà un pays, c’est la plus moche des îles, je pourrais dire, mais c’est l’île qui accueille le plus de touristes. Ce n’est pas pour la beauté des plages, ce n’est pas pour un régime politique. Non c’est pas pour ça, c’est pour la culture cubaine, c’est pour les arts cubains – quand je dis culture cubaine, c’est le chauffeur de taxi cubain qui peut te parler de Cuba comme dans un livre. Demandez à n’importe quel Sénégalais surtout cette jeunesse, demandez leur qui était Fodé Kaba, ils ne connaissent. Samory, ils connaissent le nom, mais ne connaissent pas les faits. Ils ne connaissent rien. Donc voilà tout un continent à vau-l’eau. Un continent qui ne développe pas des formes de résistance. Et pour moi, la forme de résistance la plus élémentaire, c’est la résistance identitaire. Donc c’est un travail d’une ex- trême importance. Le fait est que toutes les salles sont fermées, qu’il y a beaucoup de divisions et qu’il n’y a pas d’entrée possible à la télévision. Songez que mes films sont montrés dans toutes les télévisions du monde!
Cela veut dire que le monde achète mes films, montre ma culture à leurs peuples, mais mon peuple ne montre jamais mes films parce que justement, en montrant mes films, ils vont faire une œuvre de conscientisation qu’on leur interdit de faire. C’est le serpent qui se mord la queue.
MR HUGUES DIAZ
DIRECTEUR DE LA CINEMATOGRAPHIE AU SENEGAL
KDO: Nous nous trouvons aujourd’hui à l’université Gaston Berger. Il vient d’y avoir la remise des prix des masters de cinéma et je suis en présence de M. Hugues Diaz le Directeur de la Cinématographie au Sénégal. Il va nous donner un petit aperçu de son parcours, ce qui l’a amené à la direction de cette cinématographie à Dakar, et quels sont les projets de ce bureau pour l’avenir du cinéma.
HD: Au Ministère de la Culture et du Tourisme au Sénégal, je suis conseiller aux affaires culturelles, c’est à dire un transversal manager/organisateur. Dans mon parcours professionnel j’ai été animateur culturel en 1996, et après ma formation professionnelle à l’Ecole Nationale des Arts, j’ai travaillé dans plusieurs centres culturels. J’ai occupé les fonctions de chef de la divi- sion animation qui comportait la musique, les arts scéniques et les cinéclubs qui étaient organisés dans ces structures. Ce n’est qu’avec l’avènement de la Maison de la Culture (l’une des premières maisons de la culture Douta Seck, à Dakar) que j’ai été chargé de la com- munication et de l’animation. Par la suite, je suis allé faire des études au Centre Régional d’Action Culturelle pour obtenir le diplôme de conseiller aux affaires cul- turelles, donc le DCSCS en développement culturel.
Le 23 Novembre 2011, j’ai été nommé par décret prési- dentiel à la tête de la direction de la cinématographie.
A Saint-Louis, ici dans le centre du Père Jean Vast, il y avait souvent des séances d’initiation à l’image dans des cinéclubs, avec des films sur lesquels on décryptait le message des images, c’est de là qu’est venu mon goût pour le cinéma, et je suis un fier cinéphile.
KDO: D’accord, c’est ce qui vous lie à Aziz qui a aussi fait de la formation.
HD: Avec le Père Jean Vast, c’étaient mes jeunes frères que je rencontrais très souvent là, c’était au moment où j’exerçais comme animateur culturel au centre culturel régional Abdel Kader Fall. On faisait, au niveau du centre dans lequel j’étais, des séances de cinéclub chaque mercredi et chaque samedi et j’en étais le responsable.
KDO: Et justement aujourd’hui en 2013 le constat est de dire qu’au niveau de l’éducation nationale, il n’y a quasiment plus de cinéclub, vu qu’il n’y a plus de salles de cinéma. Vous pensez qu’il serait possible et envisageable de créer un partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale pour essayer d’amener justement le cinéma documentaire et fiction dans les écoles ? De créer de nouveaux cinéclubs, parce que c’est ça qui donne le goût aux enfants d’aller au cinéma pour essayer dans dix ou quinze ans d’avoir une audience autour du cinéma, parce qu’aujourd’hui nous constatons qu’il y a une jeunesse qui, à 25 ans, n’a jamais été au cinéma.
HD: Effectivement ce que vous dites est très réel. Vous savez, moi lorsque j’étais dans les centres culturels, d’abord à Fatick, Saint-Louis, puis Louga, dans mes programmes culturels, le cinéma était positionné à la première place, et cela pendant 10 ans. C’est pour vous dire que moi, très tôt, j’ai compris que le cinéma était un outil d’éducation assez important profession- nellement. Nous l’avons jusqu’à présent, mais ce qui a un peu manqué, c’est l’articulation, car très souvent ce sont des initiatives qui ne sont pas formalisées. Louga le fait mais les autres régions ne le font pas. Ce n’est pas inscrit dans le cursus de l’école sénégalaise. C’est vrai que les écoles vont nous dire qu’elles n’ont pas de salles adéquates pour faire des projections de films.
Les salles de cinéma n’existant pas dans les régions, comme je le dis, la stratégie serait de le faire avec les centres culturels régionaux. Au Sénégal, nous avons quatorze régions, dans lesquelles se sont érigées ces Centres Culturels Régionaux. Il existe également les centres culturels étrangers comme les instituts français ou bien les alliances. Il faudrait que l’on puise organ- iser des séances permanentes avec la direction de la ci- nématographie, plus certains opérateurs, et l’instituer dans les cinéclubs. Projeter dans ces centres des films ayant une portée éducative réelle pour les enfants, cela aussi manque.
KDO: Alors que notre génération a eu la chance, sous Senghor, d’avoir accès à la culture, d’avoir une base solide mais aujourd’hui, il faut relancer la machine.
HD: Effectivement, et je pense qu’il faut allier des mécanismes assez flexibles parce que vous savez, les enfants maintenant, ont d’autres préoccupations.
KDO: Bien sur, oui avec internet et les nouvelles technolo- gies. Est-ce que vous pouvez brièvement faire le point de votre audit à Saly sur les problèmes juridiques et sur les projets d’avenir ? A la fin de cet audit, quelles seront les grandes lignes que vous avez redéfinies autour de la direction de la cinématographie?
HD: L’atelier de Saly du 5 au 7 juin passé, avait pour intention de faire un état des lieux du cadre législatif et réglementaire du cinéma et de l’audiovisuel au Séné- gal. Le Sénégal s’est doté d’un cadre juridique assez important. Depuis 1966 des textes existent. En faisant le diagnostic, il s’est trouvé que la plupart de ces textes permettent de gérer le secteur comme il se doit. Ils sont là pour la majeure partie et ne sont pas appliqués. Sur les six textes de lois et décrets il y en a un seul qui fait l’objet d’une application, assez timide, c’est le texte se référant à la délivrance des autorisations de tournage.
C’est bien évident. Mais tout le reste, que ce soit le fonds de promotion de la cinématographie, la billet- terie nationale, le registre public de la cinématographie ou la délivrance de la carte professionnelle, tout cela fait l’objet d’un abandon. Il a donc fallu faire ce sémi- naire pour se fixer des objectifs, que ces textes soient appliqués. C’est globalement positif. Nous allons incessamment lever certains goulots d’étranglement, car la plupart sont des blocages administratifs. Par exemple la carte professionnelle. Une fois qu’un décret d’application est pris, on doit se mettre à l’application au niveau de la direction de la cinématographie. Il y a eu une petite négligence de notre part et nous en sommes conscients. Comme nous sommes dans un domaine partagé, nous désirons innover, nous voulons pour chaque démarche associer les professionnels, la so- ciété civile et les partenaires dans une attitude vraiment consensuelle avec une bonne synergie. C’est l’affaire de l’Etat, un comité de suivi a été mis en place qui va décortiquer très rapidement, dès la semaine prochaine, les priorités. La délivrance de la carte professionnelle est une exigence. La levée des fonds concernant le fonds de promotion cinématographique également. Ces dispositions administratives sont en train d’être revues pour qu’en 2013 il y ait une inscription à une dotation. Voilà entre le Ministère de la Culture et le Ministère de l’Economie et des Finances. Donc pour ces deux aspects je pense qu’il y aura une réponse très immédiate à la résolution de ces problèmes. Il y a d’autres aspects comme le registre public, qui est vraiment fondamental. Là aussi c’est, comment dire, la quintessence même de l’organisation du cinéma. C’est par ce registre qu’on peut avoir des données statistiques sur toutes les trans- actions dans le domaine. Si les gens contractent avec des tiers pour la réalisation de films, toute cette disposi- tion concernant le registre va connaître aussi son abou- tissement. Le problème est que nous n’avons personne pour former le conservateur qui doit savoir ce qu’est le registre de la cinématographie. Avec nos partenaires du Maroc il est prévu d’envoyer deux personnes de la di- rection de la cinématographie en formation au Maroc. Même la France est disposée à nous envoyer un expert pour la tenue de ce registre de la cinématographie.
Donc vous voyez, nous sommes ouverts. Parce que le cinéma est à la fois un art et une industrie, et mainten- ant nous sommes dans une logique d’économie de la culture. Le cinéma nécessite des fonds, des investisse- ments qu’il faut tout au moins rentabiliser. En plus de cet état concernant les aspects juridiques, nous avons un peu touché les aspects macroéconomiques, notam- ment la fiscalité appliquée au secteur. Il faudrait que l’on puisse faire la relance économique du secteur avec des allégements fiscaux qui permettraient aux investis- seurs créant des entreprises de production, qu’ils soient allégés de taxes. Tout cela est à l’étude. Vous savez qu’au Sénégal il y aura bientôt la révision du code général des impôts. Face à ces enjeux nous ne voulons pas être absents, nous allons profiter de cet atelier pour har- moniser nos points de vue, pour ne pas aller en ordre dispersé. L’autre problème c’est la protection sociale des artistes et des cinéastes. Là aussi nous avons évoqué ces questions, parce que très souvent les cinéastes après avoir produit les films se retrouvent démunis.
KDO: Il y a le problème de distribution qui se pose parce qu’une fois qu’un film est produit, quelles sont les retom- bées financières ? Qu’est ce qu’on peut envisager, vu qu’il n’y a plus de salles de cinéma, vu que la télévision pub- lique diffuse très peu de films africains ? De toute façon, à priori, ils n’ont pas vraiment les moyens d’acheter ces films, alors le cinéaste, une fois qu’il a fini son film, il n’a quasiment aucune certitude de retombées financières.
HD: Effectivement! Beaucoup de cinéastes ont reconnu que maintenant le septième art ne nourrit pas son homme! La plupart d’entre eux vont dans un festival. Mais un festival vaut ce qu’il vaut. C’est la notoriété, certes, mais ce n’est pas les finances. Un autre aspect important aussi, ça a été la formation, comme nous l’avons constaté pour le cinéma sénégalais. Le mail- lon faible qui a été négligé depuis les indépendances jusqu’à nos jours, ça a été la formation. Le Sénégal ne s’est jamais doté d’une école de cinéma ou bien de techniques de l’audiovisuel. Les gens ont reconnu cela et en dépit d’initiatives privées qui ont eu cours pour certains, ça a bien marché, pour d’autres ça a vrai- ment chuté. L’Etat doit s’engager à prendre en main ce volet de la formation en créant des filières au sein des universités comme l’UGB (Université Gaston Berger). L’initiative de l’UGB doit être renforcée et soutenue par l’Etat. L’Ecole Nationale des Arts existe, on peut y créer un département pour les sites intermédiaires. Vous savez, l’UGB est un master 2, mais très souvent il y a des jeunes qui n’ont que le bac et qui ne peuvent pas adhérer à ce master. Tout cela on est en train de voir, en relation avec le Ministère de l’Enseignement Technique et de la formation professionnelle. Il y aura des rencon- tres qui vont se faire pour harmoniser les points de vue et pour voir comment l’Etat pourrait s’engager.
KDO: Et que pensez-vous vous de l’engagement éven- tuel de l’Etat, en ce qui concerne les salles de cinéma où la restructuration d’un système de visibilité ciné- matographique dans une ville comme Dakar ? Nous faisons le constat qu’il n’y a quasiment plus de salles de cinéma et comment faire si on fait une formation, et qu’en face, il n’y aucune visibilité ? C’est un peu compliqué. Est-ce que vous pensez que le Ministère de la Culture en relation avec le Ministère de la Communication et des fi- nances envisage une relance des salles de cinéma existan- tes ? Quelles soient par exemple éventuellement rénovées et équipées de projection numérique HD, ou restructurées pour essayer de ramener les gens au cinéma?
HD: C’est vrai c’est un problème assez complexe. Je pense qu’il fera l’objet d’une grande étude. Nous préparerons un plan, le plan de développement intégré du cinéma et de l’audiovisuel au Sénégal. Cela pren- dra tous les maillons de la chaîne cinématographique et audiovisuelle du Sénégal. C’est vrai que l’Etat, au moment où il gérait les salles, ça marchait. Il y avait vraiment un système de distribution, d’exploitation. Du fait de l’ajustement structurel qui est passé par là, l’Etat a été obligé de céder ses salles à des privés.
L’accompagnement qui aurait dû être fait à ce niveau, n’a pas été envisagé, et c’est bien dommage. Ce qu’il faudrait dire, c’est que l’Etat est sensible à la ques- tion. A chaque fois que nous passons à l’Assemblée Nationale ou au Sénat nous sommes interpellés sur ce problème. Les alternatives qui ont été envisagées, vous savez que l’Etat a toujours de grandes salles- le grand théâtre Sorano a deux salles. Le grand théâtre est équipé d’une cabine de projection. Avec ces deux récep- tifs, nous envisageons avec les directions respectives de ces structures de faire des projections exclusives, c’est à dire, les grandes premières. Vous pouvez allez voir le film de Moussa Touré « La Pirogue » qui sera projetée dans l’une ou l’autre salle du grand théâtre Sorano.
Incessamment, nous préparons la sortie officielle du film « Aujourd’hui » de Alain Gomis, au Sénégal.
Nous allons utiliser ces salles, mais cela ne résout pas le problème. L’autre alternative, comme nous avons pensé au niveau de la direction, c’est l’utilisation des Centres Culturels Régionaux fonctionnels. Et vous le savez, il y a des complexes qui existent dans les quatorze régions du Sénégal. Le problème qu’ils ont, c’est l’équipement. Nous prévoyons un vaste programme de rénovation avec la coopération internationale, et donc nous avons ces complexes. Il faut des équipements adéquats pour des projections au niveau des régions. L’autre aspect, ce sont les opérateurs privés qui se sont installés grâce au concours de l’Union Européenne. MobiCiné, le cinéma numérique ambulant fait des projections dans des zones rurales avec AfricaDoc. Nous renforçons ces initiatives, mais maintenant le problème, c’est qu’on puisse avec ces opérateurs voir les productions locales.
KDO: La difficulté effectivement, c’est la rencontre entre les réalisateurs et ces opérateurs. Il y a une méfiance vis à vis des réalisateurs, parce qu’il n’y a pas la garantie de l’Etat sénégalais au niveau de la lecture des contrats. Il y a un système de protection quand même à avoir, et du coup, si l’Etat sénégalais se penchait sur les contrats proposés pour dire voilà « Nous avons analysé ce que vous proposez, nous garantissons le réalisateur et nous mettons un système juridique en place pour que cela soit possible» …
HD: Oui, il y a une discussion à ce propos et les opéra- teurs sont au courant. Je leur ai montré ma disponibilité pour tout cela, et même mieux l’Etat va s’engager à payer des droits non commerciaux pour permettre une large diffusion de ces produits. La direction de la cinématographie a fait ce pari et nous avons démarré depuis 2012. Nous avons acquis les droits de certains films pour des projections à travers le Sénégal. Nous allons intensifier le processus, parce qu’il faudrait quand même que les producteurs puissent amortir leurs films.
Ce qu’ils demandent est assez clair, mais vous savez la création, la culture n’a pas de prix. Maintenant il faudrait qu’on se mette sur le même plan et que l’Etat puisse être un vrai partenaire.
KDO: Et accompagner à la fois les opérateurs économiques privés et relancer la machine au niveau étatique pour qu’il y ait une projection d’avenir?
HD: C’est l’une de nos missions, et on sera toujours en concertation avec ces personnes.
KDO: Pensez vous que le documentaire a de l’avenir ? Le documentaire de création tel qu’on l’entend, conforme à la vision de la fondation, et dans la mesure où, comme je vous l’ai dit tout à l’heure, la société civile est dans une phase de prise de conscience énorme, des problèmes identitaires, culturels, environnementaux et sociaux dans le pays, est ce que vous pensez que le documentaire a de l’avenir?
HD: Ah oui, je le crois, et pour de bonnes raisons. Si je vous donne les statistiques de demande d’autorisation de tournage au Sénégal, depuis une dizaine d’années, la part entre les fictions et les documentaires, c’est le documentaire qui vient largement en tête avec près de 70% des films tournés. Les jeunes provenant des écoles de cinéma, leur première création c’est le documentaire. Ce sont des films très intelligents qui traduisent des réalités sociales, qui aident à avoir une bonne lecture.
Si ceux qui veulent changer un pays se basaient sur les différents documentaires, on pourrait améliorer certains aspects de nos comportements sociaux.
KDO: Et puis on peut mesurer aussi l’évolution et les aspects sociaux grâce aux documentaires et aux images d’archives?
HD: Nous avons un projet décentralisé. On veut équiper les régions car nous avons un patrimoine tellement im- portant qui tombe en désuétude, en train de mourir de sa propre mort. Malheureusement il n’y a pas d’archives sur ces monuments du savoir traditionnel, en cours de disparition. Rien n’a été fait pour conserver ce patri- moine. Notre stratégie est que dans un proche avenir, nous allons faire une tournée nationale dans le cadre d’une caravane de films sénégalais, nous allons poser des actes concrets pour la conservation du patrimoine existant. Egalement, ces jeunes opérateurs qui sont dans l’audiovisuel, nous voulons les professionnaliser, les amener à aimer ce travail en les formant, en les dot- ant aussi d’outils de travail.