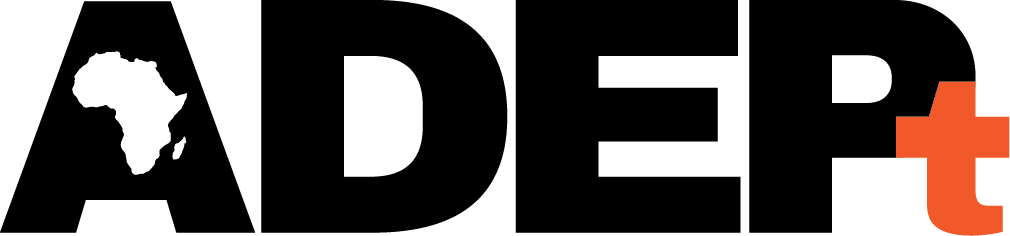INTERVIEWS
INTERVIEW DE DOROTE DOGNON REALISATEUR
DIRECTEUR DE LA CINEMATOGRAPHIE NATIONALE DU BENIN
DD: Je m’appelle DD: , je suis réalisateur de formation, j’ai fait mes études en Chine, j’ai mon doctorat d’Etat en cinéma et je suis le Directeur de la Cinématogra- phie Nationale du Bénin. Ça fait un an et deux mois que j’ai pris cette fonction. Alors l’état des lieux quand j’ai pris mes fonctions, les gens ne croyaient pas au cinéma béninois, que ce soit fiction ou documentaire, car c’est un cinéma qui n’a pas de marché. Et s’il n’y a pas de marché ça s’explique… Il y a les salles de cinéma qui sont fermées au Bénin et nous avons le Nigéria à côté qui nous bombarde de films, et il y a aussi la Côte d’Ivoire et le Burkina. Avec la mondialisation, le Bénin n’a pas pu résister à cette invasion d’images, mais néanmoins des gens dans ce domaine se débrouillent. Des gens qui ont fait du théâtre, qui se reconvertis- sent, prennent une caméra numérique et copient le style du Nigéria. Quand nous avons pris la direction, le constat c’était quoi? La plupart des étudiants, en dehors de ceux qui ont été formés à l’ISMA, n’avaient pas de formation. Il fallait attaquer le volet forma- tion. Quelle formation? Ce n’est pas une formation de longue durée, ce sont des gens qui ont déjà une base et qui savent comment tenir une caméra. Il faut les former en commençant par l’écriture du scénario. Nous avons donc animé un atelier, dans la fiction, mais aussi dans le film documentaire. Nous avons aussi initié une forma- tion qui va commencer incessamment, toujours dans le même cadre, des gens ayant déjà une base au niveau de la caméra, au niveau de la réalisation, du son, et on – c’est à dire surtout les étudiants de l’ISMA – va faire le tour du pays… On a pu négocier une coproduction avec la Chine. Le vrai problème qui se pose au Bénin, c’est qu’il n’y a pas de grande société de production, donc les étudiants apprennent la théorie et aussi la pratique. Mais ils ne vont pas dans la production, donc on s’est dit qu’il faut tout faire, chaque année pour qu’il y ait une production plus importante, aussi bien dans le domaine documentaire que dans la fiction. On aimerait commencer avec la fiction et avec la Chine, nous som- mes en train de le faire. Nous avons dit qu’il faut aussi rouvrir les salles de cinéma. Au Bénin les réalisateurs ne vivent pas de leur œuvre car il n’y a pas de marché. Les films qu’ils font actuellement sont sur support VCD et non sur DVD. Et c’est en support VCD qu’ils sont piratés. Il y en a peu, car la plupart sont financés, sponsorisés avec à peine deux millions, trois millions de CFA. Et leurs films ne sortent pas du Bénin. Il n’y a pas de vrai marché. Nous avons proposé de rouvrir les salles de cinéma afin d’y faire revenir le public.
KDO: Donc au niveau de votre travail comme Directeur du Centre National de Cinéma vous avez des projets d’ouverture de salles de cinéma sur le Bénin?
DD: Nous sommes en train de faire l’état des lieux. On voulait que le patrimoine des salles soit réparti entre le public et le privé, afin que l’Etat seul ne soit pas proprié- taire des salles. On veut les ouvrir, en les faisant gérer par des privés et voir dans quelle mesure le gouvernement va soumettre les cahiers de charges pour l’exploitation de ces salles au Bénin. Surtout l’objectif principal est de recréer ces écrans pour retrouver un public.
KDO: Pour avoir une audience.
DD: Oui pour une audience. Nous avons pensé aussi à l’éducation du public. C’est un volet qu’on néglige. Quand on fait un film, c’est le public béninois qui a perdu l’habitude d’aller dans les cinémas. Donc nous avons aussi pensé à l’éducation du public. Et là, on a parlé de l’école et du cinéma. On veut aller vers les étudiants, les élèves peuvent devenir les acteurs de ce métier. En impliquant leurs parents. Ils vont com-mencer par s’intéresser parce qu’il y en a beaucoup qui ne savent plus ce qu’on appelle le cinéma. Il faut les éduquer. Nous avons aussi le volet de l’équipement. L’investissement est important, mais il peut y avoir un retour sur investissement. L’Etat doit avoir l’obligation de développer le cinéma. Et l’équipement coûte cher.
Nous avons pensé aussi à renforcer les festivals parce qu’en dehors des projections, il y a de multiples activités qui permettent aux jeunes de se former. Et les jeunes vont confronter leurs œuvres aux œuvres d’autres pays, cela afin d’élever le niveau qualitatif des films. Nous avons parlé de formation, de l’ouverture des salles.
Le cinéma, il faut également l’exporter, car si on con- sidère uniquement le marché béninois, cela est très lim- ité. Il est donc nécessaire que les films documentaires puissent être co-produit avec la France. Il faut que les télévisions puissent acheter mais il y a des normes, des qualités à respecter.
KDO: Vous pensez qu’il y a des possibilités de faire des partenariats avec d’autres festivals de la sous-région?
DD: Oui, ça fait partie de nos objectifs. Au Bénin, nous sommes neuf millions d’habitants. Sur les neuf millions d’habitants, combien voient des films? Il y a à peine deux millions, trois millions… je ne veux pas faire des statistiques. Pour avoir un marché il faut aller vers la sous-région d’abord. Et l’année passée nous avons initié l’idée de créer un marché de la cinématographie en Af- rique de l’Ouest. Nous avons initié un partenariat avec la Côte d’Ivoire, le Mali et le Niger. Pour qu’un film tourné au Bénin, par exemple, puisse être vu en Côte d’Ivoire et au Burkina et vice versa.
KDO: Donc ce que je voudrais vous demander, c’est par rapport à l’histoire justement des sociétés de vente, par rapport aux structures de distribution, par rapport au marché africain, est ce qu’aujourd’hui il existe une représentation de vendeurs internationaux pour les films africains?
DD: Ici, non, seulement en Europe. En Afrique je ne sais pas si cela existe. Au Burkina, il y a un jeune qui fait beaucoup de choses dans ce domaine.
KDO: Qui est un vendeur international, qui vend des films?
DD: Oui au Burkina.
KDO: En termes juridiques, est-ce qu’il existe des avocats spécialisés pour la question des droits d’auteur, ici au Bénin?
DD: Oui, nous avons un bureau des droits d’auteur. Le directeur se charge de ça. C’est vrai que c’est surtout dans le domaine de la musique, du théâtre. Mais le cadre est là. Actuellement, il n’y a pas encore de films béninois sur le plan international. Ceux qui font des films sur le plan international, ce sont des Béninois in- stallés en Europe. Mais la demande est là. Nous avons un bureau de droits d’auteur mais nous n’avons pas d’avocats spécialisés dans le domaine du cinéma.
KDO: Il faudrait envisager éventuellement la formation de juristes et d’avocats spécialisés dans la production des droits d’auteur et des droits audiovisuels.
DD: Tout à fait.
KDO: Sur l’estimation des films documentaire existants. Des documentaires ont été réalisés au Bénin après les années 1960, et durant les années 1980 les documentaires étaient tournés en super 16 mm. Aujourd’hui y a-t-il des archives d’actualité conservées de ces périodes?
DD: Non. Euh! C’est en France. J’ai vu la directrice de la cinématographie française et elle m’a promis de m’envoyer ces films. Mais il n’y a pas de cadre, il n’y a pas d’entretien, même si c’est sur dvd, les conditions de conservation ne conviennent pas. Il n’y a pas de cinémathèque au Bénin. Il est préférable de conserver les éléments en France et lorsque le Bénin sera prêt on pourra les réintégrer.
KDO: Ça veut dire que la France cède des droits des films d’actualités des années 1960 c’est-à-dire des films du début des indépendances. Jusque dans les années 80, 85, on a tourné en 16mm en 35, est-ce que ces droits-là sont acquis pour le Bénin libérés au niveau du droit français? Aujourd’hui, si un réalisateur béninois veut faire un documentaire sur le début des indépendances, il peut aller demain à la cinémathèque française, et là, avoir libre ac- cès à ces archives?
DD: La directrice de la Cinémathèque Afrique de Paris me l’a dit oralement mais je n’ai rien reçu d’officiel de sa part. Je l’ai rencontrée ici à Ouida et elle m’a simple- ment suggéré de faire la demande. Je lui ai expliqué que si je n’ai pas encore fait la demande, c’est que je n’ai pas les moyens de procéder à un stockage correct.
KDO: Et aujourd’hui le problème par exemple de la diffu- sion des films documentaires qui existent déjà, qui ont été produits au Bénin et qui ont été réalisés…Est ce qu’il y a un plan d’action pour la restauration de ces films?
DD: Oui, c’est ce que je disais, nécessairement pour restaurer, il faut savoir dans quelles conditions stocker les éléments. Et c’est pourquoi j’insiste sur l’idée de créer une cinémathèque au Bénin. Nous avons besoin de conserver notre mémoire. Elle est indispensable. Il y a des gens qui ont fait un travail extraordinaire avec une certaine rigueur. La nouvelle génération, non seule- ment doit connaître son passé, mais doit également le réapprendre. Il y a donc ce projet de Cinémathèque du Bénin qui devient indispensable.
KDO: Ici par exemple, au niveau d’une coproduction d’un film béninois – documentaire ou fiction – quels sont les guichets où vous, en tant directeur, vous pouvez aller chercher des systèmes de coproduction avec le Bénin.
DD: Oui c’est notre pays toujours, la France, et surtout après il y a la Belgique il y a l’Union Européenne qui peut intervenir. Mais il faut savoir que le vrai problème que nous avons maintenant c’est la compétition. Il faut produire des dossiers et c’est aussi un métier. Le Bénin n’a pas vraiment de spécialiste dans ce domaine. De la production. Ce sont surtout les jeunes qui ont vérita- blement ce problème. Ils vont être confrontés aux ainés qui peuvent être leurs concurrents. La nécessité d’avoir quelqu’un qui sait monter des dossiers de production est important. Faire une formation dans ce domaine est également indispensable.
KDO: Oui parce que le montage des dossiers destinés à la communauté européenne est assez difficile et complexe.
DD: Il faut former des personnes capables de monter ces dossiers sur le plan international.
KDO: Est-ce que vous pouvez me parler par exemple des accords éventuellement que vous avez passés avec la Chine, sur les apports en industrie et dans le cadre d’accords de coproduction particulièrement au Bénin. Est-ce que vous avez l’expérience de la Chine où vous avez vécu, et pour vous est-ce que c’est intéressant de collaborer et de faire des coproductions avec les Chinois, et quelles sont les possibilités envisageables?
DD: Ah! Probablement c’est vraiment intéressant de faire des propositions à tous les pays, non pas seulement en Chine. Moi, la chance que j’ai c’est que je connais le milieu, c’est pourquoi j’ai eu cette facilité. Ma politique est de faire des demandes de fonds afin d’obtenir des caméras et du matériel technique. Si c’est un projet de cinq cent millions de franc CFA, ils vont financer à rai- son de trois cent millions. Donc c’est tout l’équipement de tournage qui va venir de Chine. Ils peuvent inter- venir dans la post-production, et peuvent également déplacer une équipe technique. La pellicule, la caméra, la lumière, les grues, tout peut venir de Chine.
KDO: C’est une coproduction de partenariat, ils amè- nent l’équipement technique et sur place ils vont former des gens?
DD: C’est aussi une école.
KDO: C’est aussi une école et après, vous aller faire des films avec eux. Y a-t-il un système d’accroche de l’audience par la publicité au niveau de la télévision?
DD: Oui, il y a quelques têtes d’affiche qui le font mais le problème c’est que ceux qui font cette publicité, ne sont pas des gens qui ont une formation- comment- capter l’audience? Ce sont des gens qui font du théâtre, du cinéma et c’est eux qui utilisent leur cote de popu- larité. Mais on a constaté que c’est un peu monotone. La monotonie ne dépend pas d’eux parce que ce sont des gens qui n’ont pas appris. On a une seule télévision maintenant les gens savent déjà que pour faire passer son produit il faut nécessairement faire une publicité. Mais le problème qui se pose c’est qu’au Bénin les gens reçoivent des chaînes internationales. Ils reçoivent aussi la publicité sur les chaînes internationales. Si on fait une comparaison, on voit que ce qui se fait ici n’est pas vraiment de qualité d’où le problème de formation qui se pose. Parce que presque tous les Béninois ont main- tenant la télévision nationale qui couvre tout le pays.
KDO: Comment envisager vous de faire face à la piraterie?
DD: Le système actuel au Bénin encourage la piraterie. Ici, il n’y a pas cette politique offensive du Nigéria. Du moment où vous commencez à faire un seul cd, c’est vous qui permettez aux gens de pirater. Donc les films sortent, on interdit les DVD d’abord. On va faire une programmation, il n’y aura pas de DVD. Il faut d’abord exploiter dans les salles de cinéma, et après une péri- ode de trois à cinq mois, ou bien un an, on démarre l’exploitation des DVD. Parallèlement nous sommes en train de signer un partenariat avec tous les corps armée, police, gendarmerie. Les militaires sont répartis sur le territoire national et vont nous permettre de contrôler les entrées.
KDO: L’entrée des dvd piratés du Nigéria?
DD: Jusqu’à présent c’est toujours au Nigéria que cela se fait.
KDO: Vous dites qu’il n’y a plus du tout de salles de cinéma au Bénin alors que les salles existaient, elles étaient là, ce sont des salles qui étaient équipées en 35mm.
DD: En 35mm.
KDO: Est-ce que vous pensez qu’il y a une possibilité de rééquiper ces salles en haute définition numérique?Aujourd’hui le 35mm n’existe plus, ça veut dire que toutes ces salles qui étaient équipées en 35m, il faut quasiment toutes les rééquiper?
DD: Naturellement, parce que nous voulons faire quelque chose dans une période où il y a quelque chose en vogue, quelque chose de pratique. On ne peut pas faire des salles maintenant et donner la priorité au 35mm! On va donner la priorité au numérique. Il faut malgré tout, ne serait-ce qu’une salle en 35mm. Quand des films en 35mm arrivent, on ne trouve pas un endroit pour les projeter. Donc nous étudions le projet de faire un multiplex et dans ce multiplex il y aura au moins une salle en 35mm et les autres seront en numérique.
KDO: Nous avons parlé de l’ISMA qui est une école audiovisuelle mais je pense qu’il faut aussi mettre en relation les écoles de cinéma avec les écoles de journalisme pour pousser le niveau de l’écriture qui est un point faible du cinéma africain en général. Etablir un lien, faire des ateliers d’écriture entre les gens qui font la fiction le docu- mentaire et le journalisme, et de l’autre coté pour trouver des sponsors sur le territoire localement et peut être aussi approcher les écoles de management. Qu’est-ce que vous en pensez?
DD: Tout à fait. C’est en cela que je dis qu’il faut penser au public parce que le cinéma c’est un produit et un produit doit avoir un marché et on ne pense pas, ici on produit, et on ne pense pas au marché. Il faut néces- sairement que, surtout les cinémas qui forment les jeunes, il faut nécessairement qu’ils aient des aînés ayant déjà cette expérience. Donc, c’est ce que le fondateur a compris parce qu’il travaille avec l’ORTB et également avec d’autres partenaires. Maintenant le marketing c’est très très important, les gens ne savent pas comment aller vendre leurs produits et moi je pense que l’économie du cinéma peut démontrer que le cinéma est un produit culturel.
INTERVIEW DE ANSELME AWANOU DIRECTEUR DU CIRTEF AU BENIN, FORMATEUR, MONTEUR
CIRTEF: Conseil International des Radios et Télévisions d’Expression Française siège Bruxelles
KDO: Voilà, on va démarrer et puis vous allez me dire un peu votre parcours, comment vous êtes arivé aujourd’hui à ce poste-là? Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer ce que fait le CIRTEF aujourd’hui?
AA: Je suis monteur formateur pour le secteur et en même temps responsable du CIRTEF à Cotonou.
KDO: Et pouvez nous nous expliquer ce qu’est le CIRTEF ici dans la sous-région?
AA: Bon le CIRTEF c’est le Conseil International des Radios et Télévisions d’Expression Française et dont le siège, le secrétariat est à Bruxelles. CIRTEF Coto- nou a été créé en 1995 et sous un accord du siège avec le gouvernement béninois et depuis lors nous sommes là et nous faisons tout ce qui est film documentaire et fiction surtout en partenariat avec les télévisions francophones d’Etat.
KDO: Les télévisions francophones d’Etat? Et pouvez- vous me dire quels sont les pays qui viennent faire la post-production chez vous au CIRTEF, les pays de la sous-région et d’ailleurs?
AA: Il faut dire qu’à sa création en 1995, jusqu’en l’an 2000, le CIRTEF recevait presque toutes les télévisions francophones publiques, que ce soit d’Afrique ou du monde entier. On a eu à post produire des documents venant du Vietnam, du Canada, de la Suisse, surtout avec les premières séries que nous appelons habitats traditionnels. Le CIRTEF a eu à travailler avec 7 té- lévisions du Nord et du Sud francophone.
KDO: Et à partir de 2000?
AA: A partir de 2000, le CIRTEF a créé d’autres centres, le Centre de Yaoundé, le Centre de Niamey et le Centre de l’Ile Maurice. La plupart de nos réal- isateurs, qui viennent ici, sont des télévisions franco-phones dispatchées au niveau de ces trois centres selon la programmation. Au niveau de Bruxelles et selon les thématiques, les Ivoiriens, les Togolais, les Guinéens, les Marocains peuvent se retrouver à Cotonou ou à Niamey dans l’un des centres pour produire leur films.
KDO: Quels sont les chiffres que vous faites en post-pro- duction par an, en documentaire et en fictions.
AA: Quand nous avions commencé, on était à plus de 40 documentaires par an parce que dans l’année on peut avoir 3 séries, et chaque série peut mobiliser 8 pays. Vous voyez à peu près le nombre de docu- mentaires entre 1985 et 2000. Ensuite, le rythme des productions a diminué du Centre de Cotonou puisqu’il y a aussi les autres centres.
KDO: Quels sont les autres centres?
AA: On peut avoir maintenant 3 séries qui peuvent impliquer 4 pays c’est soit le Togo, soit le Bénin, soit le Mali et le Niger. Il faut dire que les réalisateurs des pays dans lesquels se trouvent les centres restent dans leur pays d’origine. Lorsqu’un béninois ne peut pas aller à Niamey pour produire son film, il reste ici à Cotonou. De même pour Niamey et Yaoundé. Donc depuis 2000, nous ne recevons plus de producteurs venant du Cam- eroun, de Niamey pour la post-production. Mais pour les ateliers, ils viennent ici. Comme ils ont un centre dans leur pays d’origine, cela a permis d’amoindrir les coûts au niveau du CIRTEF.
KDO: Et sinon ce que je voulais vous demander, sur quelle base technique vous travaillez en post-production?
AA: Je loue les efforts des responsables CIRTEF. Chaque année nous faisons la demande pour être à la page, être technologiquement à jour. Aujourd’hui à Cotonou nous pouvons travailler sur n’importe quelle plateforme, soit Avid, ou Final-Cut, ou Adobe qui est le logiciel le plus répandu actuellement en Afrique. Nous avons 3 salles de montage et une salle de mixage.
KDO: Une salle de mixage?
AA: Oui! Pour deux monteurs et un mixeur et du point de vue matériel, magnétoscope, nous avons presque tous les gammes, on peut travailler en DVCAM, on peut travailler en HD, on peut travailler aussi en HDV; c’est notre dernière acquisition.
KDO: Lorsqu’un documentariste vient d’une télévision d’un autre pays, il arrive et repart avec un produit fini?
AA: Ils participent d’abord à un atelier de scénarisation pour mettre à niveau tous les scénarios. Il faut que ça rentre dans un format. Ainsi on définit tous les con- tours, les formats.
KDO: Les activités d’écriture?
AA: Les activités d’écritures ont lieu dans un centre ou bien dans un pays. Soit dans un des centres, à Cotonou ou à Niamey. Après cette étape ils rentrent dans leur pays d’origine. Ensuite ils tournent, font la maquette qu’ils renvoient au siège du CIRTEF ou à l’atelier de formation que le CIRTEF organise tous les ans dans l’un des pays membres. Après le visionnage des ma- quettes il y a des recommandations. Si une maquette est relativement aboutie, le projet entre en post-produc- tion soit à Cotonou, soit à Niamey ou au Cameroun.
KDO: Quelle est la durée de la post-production chez vous?
AA: Nous avons deux fonds, il y a les fonds qui consacrent les séries pour les séries du CIRTEF et il y a aussi le fond TV5-CIRTEF. Pour les séries TV5-CIRTEF c’est toujours en partenariat avec les télévisions publiques d’Etat et c’est une co-produc- tion où les télévisions mettent plus de moyens. Les réalisateurs viennent dans les différents centres, ils n’ont que 5 jours, c’est peu, mais comme la tech-nologie a évolué, on essaye de dire à ces réalisateurs de travailler sur les disques durs, de “digitaliser”, d’avoir toute la matière numérisée. Une fois ici, nous tentons d’améliorer le document. Pour les séri- es subventionnées par le CIRTEF en co-production, il peut y avoir deux semaines de post-production où on reprend la maquette, on reformate, on travaille sur les voix. Pour enfin sortir le produit, le PAD dif- fusable, voilà!
KDO: Vous pouvez nous parler de la plateforme AIME, – ce logiciel apparemment d’une base de données imaginé à la base par le CIRTEF – pour faire la sauvegarde des archives de tous les documentaires produits chez vous, ou sur lesquels vous avez des partenaires coproducteurs?
AA: Le CIRTEF a mis en place cette plateforme AIME qui existe depuis plus de dix ans. Mais ces dernières an- nées, il a subi une évolution ce qui a fait que le centre de Cotonou est doté de cette plateforme. L’année passée, avec l’aide de l’UNESCO, nous avons organisé un atelier pour sept télévisions d’Etat. Leurs informaticiens sont arrivés ici pour être bien outillés avec ce nouveau système AIME qui est le système d’archivage.
KDO: Ces sept télévisions d’Etat sont équipées aussi du système AIME?
AA: Oui, ces sept télévisions sont équipées du système AIME. Il s’agit du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du Togo, du Niger, du Mali et du Sénégal. Disons presque toute la sous-région ouest-africaine.
KDO: Et eux ils étaient équipés avec le système AIME au niveau des télévisions depuis combien de temps?
AA: Je pense que ces dernières années presque toutes les télévisions sont déjà dotées de ce système d’archivage AIME. Ici au centre nous avons la nouvelle version qui va nous permettre de numériser ou bien d’archiver tout ce que nous avons comme production, cela depuis l’ouverture du centre.
KDO: Y a-t-il une bonne partie déjà archivée?
AA: Oui il y a une bonne partie qui était déjà ar- chivée sur les supports DVCAM et DVD, mais nous avons commencé petit à petit à les rentrer dans la plateforme AIME, ça nécessite beaucoup de temps, mais on s’y attelle.
KDO: Et d’un autre côté, je voulais vous demander par rapport au documentaire, à votre avis qu’est ce qui fait que les télévisions nationales programment peu de documen- taires au niveau de la diffusion nationale, c’est à dire que la programmation du CIRTEF en documentaire est utilisée par exemple sur CFI et TV5 mais qu’au niveau national, le repêchage de ce genre de documentaires est très faible.
AA: Oui, il faut remarquer que pour la plupart des télévisions africaines, c’est l’actualité, la politique qui occupent presque la majorité des temps de diffusion. Cela ne nous laisse pas assez de temps pour les films documentaires. Un autre aspect ce sont les telenovelas qui remplissent nos écrans parce que les télévisions ont besoins de ressources, sont obligées d’aller louer ces heures de diffusion à d’autres structures de production. Elles font diffuser ces telenovelas sur nos chaînes et toutes ces productions remplissent la grille de program- mation. Pour le film documentaire il faut dire aussi qu’au niveau de nos télévisions, il n’y a pas d’initiatives pour faire de très bons documentaires. Des magazines, des reportages sont faits, ils disent que ce sont des documentaires. Le documentaire a un coût, nos télévi- sions ne sont pas prêtes à y mettre assez de ressources d’où la co-production avec le CIRTEF. Malgré cela, on remarque qu’il n’y a pas assez de plages de diffusion pour ces documentaires et il faut dire que quand une télévision participe à une production du CIRTEF, si c’est 10 pays qui participent, la chaîne reçoit 10 émis- sions gratuitement mais je ne comprends pas pourquoi ils ne programment pas ces différentes productions.
KDO: Même lorsqu’on leur donne dix documentaires gra- tuits – parce que déjà produits par le CIRTEF et les gens de la sous-région?
AA: C’est une co-production!
KDO: C’est une co-production, ils ne diffusent même pas ces documentaires?
AA: Je ne sais pas pourquoi!
KDO: Et comment faire pour lutter contre ça? Comment pensez-vous qu’on puisse réussir à trouver une solution pour que ces documentaires soient présentés? Est-ce qu’il faut créer une agence spécifique du documentaire et faire du lobbying?
AA: Comment dirais-je? Il faut séparer tout ce qui est actualité et service de production. Il faut une grille de programmation stricte qui essaie de respecter les dif- férents genres, si c’est des telenovelas, il ne faudrait pas que durant toute la semaine on nous projette des séries brésiliennes et autres, il faudrait qu’on alloue des espac- es à des films documentaires. Pour faire cela, il faudrait qu’on scinde les actualités. Tous ceux qui s’occupent de la politique de la production.
KDO: Ce qui est paradoxal, c’est de constater que même aujourd’hui en 2013, il y a des écoles de cinéma, il y a des écoles d’audiovisuel à Cotonou, un peu partout sur la région, au Burkina Faso aussi, et qu’il y a moins de place pour les documentaires. En même temps on forme des jeunes à travailler dans l’audiovisuel. Quelle est la finalité pour ces jeunes-là, si ce n’est que pour travailler à la télévision et ne faire que des actualités.
AA: Mais il faut dire que c’est un problème très im- portant que vous soulevez, car il ne suffit pas seule- ment de former. Si vous formez les jeunes il faut leur donner les moyens pour pouvoir faire des films et vivre de ça. Or, la filière documentaire ce n’est pas donné à n’importe qui. Il faut que vous soyez bien outillé pour aller affronter les gens, car qui parle de documentaires, parle de réalité. Si je veux faire un film documentaire et que je choisis la thématique, il faut que je sois bien armé, bien cultivé, pour pouvoir affronter tous les intervenants que j’aurai dans mon documentaire. Est ce que ces jeunes-là ont cette for-mation? Certes on leur apprend les rudiments à l’école mais il faut déjà des leviers… qui sont dans le métier pour les entraîner, mais on n’a pas ces leviers. Tous les gens que nous avons à la télévision ne font pas de documentaires. Sans l’initiative du CIRTEF, on ne parle pas de production documentaire à la télévision. Il n’y a que des reportages. Pas mal de réalisateurs ont été formés et sont à la télévision. Mais ils ne foutent rien. Ils travaillent, mais pas sur des sujets auxquels ils ont été formés. C’est vraiment écœurant parce que les sujets ne manquent pas, et quand vous prenez les jeunes, ils n’ont pas de financement pour produire, ils ont beau écrire, ils ont des thématiques, ils viennent vous voir pour dire « Je veux faire ceci, je veux faire cela », mais ils n’ont pas les moyens.
KDO: Est-ce que c’est lié au fait qu’il y a une scission – je pense globalement dans quasiment tous les pays afric- ains -, un clivage entre le Centre National de la Ciné- matographie et le monde de la télévision? Il n’y a pas vraiment de connexion car il y a possibilité de faire des partenariats mais les gens du cinéma, les gens qui font du documentaire cinéma, ne sont pas en connexion avec les réalisateurs de la télévision. Est-ce qu’il y aurait la pos-sibilité d’essayer de trouver une plateforme intéressante, demander aux gens du cinéma, du documentaire de faire une formation, pour qu’il y ait une vraie collaboration?
AA: Oui, une vraie collaboration, quand vous prenez les centres de cinématographie dont vous parlez, qu’est-ce qu’ils font? Nous avons un centre de ciné- matographie, mais moi je ne vois pas de films qui sortent. Si ce sont des fictions, ils ne sortent pas! Mais tous ceux qui font des productions de films docu- mentaires ou bien des reportages c’est avec la télévi- sion, parce que le format est là. Aujourd’hui c’est la vidéo, et la vidéo, c’est la télévision. Aujourd’hui la vidéo a gagné. Il n’y a pas de structure ici digne de ce nom ayant toutes les plateformes de production. Vous pouvez avoir des structures qui ont le matériel de tournage mais du matériel de post-production, il n’y en a pas du tout. Vous voyez une agence de post- production ou bien de production, vous entrez là, qu’est-ce que vous trouvez? Deux à trois caméras, un ordinateur et c’est fini! Cela ne peut pas booster la production cinématographique ou bien documentaire dont vous parlez, et quand je prends cette direction-là, de la cinématographie et le fonds d’aide à la culture, toutes ces structures, qu’est-ce qu’elles font? Elles ont des enveloppes pour permettre aux jeunes de produire, mais ces enveloppes là, où est-ce qu’elles vont? Pas dans la production, pas du tout, mais nous nous sommes là depuis 17 ans. C’est rare qu’on travaille avec le privé, ils viennent à nous pour post-produire. Puis on leur dit voilà les conditions dans lesquelles nous travaillons, pour un film de 52 minutes, il faut 3 semaines, ils disent que c’est trop coûteux! Alors qu’en fait, ils ont un budget, tous les postes sont définis et ils veulent faire des économies au niveau des charges de la post-production, ce n’est pas bien! Ce n’est pas possible! Donc il y a des productions, mais ces pro- ductions ne sont pas de bonne facture.
KDO: Par rapport aux documentaires du CIRTEF dont vous finalisez la post-production, quels sont vos partenaires au niveau des festivals, est-ce qu’il y a des documentaires du CIRTEF qui font des festivals dans la sous-région ou dans le reste du monde?
AA: Bon, presque la plupart des festivals de la sous- région. Chaque année, il y a le CIRTEF qui essaye d’identifier ces festivals, de positionner ses films. Il n’y a pas plus de 3 mois, j’ai reçu une fiche où je devais compléter les informations pour le festival de l’URT. Un film que nous avons post-produit ici, un film béninois est positionné au niveau de ce festival.
KDO: Quel festival?
AA: Le festival de l’URT (Union des Radios Télévi- sions), qui organise des festivals pour les télévisions, il y a aussi le FESPACO chaque année il y a au moins le CIRTEF qui positionne des films, il y a aussi Vues d’Afrique.
KDO: Vues d’Afrique au Canada.
AA: Au Canada aussi, il y a pas mal de festivals où le CIRTEF essaye de placer ses productions, ses films documentaires.
KDO: Et ça, c’est le siège à Bruxelles qui s’occupe des festi- vals, de placer les films.
AA: C’est le siège à Bruxelles qui s’occupe de ça, tout ce qui est production c’est le siège, nous nous sommes ici, on exécute, on reçoit les produits, les réalisateurs, on fait la post-production, on essaye de régler tout.
KDO: Est-ce que vous pensez que le documentaire dans une perspective utopique et optimiste, est-ce que vous pensez que le documentaire est quand même l’avenir pour tout ce qui est économie, société, environnement, pour pousser aussi la collaboration des sociétés civiles en Afrique? Pour que la production du documentaire gagne un peu de la hauteur dans les différents domaines, est-ce que vous pensez qu’on peut avoir un lien avec la société civile pour faire du documentaire de plus haut niveau?
AA: Quand on parle de documentaires, c’est à tous les niveaux, on veut des documentaires dans le secteur économique, dans le social. Le documentaire est présent, pas les moyens. S’il y a une structure qui dit « Aujourd’hui moi je finance les films documentaires de bonne qualité », il va falloir mettre en place une struc- ture, d’abord faire appel à la candidature des sujets. Les gens vont postuler, avec un comité rigoureux pour la sélection des sujets. Et un suivi sur tout le parcours réécriture, tournage et post-production, et là on aura des documentaires de bonne qualité. Mais il faut qu’il y ait un fonds approprié à ces productions là, et qu’il y ait des gens soucieux et conscients de la production de films documentaires. Si on prend un administratif pour se dispatcher les sous, si tous les postes sont respectés et que le financement est là, et qu’on arrive à mettre la main sur un certain nombre de réalisateurs sérieux, je pense que les productions de films documentaires, c’est l’avenir pour l’Afrique. Parce qu’on ne peut que révéler ce que nous avons sur tous les domaines, on ne peut pas faire de fictions, de l’imaginaire à tout moment mais le documentaire ça, il va falloir trouver les moyens pour pouvoir l’instaurer en Afrique!
INTERVIEW DE APPOLINAIRE AÏVODJI
DIRECTEUR DE L’ISMA – BENIN
KDO: Pouvez-vous vous présenter?
AA: Je suis cinéaste, directeur de la photographie, et j’ai un Master of Fine Arts. Je suis actuellement le di- recteur d’étude à l’Isma qui a été mis en place en 2006 par son fondateur Monsieur Maturin. C’est un officier de douane passionné par l’image, ils nous a toujours dit « si je n’étais pas douanier, je serais journaliste ». En 2006 il a pris des contacts en France et aux Etats- Unis, et il a fait des démarches au niveau du ministère de l’éducation pour avoir l’autorisation d’ouverture. Dans ses démarches, il a eu des partenaires. Le premier partenaire de l’Isma c’est l’Eica l’école internationale de création. L’Isma forme des journalistes, des JRI comme on les appelle, et la filière est le journalisme audiovisuel qui peut intervenir à la radio comme à la télévision. Pendant trois ans ils sont formés, suivent des cours, et après ces trois années, ils soutiennent un mémoire. Il y a aussi les réalisateurs. L’Isma forme des gens qui ont choisi de faire du cinéma. Il y a des réalisateurs de cinéma, de télévision, eux sont formés durant trois ans et ils reçoivent le diplôme de licence en réalisation cinéma et TV. Mais il y a les métiers de l’audiovisuel, les caméramans, les techniciens du son, les monteurs, les gestionnaires de production. Ceux là font ingénierie et exploitation de l’équipement. Ils font deux ans et ils passent l’examen de l’Etat béninois qui est le BTS. Par- allèlement ils reçoivent aussi un diplôme en interne, le diplômes des techniques audiovisuelles DT et reconnu par l’Etat béninois et le Cames. Donc après ces deux années ils peuvent continuer la formation pour avoir leur licence, un an après. Et puis, ils peuvent continuer pour avoir leur master et je reviens sur les autres filières en disant que ceux qui obtiennent leur licence en journalisme audiovisuel peuvent continuer et peuvent obtenir le master après deux années de formation.
KDO: Donc, le master c’est quatre ans, c’est deux ans pour la licence, deux ans pour le master.
AA: Non c’est trois ans pour la licence, le master c’est deux ans, donc cinq ans pour avoir le master. Pour les réalisateurs, il y a ceux qui obtiennent la licence en réalisation cinématographique, mais ils peuvent continuer et en deux ans, ils obtiennent le master en réalisation cinéma, c’est la même chose pour les métiers de l’audiovisuel, ceux qui ont eu le DUT ou le BTS peuvent obtenir leur licence en complétant un an de formation et en deux ans ils peuvent obtenir un master dans les métiers de l’audiovisuel.
KDO: D’accord et dans le cadre de la formation, est-ce que les jeunes qui sont en formation chez vous arrivent à trouver ou à faire des stages au niveau de la télévision ou au niveau des sociétés de production ici sur le Bénin?
AA: Ah oui, vous avez raison, parce que la formation à l’Institut Supérieur des Métiers de l’Audiovisuel allie la théorie et la pratique. Il y a 30% de théorie et 70% de pratique. C’est par rapport à ça, que nous sommes entrés en partenariat avec les chaînes de télévision, nationales ou privées. Nous sommes en production avec Golf télévision, Canal 3, l’ORTB et TV Carrefour et ainsi de suite, et aussi les radios privées. Parallèlement, nous avons aussi des partenariats avec des structures de production, des structures de communication, et tous nos étudiants font leur stage dans ces structures. Soit, ils choisissent de faire de la radio, ils vont à la radio, c’est vrai que nous avons assez de matériel qui permette aux étudiants de faire de la pratique, mais pour décou- vrir la réalité professionnelle, on les envoie dans ces structures là pour rencontrer, voir les difficultés, mieux connaître le monde de la profession.
KDO: Quel est le pourcentage d’étudiants béninois par rapport au pourcentage d’étudiants de la sous-région? J’ai appris qu’apparemment vous recevez des élèves d’autres pays voisins qui viennent et qui restent ici dans le cadre de leurs études?
AA: Ce que je peux vous dire par rapport au pourcent- age c’est que les Béninois forment 80% de l’effectif et le reste, les 20%, viennent des quinze pays de la sous- région. Actuellement nous avons des étudiants venant de seize à dix sept pays différents. Nous formons des étudiants qui sortent polyvalents, les journalistes que nous formons sont des JRI ( Journalistes Reporters d’Images). Le journaliste est formé, en tant que cadreur, en tant que journaliste, bien sûr, et il est formé en tant que monteur. Quand il prend lui seul sa caméra, il part en reportage, il revient, il peut monter et rendre à la diffusion. C’est la même chose pour les techniciens, ce- lui qui choisit la caméra ne fait pas que la caméra, il fait le son, il fait le montage. Ils sont formés polyvalents, donc ils n’ont pas de difficultés à la sortie. Ou alors ils ouvrent leur propre structure, c’est ce qui est plus facile. C’est ce que font la majorité, et il y a des gens qui sont recrutés par ces structures, là où ils ont fait leur stage. Il y en a d’autres qui sont recrutés au niveau des stations.
KDO: Est-ce que vous faites des résidences d’écriture au sein de l’école?
AA: Ce que nous faisons c’est que bien que le pro- gramme permette aux étudiants d’avoir des cours d’écriture du scénario, nous donnons la possibilité aux étudiants de faire des recherches sur les résidences d’écriture organisées par telle fondation, organisées par tel institut, et ainsi de suite. C’est vrai que ce n’est pas fréquent mais ça arrive.
KDO: Et par rapport à l’école de formation, la spécificité de la protection des droits et des droits audiovisuels, est-ce que c’est un des secteurs prévus dans le cadre de l’enseignement? Car nous n’avons pas sur le continent beaucoup de juristes formés en droit audiovisuel pour faire face à la déferlante des nouvelles technologies liées à l’image dans le système de la mondialisation.
AA: Oui, c’est vrai ce que vous dites, mais nous ne for- mons pas les gens, nous ne formons pas les spécialistes de droit. Nous avons toutefois des matières qui ont rap- port au droit, à la déontologie, à l’éthique. Tout ça pour permettre quand même aux journalistes de connaître leurs droits et devoirs. Ils ont des cours de droit public, de droit pénal.
KDO: Lorsqu’un jeune qui veut faire du documentaire, sort de l’école dans un contexte où – et c’est vrai de toute la région d’Afrique francophone -,les salles de cinéma ont tendance à disparaître; que nous savons qu’il y a des pays où il y avait des centaines de salles de cinéma – je prends le cas de la Côte d’Ivoire que je viens de quitter – et aujourd’hui il n’y en a plus que trois, donc quel est l’avenir de la diffusion du documentaire sur ce continent? Est-ce que nous devons créer et réfléchir à un nouveau mode de diffusion, parce que c’est bien beau de former des gens à faire de l’audiovisuel mais s’il n’y a pas de spectateurs, si la télévision est la seule entité de diffusion c’est insuffisant!
AA: C’est vrai que nous sommes actuellement en train d’appuyer le nouveau directeur de la cinématographie, un homme dynamique qui a été formé en Chine, qui a de l’énergie. Il faut forcément organiser les jeunes, prendre des initiatives, créer des projets pour qu’ils puissent démontrer de quoi ils sont capables. Actuelle- ment, ceux qui sortent de l’Isma ont plein de projets, ce qui leur manque c’est le financement. Ce qui fait que le fondateur de l’Isma a pris la décision, il y a à peine quelques semaines de créer un fonds pour assister les premiers projets des étudiants. On les accompagne un an, deux ans pour qu’ils ne soient pas livrés à eux- mêmes. Ces projets seront diffusés. Nous avons un am- phithéâtre de trois cent cinquante places à l’Isma que nous allons transformer en salle de projection. Et pour cela même nous sommes en partenariat avec le Centre Culturel Français. L’espace sera aussi exploité par le centre culturel français. (Aujourd’hui c’est l’Institut Français). Les films d’étudiants seront projetés et même d’autres films de la sous-région, puisque nous sommes en réseau, nous sommes désormais membre du CILET c’est l’association internationale des écoles de cinéma et de télévision. Désormais le réseau va per- mettre aux étudiants des échanges entre ces écoles.
KDO: Mais c’est une bonne idée de faire un fonds pour les étudiants qui sortent pour qu’ils ne soient pas livrés à eux-mêmes en terme de production, et qu’ils démar-rent. Et je veux vous demander avec quels matériels vous travaillez actuellement dans cette école?
AA: Nous avons des matériels performants, nous som- mes même mieux équipés que certaines télévisions, pour ne pas dire même toutes les télévisions de la place. Nous formons les étudiants avec tout type de caméras, tout type de microphones. Ce matériel audiovisuel peut leur permettre de ne pas être surpris sur le terrain professionnel. Vous prenez n’importe quel étudiant de l’Isma, vous le mettez dans une structure, dans une télévision, il va travailler sérieusement. Tout le matériel dont nous disposons est professionnel.
KDO: Je trouve ça très intéressant, et j’aurais voulu savoir l’approche de votre école par rapport aux mouvements sociaux et aux groupes de la société civile dans ce pays qui mènent des combats sur l’environnement, sur le monde social, sur l’économie. Est-ce que les étudiants ont accès aux gens de la société civile pour organiser des débats, et est-ce que vous avez des intervenants extérieurs en dehors des professeurs pour justement apprendre à ces étudiants à communiquer avec des intervenants extérieurs, c’est à dire des professeurs d’université ou l’équivalent?
AA: Nous avons des matières comprenant des échanges d’expérience et nous invitons des professeurs de haut rang sur tel ou tel cas, ils viennent faire des exposés. Ils échangent avec ces étudiants ou bien ces personnes res- sources. Nous sommes en partenariat avec l’UNICEF, qui vient évidemment une fois l’an pour faire des exposés, ou bien pour faire le point de la situation des enfants dans le monde et ça permet quand même de donner aux étudiants des informations qui leur per- mettent de réaliser des documentaires. Dans le cadre de ces partenariats-là, il y a deux prix qui sont donnés par le CIRTEF chaque année, ça peut être une caméra ou un laptop. C’est en préparation pour cette année, et c’est ce partenariat là qui nous permet de renforcer ces échanges ou ces invitations des personnes ressources. Individuellement je pense que ces étudiants n’ont pas d’initiative, il faut les orienter, les organiser.
Le seul objectif en perspective est de donner des ouvertures à nos étudiants. Il y a des matières qui sont prévues dans leur programme, il y a le management, il y a l’entreprenariat, il y a même le bain linguistique qui est prévu. Ils vont faire deux mois de stage au Crac pour leur permettre de maîtriser la langue la plus utili- sée, l’anglais. Au travers de ces matières, les étudiants découvrent les réalités du management, quelles sont les démarches qu’ils doivent mener pour convaincre un sponsor. C’est vrai qu’il faut rapprocher le partenariat avec d’autres écoles de management pur et dur pour maîtriser plus le domaine là ils ont plus d’outils, plus d’armes pour convaincre. C’est vrai que ce que vous avez proposé il faut le développer.
INTERVIEW DE MONSIEUR BONNAVENTURE ASSOGBA DIRECTEUR DU FONDS D’APPUI A LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE DU BENIN
KDO: Dans un premier temps vous allez vous présenter, dire votre fonction et puis expliquer le Fonds.
BMA: Bonjour, je suis Bonnaventure Assogba, je suis le directeur du Fonds d’Appui à la Production Audiovi- suelle du Bénin. Ce Fonds dépend du Ministère de la Communication et des TIC. Qu’est-ce qui a amené le gouvernement béninois à créer le Fonds en 2008? C’est qu’avant, la direction que j’avais l’honneur de diriger s’appelait, Direction de la Production et de la Presse Audiovisuelle. A l’époque, la plupart des chaînes de télévision et de radio, les productions locales étaient en nombre nettement inférieur par rapport à la masse des programmes qui venaient de l’étranger. Donc, nous som- mes partis de ce constat pour attirer l’attention du gou- vernement sur le fait que le Bénin doit pouvoir traduire ses réalités, ses attentes. Les attentes de la population en support audiovisuel, et la diffusion presque exclusive- ment, c’est à dire à plus 50% , des images venues du Nord. Voilà rapidement la genèse du Fonds. Le Fonds s’adresse à qui? Le Fonds s’adresse aussi bien aux sta- tions, aux organes audiovisuels, qu’aux télés, radios pub- liques et privées. Ce sont des organes structurés. Dans un deuxième temps, le Fonds s’adresse aussi aux agences de production audiovisuelle établies en République du Bénin, c’est-à-dire ayant un registre de commerce. Et dans un troisième temps, le Fonds est ouvert aussi aux professionnels indépendants, c’est-à-dire les sociétés de production qui présentent les garanties nécessaires de compétences pour la faisabilité d’une œuvre ou d’un objet. Donc, voilà à qui le Fonds s’adresse.
KDO: Et pour l’année 2013, quel est le budget du Fonds?
BMA: Bon! Pour l’année 2013, le budget que nous som- mes en train d’exécuter comporte trois volets. Je ne sais pas si c’est le volet consacré à la production qui vous intéresse puisque les deux autres volets en dehors de la production c’est le renforcement de capacités des pro- fessionnels qui sont déjà dans le milieu, dans le secteur de l’audiovisuel et le dernier domaine c’est la diffusion; comment faire pour que les œuvres que nous appuyons puissent être vues aussi bien au Bénin qu’ailleurs. Donc pour cette année 2013, concernant le volet production audiovisuelle nous sommes autour d’un peu moins de cent millions pour ce volet.
KDO: Et comment expliquez-vous, par exemple ici au Bénin, nous constatons – pas seulement au Bénin – mais dans toute l’Afrique francophone, la disparition des salles de cinéma? Au moment où l’on a le plus d’images, com- ment expliquer la disparition des salles de cinéma?
BMA: Il faut dire que moi je m’occupe essentiellement du petit écran.
KDO: D’accord, essentiellement de la télévision.
BMA: Donc nous avions fait la recherche sur la ques- tion mais comme au Bénin, l’organisation administra- tive voudrait que le cinéma, le grand écran, les salles, soient au niveau du Ministère de la Culture où il y a un directeur de la cinématographie, je préfère vraiment que ceux qui s’occupent de la cinématographie puis- sent répondre à la question. Sans quoi, on a notre idée. Mais ce que je peux dire, si je puis me permettre, c’est qu’aujourd’hui, bien que la division du travail admi- nistratif soit ce que je viens de vous dire, à propos du Fonds d’Appui à la Production Audiovisuelle, celui-ci appuie des œuvres de télévision pour la diffusion, et de temps en temps nous faisons des projections sur grand écran. Donc les salles nous intéressent puisque nous finançons, appuyons financièrement le film documen- taire mais nous finançons aussi les téléfilms. Nous réservons une part du budget pour les téléfilms. Et en dehors de la télé, il y a un prolongement dans les salles. A ce titre, nous nous intéressons aux salles, au grand écran, pour diffuser ce que nous faisons. Je ne peux vous répondre sur la raison de la disparition des salles de cinéma. Au niveau de la direction, nous nous battons pour que nos œuvres, les œuvres que nous appuyons pour le petit écran puissent être vues sur grand écran. Et nous avons partagé avec les Burkinabés au mois de mars 2000 une expérience où on essaie de faire revivre les salles.
KDO: Oui parce que au Burkina, c’est l’exception culturel- le du Burkina où il y a encore 12 salles dans le pays .
BMA: Oui, ils ont connu aussi leur traversée du désert où il y n’avait presque rien, mais ils sont entrain de remonter la pente. Nous sommes allés au Burkina, et lorsqu’on est revenus, nous avons enclenché un travail avec les cinéastes qui ont des œuvres ici, pour que ces films puissent être vus aussi dans des salles. Il y a des promoteurs béninois qui investissent dans les salles. Nous avons une très belle salle aujourd’hui à Cotonou. Et puis on a d’autres initiatives. Même au niveau du documentaire, pour certaines œuvres nous allons tenter l’expérience de l’exploitation, et nous pensons pouvoir faire des entrées – peut-être plus d’entrées que pour les films de fiction dans les salles. Je vous donne juste l’exemple du film sur le roi Béhanzin, -le roi Béhanzin c’est un roi du Dahomey qui s’était opposé à la colo- nisation française. Il y a un réalisateur de la télévision béninoise, M. André Jonson, qui a réalisé un documen- taire en 2008 sur ce roi et nous pensons que, vu le sujet et son contenu, si on tente par exemple de mettre des sujets comme celui-ci dans les salles, les gens peuvent être au rendez-vous. Donc nous ne sommes pas com- plètement insensibles aux salles. Pour mettre en œuvre notre politique de diffusion, en appui à ce que nous avi- ons fait au niveau des villages et des campagnes. Nous avions signé des contrats de diffusion avec le CNA (Cinéma Numérique Ambulant) qui a montré en 2009 une dizaine de documentaires et des fictions dans les village, et nous avons constaté l’engouement du public. Je peux vous dire que les films documentaires ont eu autant de succès que les fictions.
KDO: Donc ça veut dire qu’il y aurait éventuellement un engouement de la population pour les documentaires, si on rouvrait des salles de cinéma.
BMA: Maintenant, il faut passer à l’exécution du pro- gramme et évaluer en fin d’année, pour voir ce que cela va donner. Et puis en 2014, corriger.
KDO: Est-ce que vous pensez qu’il y a des possibilités pour que les télévisions publiques programment un peu plus de documentaires au niveau des chaînes nationales? Est-ce une problématique lorsqu’on s’aperçoit qu’en Afrique de l’ouest francophone, en fonction des pays, mais globale- ment valable pour presque tous les pays, que l’antenne est occupée par les actualités, les déplacements des hommes politiques, les telenovelas brésiliennes, il reste très peu de place pour les documentaires locaux. Est-ce qu’il y a un moyen de trouver une solution d’appui pour que les télévisions diffusent un peu plus de documentaires?
BMA: Oui on connait très bien le problème, et au niveau de la direction, on essaye de pallier à ça. En 2010, qu’est ce que nous avons fait? La même dé- marche que nous avons eu à faire en direction des populations, en signant des contrats avec le cinéma numérique du Bénin pour que les populations des campagnes puissent voir nos films. Nous envoyons des personnes faire des évaluations, pour voir un peu quelles sont les attentes de la population, leurs préoccupations, leurs souhaits. Nous sommes conscients qu’il y a une faiblesse effarante de la diffusion des réalités béninoises, par le documentaire, sur nos télévisions publiques ou privées.
KDO: C’est intéressant parce que les gens qui regardent la fiction et le documentaire vont venir au cinéma.
BMA: On a fait une petite banque de films qui contient quelques documentaires. Nous voulons les programmer sur toutes les chaînes, afin de diffuser à intervalles plus ou moins régulier des œuvres produites par des béni- nois. Nous sommes entrain de discuter, lors de séances de travail. Au départ on avait mis l’accent sur la pro- duction, l’aide à la production, pour produire des films. Mais on s’est rendu compte qu’au niveau compétence, il y a des ajustements à faire pour ceux qui sont dans le métier. Alors on a rajouté un grand volet d’appui à la production, au renforcement des capacités pour que les gens puissent s’aguerrir, améliorer déjà leur expertise, la diffusion.
INTERVIEW DE MODESTE MOUBEKI REALISATEUR
KDO: Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter dans un premier temps, parler de votre parcours et après je vais vous poser des questions sur l’état du documentaire au Bénin.
MM: Bonjour, je suis Modeste Moubeki, réalisateur de formation, j’ai fait l’école des arts dramatiques du Caire, j’ai eu mon diplôme en 89, je suis revenu au pays croyant pouvoir travailler sur le support pellicule. Mais bon, la vidéo a pris le pas sur les pellicules et je me suis reconverti rapidement avec mon passage à l’ORTB et aujourd’hui je fais des films que ce soit des fictions, des documentaires plus sur support vidéo parce que s’est moins onéreux.
KDO: Et vous avez travaillé pendant combien de temps à la télévision?
MM: Pour la télévision j’ai travaillé de 1996 à 2002 cela fait six ans, et après j’ai décidé de partir parce que je perdais du temps là et que ça ne bougeait pas trop.
KDO: Et donc là, vous êtes maintenant un réalisateur et producteur indépendant?
MM: Indépendant oui j’ai une structure de production, production SITO, avec laquelle je fais des films.
KDO: Et en tant que réalisateur et producteur indépen- dant vous vous êtes dirigé vers quoi, plutôt vers le docu- mentaire?
MM: Non je fais les deux je fais de la fiction, je fais du documentaire mais je vois que là maintenant je suis sur beaucoup de projets. J’ai tourné déjà beaucoup de films documentaires que je n’ai pas encore montés, je viens de terminer un documentaire sur les divinités que nous avons au Bénin.
KDO: Et ce film-là il est monté?
MM: Il vient d’être monté et c’est un film de 26 minutes.
KDO: Et c’est un documentaire de création?
MM: Oui c’est un documentaire de création.
KDO: Quel est l’état des lieux du documentaire au Bénin ici, comment voyez-vous l’avenir du documentaire en terme de production et dans un deuxième temps en terme de distribution?
MM: En terme de production je vois que c’est plus facile pour nous de faire du documentaire, parce que on peut toujours s’arranger, ça ne demande pas autant de moyens que la fiction. La chose est faisable maintenant. Le problème c’est la distribution parce que nous devons supplier les distributeurs, les télévisions qui ne veulent pas acheter les films alors qu’ils en ont besoin pour leur grille de programme.
KDO: Vous dites que la télévision ne veut pas acheter mais est-ce qu’ils ne veulent pas acheter les films, ou est-ce qu’ils n’ont pas les moyens d’acheter des films?
MM: Non, c’est de la mauvaise volonté. Vous avez une chaîne de télévision, vous avez besoin de documen- taires, mais vous n’allez quand même pas toujours continuer de prendre gratuitement le programme des autres sous prétexte que vous avez des accords, non?
KDO: Et à votre avis, est-ce que ce sont les accords de CFI et de TV5 Afrique qui empêchent les télévisions nationales francophones d’acheter les documentaires dans chaque pays parce que finalement, ils peuvent aller se servir chez CFI ou TV5?
MM: Ce que j’ai constaté pour les télévisions nationales, je crois que leur accord avec CFI et TV5 est pour beau- coup à la base de cette situation. Et pour les chaînes privées c’est la même chose. Mais chez eux ce n’est pas TV5 et CFI, c’est plutôt le Voice of America et BBC. Ce sont les programmes de ces chaînes là que les gens nous montrent ici!
KDO: Et ce sont des programmes qu’ils ont gratuitement à votre avis?
MM: Je ne sais pas quel genre d’accord il y a entre eux, mais j’ai toujours constaté que quand nous faisons des films, quand c’est nos réalités, les gens sont vraiment intéressés quand bien même ce sont des documentaires. Ça les intéresse.
KDO: Donc vous, vous pensez qu’il y a un véritable public?
MM: Il y a un véritable public dans chaque pays pour consommer les films documentaires!
KDO: C’est juste les structures de distribution qui sont inexistantes, et à votre avis comment faire pour organiser cette structure, est-ce qu’il faut demander aux associa- tions de cinéastes, de professionnels de l’audiovisuel d’être un peu mieux organisés? Et pour faire face à la distribu- tion, parce que c’est quand même leur problématique. Cela veut dire que c’est eux qui sont pénalisés finalement, du fait qu’il n’y ait pas de distribution, du fait qu’il n’y ait pas de rapport de force qui obligerait les télévisions à avoir dans leur grille des documentaires?
MM: Oui, je pense que ça dépend des associations parce que quand vous êtes ensemble, vous êtes plus fort. Maintenant les associations devraient pouvoir s’imposer puisque quand nous travaillons sur support vidéo c’est de l’audiovisuel, donc on dépend, en fait, de la haute autorité chargée de l’audiovisuel. Comme ils le font déjà pour les gens qui produisent des chan- sons, des gens qui font de la musique, comme ils im- posent un pourcentage, un quota aux télévisions pour la diffusion, ils devraient le faire aussi pour les films documentaires, ainsi les bureaux de droits d’auteur pourront collecter des fonds, ce qui va relancer le financement des films documentaires.
KDO: Donc à votre avis, le problème relationnel entre les cinéastes et les vidéastes qui font des documentaires non diffusés, c’est un problème au niveau de l’office national de cinéma et au niveau des associations de cinéastes?
MM: Oui c’est au niveau des directions nationales de la cinématographie, et puis au niveau aussi des profession- nels de l’audiovisuel et du cinéma. Il faut s’organiser, les gens ont un engouement parce que souvent, même les films institutionnels, c’est avec plaisir qu’ils les voient, parce que ce sont des sujets qui leur sont proches. Maintenant quand on nous importe quelque chose d’ailleurs, des documentaires d’ailleurs, il faut avoir un certain niveau pour pouvoir s’asseoir et regarder. C’est une approche de plus mais ici, inconsciemment on ap- prend à nos populations certaines choses qu’ils côtoient et qu’ils ignorent. Donc on doit régler beaucoup de problèmes, faire un peu de sensibilisation inconsciemment, parler du problème de l’eau, de la sécurité, on peut sensibiliser beaucoup.
KDO: Et à votre avis, ici en terme de la relation entre les télévisions et les réalisateurs pensez-vous que c’est lié au fait qu’apparemment ce sont deux entités séparées et à aucun moment l’office national du cinéma n’est en rela- tion de force avec les télévisions. Parce que finalement des quotas pourraient être imposés?
KDO: C’est le ministère de la communication?
MM: Je pense que c’est le ministère de la communica- tion, mais quand même avec l’appui de la direction de la cinématographie qui gère. Il y a beaucoup de jour- nalistes qui font des documentaires quand ils sont dans les boîtes, c’est facilement diffusable. Mais quand ils ne sont pas dans les boîtes, tu supplies mais les gens ne veulent pas, parce qu’ils disent qu’ils n’ont pas d’argent pour acheter les films.
KDO: Et que pensez vous de la problématique des ar- chives ici au Bénin. Il y a eu des documentaires qui ont été tournés entre le début des années de l’indépendance et les années 80, des film qui ont été tournés en super 16, en 35 mm et en inversible. Pourtant aujourd’hui, nous avons du mal dans tous les pays africains à retrouver des traces de ces actualités-là.
MM: Mon passage à la télé m’a permis de toucher du doigt ce problème. Ils veulent se débarrasser de ces bandes, pour avoir plus de place, ils font le ménage. Le problème, c’est ils ne savent pas qu’ils doivent conserver ce qui a été fait. Si bien qu’aujourd’hui même à la radio, il y a des enregistrements qui ont été détruits. Parce que quand on a le nouveau, on oublie que l’ancien est là, on suppose que l’ancien est obsolète et qu’il faut le détru- ire. C’est une perte pour la mémoire, de ne pas conserv- er les archives. Il faut voir aujourd’hui dans la pratique combien maintenant peuvent dire qu’ils ont même des photos de leurs familles? Non il n’y en a pas, cela devi- ent naturel pour eux de détruire. A votre arrivée vous avez dit qu’il y avait des caméras 16 mm. Il y avait un laboratoire film à la télévision, mais grande a été ma surprise quand j’ai découvert qu’il était détruit, parce que l’UMATIC avait tout remplacé. C’est comme cela que ça évolue. On peut voir encore traîner dans les télés des boîtes de films, des UMATIC personne ne les entretient. C’est conservé dans des conditions vraiment pas normales, dans la chaleur, on ne peut rien en tirer.
KDO: Et vous par rapport aux documentaires que vous avez faits jusque là, quels étaient les moyens de diffusion que vous avez pu trouver?
MM: C’est plus sur les chaînes de télévisions. Comme j’ai fait des documentaires, j’étais plus à la télévision na- tionale, donc ils sont passés dans le même circuit dont on a parlé, TV5 et consort.
KDO: Et que pensez vous de créer des systèmes de relais pour la jeunesse parce que la problématique c’est que si la télévision ne diffuse pas les documentaires nous sommes en 2013 où il n’y a quasiment plus de salles de cinéma, donc on ne peut pas projeter de films, comment envisagez de relancer un intérêt sur le documentaire par rapport à la jeunesse?
MM: C’est très simple. Les jeunes quand même ont des centres d’intérêt, et on a affaire à des gens qui achètent des films. Par exemple moi je vois les films que je produis, quand cela concerne nos traditions, les jeunes demandent, où est ce qu’on peut acheter, ils demandent en même temps si quelque chose passe sur la télé, où est ce qu’on peut acheter le DVD, le CD donc y a un engouement.
INTERVIEW DE NOELLIE AGUIAR – LALOUPO DOCUMENTARISTE & Intervention
DE NNH: (Directrice du Festival Lagunimage)
KDO: Je vais juste vous demander de vous présenter et d’expliquer un peu votre parcours. Comment avez-vous commencé dans l’audiovisuel et à quelle période avez-vous été prise de passion pour les archives? Et j’aimerais aussi avoir votre sentiment sur les premiers films qui ont été tournés entre les années 60 et les années 80 en super 16, en 35 millimètre et en inversible? Ils ont disparu du fait qu’ils ont été amenés dans les labos français et puis ils sont revenus en positif. On les a projetés et on ne retrouve plus leurs traces, ensuite, on passe à l’époque de la télévision.
NAL: Je suis Noëllie Aguiar épouse Laloupo, la soixantaine, je suis documentaliste depuis les an- nées 70, disons. En fait, au départ j’étais beaucoup plus portée vers le journalisme parce que, à l’époque j’avais ma grande sœur qui était journaliste. Il y avait donc déjà une passion pour la presse, puisque notre papa était imprimeur. On avait dans la famille, une passion pour les lettres et la presse en général. Mais en voyant tout ce que ma sœur rencontrait comme problèmes au cours des reportages, j’ai vite changé d’idées. Au même moment, je me suis rendu compte que notre papa aussi faisait un genre d’archivage, il reliait par mois tous les journaux qu’ils produisaient à l’imprimerie nationale dont il était le promoteur et le directeur général. A l’époque le quotidien s’appelait « Togo Presse » (aujourd’hui « Nouvelle Marche »). J’ai donc trouvé ce que Papa faisait comme archivage très intéressant, surtout que cela permettait à ma sœur de faire des recherches pour pouvoir rédiger des articles de qualité. Mais un beau jour, je me suis dit qu’au lieu de faire du journalisme, moi qui n’aime pas le monde, je préfère embrasser quelque chose de plus discret.
C’est ainsi qu’après le Bac, 2 opportunités s’offrirent à moi 2 concours ont été lancés, un pour le journalisme, pour un recrutement local et un pour rentrer à l’INA (Institut National de l’Audiovisuel) de France à Brie sur Marne. J’ai donc passé les deux et quand les résul- tats ont été publiés, ayant réussi aux deux, j’ai opté pour la formation à l’INA, en France.
En 1977 à Paris, une fois la formation démarrée, mes Professeurs me disaient « Noëllie, vous avez une voix radiophonique, choisissez la production radiophonique ». J’ai dit non, je n’aime pas le monde, le monde me fait peur et comme on avait plusieurs options, j’ai choisi et je me suis lancée dans la documentation audiovisuelle. Mais au cours de la formation, on a fait de la production, on allait en reportage, on faisait de la prise de son, on a fait la prise de son interne et en studio, on a fait de la régie, on réalisait des émissions et à la fin de mon parcours, j’ai opté défini- tivement pour la documentation audiovisuelle.
Une fois de retour au Togo, le pays qui m’a envoyé en formation à l’INA, je n’étais pas mariée à l’époque. En- suite j’ai travaillé un an au Togo. Après mon mariage, j’ai rejoint mon mari au Bénin, c’est ainsi que j’ai servi à l’Office de Radio Télévision du Bénin depuis les an- nées 82. Au départ, j’ai eu à gérer la discothèque après j’ai insisté pour qu’on m’affecte à la télévision, vu ma très grande passion pour les images. Ce qui fut fait.
J’ai mis sur pied et démarré le premier service de docu- mentation à la télévision. Mais je ne vous cache pas que cela n’a pas été facile. C’était un vrai un chemin de croix que de travailler dans un monde qui n’a pas la cul- ture des archives, mais qui à un moment X de l’histoire, a besoin d’archives et te met la pression pour entrer en possession des éléments.
C’était une bataille de longue haleine, mais heureuse- ment, elle a porté ses fruits, mais pas comme je l’aurais souhaité. J’ai quand même réussi à faire inscrire le copyright à la fin des productions, à faire situer les émissions dans le temps, à faire inscrire le nom du jour- naliste sur les éléments d’actualité, ce qui ne se faisait pas avant, et ce qui est une grave erreur parce que dans dix, vingt, trente ans, on se dira « Mais quand est ce qu’on a réalisé l’émission X. Voilà qu’on n’a pas pris la précaution de marquer le copyright! »
Le Service Documentation était démuni en matière de ressources humaines, on était à peine 3. J’ai dit à mes patrons qu’il fallait mettre les moyens à la disposi- tion de la Documentation. En leur précisant, que « Si aujourd’hui, sur Yahoo ou sur Google, on cherche des informations et que quelques secondes après, la réponse apparaît, cela veut dire que derrière cette interface y a des milliers de personnes qui y travaillent 24 heures sur 24 pour mettre à notre dispositions les informations dont on a besoin. Pourquoi, n’allons-nous pas suivre le mouvement, surtout qu’aujourd’hui nous avons des partenaires comme le CIRTEF, (Conseil International de Radios-Télévisions d’Expression Française), l’OIF (Organisation Internationale de la Francophonie), la FIAT (Fédération Internationale des Archives de Té- lévision), et l’INA (Institut National de l’Audiovisuel) en France qui nous soutiennent.
KDO: Vous pouvez nous expliquer le lien avec le CIRTEF, et comment a démarré le système d’archivage?
NAL: En fait, le Cirtef, est le Conseil International de Radios-Télévisions d’Expression Française); Chaque année, il organise un Séminaire de Formation dé- nommé « SEFOR » qui regroupe des cadres de radio et de télévision. En 2000, cette formation s’est tenue à Dakar où il y a eu, entre autre, un atelier qui regroupait documentalistes, responsables de documentation et directeurs techniques. Les termes qui étaient utilisés étaient tellement rébarbatifs, trop techniques, qu’on a proposé dans les recommandations qu’au prochain SEFOR, un atelier soit exclusivement consacré aux documentalistes, parce notre souci, à nous, documen- talistes africains, c’était de pouvoir, au moment où on parle du numérique, retrouver rapidement nos éléments et servir les utilisateurs. C’était notre souci, car nous avions des milliers d’émissions à gérer. Et si on ne pou- vait pas satisfaire l’utilisateur, dans la minute qui suivait la demande, on n’était pas efficace. C’était ça notre préoccupation, préoccupation qui été prise en compte au SEFOR de l’année suivante avec le soutien de l’OIF, et qui a vu la naissance du logiciel AIME. Par la suite, à chaque SEFOR, les responsables de documentation des organes audiovisuels publics ont été formés, avec pour eux l’obligation de former leurs collaborateurs.
Ces séminaires de formation où on se retrouve entre responsables d’archives, nous permettent d’échanger nos expériences, de nous recycler, d’être informés des nouveautés dans le domaine de la technologie docu- mentaire. Des experts assurent les formations. La priorité était donnée aux responsables des archives des organismes publiques des pays francophones.
KDO: Est ce que vous pouvez m’expliquer un peu dans quel cadre vous êtes partie en formation en Chine juste- ment dans le cadre de ces archives?
NAL: Parmi les partenaires qui nous soutiennent, il y a la FIAT qui est l’organisation professionnelle la plus importante dans le domaine des archives Radio et Télé. Elle a été créée en 1977 à Rome et regroupe plus de 180 membres et est composée de plusieurs som- mités des archives, des archivistes qui sont à la retraite depuis des décennies, mais qui sont toujours actifs. Il y a également les partenaires CIRTEF et l’OIF qui ont signé des accords de partenariat avec l’INA, qui aussi est partenaire de la FIAT (Fédération International des Archives de Télévision). La FIAT, dans le cadre de ses activités, organise une Conférence annuelle dans un pays choisi en fonction d’un événement historique qui s’y commémore. C’est ainsi que la FIAT s’est tenue en 2009 en Chine qui venait de commémorer son 60ème anniversaire. Donc, toujours dans le souci de promou- voir les archives surtout les archives audiovisuelles, la FIAT qui est une fédération internationale où les membres du bureau, mus par la passion des archives, font du bénévolat. C’est la même préoccupation qui a amené l’UNESCO à choisir le 27 octobre pour que chaque année, à cette date, une sensibilisation se fasse dans le monde entier, pour attirer l’opinion interna- tionale sur l’urgence à sauvegarder les archives audio- visuelles qui sont en péril. C’est donc pour amener l’Afrique à prendre conscience elle aussi, que le CIR- TEF soutenu par l’OIF a invité les organismes africains publics de l’audiovisuel à adhérer à la FIAT. On en tire énormément profit. Ça permet aux responsables d’archives de participer à la conférence annuelle de la FIAT et de découvrir tout ce qu’il y a comme nou- veauté dans le domaine technologique, dans le domaine des archives et des nouvelles méthodes de gestion. On échange dans tous les domaines même dans la gestion du personnel parce chaque génération a sa méthode. Ce ne sont pas des réunions, des rencontres inutiles, on se rend compte que de l’autre coté (dans les pays du Nord), ça bouge, et ça bouge à une vitesse grand V. Ça nous incite, nous documentalistes africains, à suivre le mouvement. Nous payons des cotisations annuelles. Le groupe OIF a même été formé par les responsables d’archives des organismes publiques de l’audiovisuel qui ont été dotés du logiciel AIME. Et ce qui est intéres- sant, c’est qu’à chaque réunion du SEFOR ou de la FIAT, on fait une évaluation du logiciel AIME, ce qui permet de relever les problèmes que nous rencontrons en utilisant le logiciel AIME et à la formation suivante ces problèmes sont corrigés.
KDO: Donc ça vous permet de relever les carences du logiciel et de l’améliorer éventuellement?
NAL: Oui! En fait, c’est un logiciel qui est convivial, mais quelques problèmes se posent dans son utilisa- tion et cela varie d’un organisme à un autre. Comme problèmes, il y a l’indifférence de nos supérieurs hiérarchiques, l’instabilité du courant électrique, la lenteur ou l’instabilité de l’internet, la non-maîtrise du logiciel, et bien d’autres problèmes. Cela ne marche pas comme on l’aurait souhaité. Il faut reconnaître que les problèmes cités plus haut rendent le logiciel très lent à l’exploitation. Normalement, le logiciel nous permet d’indexer au moins deux à trois heures d’émissions par jour mais quand tu es seule par exemple à gérer les archives, tu es en train d’indexer des émissions, voilà qu’un utilisateur vient il te dit « Moi j’ai besoin sur le champ de quelques éléments pour réaliser telle émission. » Tu es obligé de laisser l’indexation que tu es de faire sur le logiciel pour t’occuper de l’utilisateur. Vous voyez un peu la perte de temps que nous subissons alors que si on avait des personnes ressources comme en Chine par exemple, les étudiants en bibliothécono- mie, en archivistique et autres sont envoyés en stage à la CCTV (China Central Television) pour faire l’étiquetage, le catalogage, l’indexation, et autres. Chez eux c’est une vraie industrie des archives qui emploie une centaine d’agents. Ils font même de la restauration des images dégradées.
Nous sommes appelés deux fois par an à faire le bilan. On fait l’état des lieux en groupe, c’est vraiment une ambiance très conviviale avec les experts et nous es- sayons de voir comment apporter des solutions aux différents dysfonctionnements pour que le logiciel AIME fonctionne mieux. Je me rappelle qu’au SEFOR du Cameroun j’ai demandé qu’une démo du logiciel soit faite aux Directeurs Généraux et aux Directeurs des Programmes pour les amener à appréhender l’utilité des archives que leurs institutions génèrent en lon- gueur de journée et pour qu’ils puissent s’approprier le logiciel AIME. Ce qui a été fait. Nombreux étaient les directeurs généraux qui ont dit « Maintenant on com- prend mieux l’importance des archives et l’utilité du logiciel AIME » et une fois retournés dans leur pays, ils allaient tout mettre en œuvre pour faire de leur struc- ture d’Archivage, la pièce maîtresse de leur institution. Et pour ce faire, ils donneront plus de moyens! Mais la réalité est tout autre!
KDO: Ils n’ont pas donné les moyens?
NAL: Non seulement, les moyens n’ont pas été don- nés, mais il m’est revenu que certains moyens étaient achetés et détournés vers d’autres cieux. Il m’est arrivé d’acheter mes propres équipements pour travailler pour l’Etat. Ce que j’ai récupéré en partant à la retraite.
J’ai même eu l’impression à un moment donné qu’on ne me donnait pas les moyens exprès, pour me décourager! Quand j’exigeais de meilleures conditions de travail, on pensait que c’est parce que j’avais de meilleures conditions de vie et j’irai plus loin, on me privait et s’attendait à ce que j’aille quémander le minimum pour travailler.
Entre autres problèmes, il y avait les conditions de conservation des productions, vous vous imaginez, mais vous avez des productions sur des cassettes qui sont archivées dans des locaux qui prennent l’eau à chaque saison des pluies, là y a un problème sérieux qui se pose.
Bref, le problème du cadre de stockage des supports est aussi à prendre très au sérieux. Le plus souvent ce sont des locaux de fortune, inappropriés qui sont mis à disposition pour le stockage des supports.
Un autre délicat problème se pose, moi je l’ai connu. C’est la décision prise par le chef du centre de détruire les productions sur supports analogiques stockés (qui soit disant ne servent plus à rien), faute d’équipements de lecture pour procéder à la migration sur supports ac- tuels! Un refus d’obtempérer a valu une sanction à une collaboratrice. Cette dernière a profité de la première occasion pour quitter l’office. C’était une bagarre entre elle et le chef des programmes. Donc les cassettes ont été jetées et exposées au soleil et à la pluie. Des photos ont été prises du triste spectacle que cela offrait. Ces images ont fait le tour du monde, les images des cas- settes jetées sont restées en plein air pendant des mois.
KDO: Et ça c’est en quelle année?
NAL: C’était en 2005, et ces photos ont fait le tour du monde!
Il y a un obstacle non moins négligeable, celui de la po- sition de la structure des archives dans l’organigramme d’une institution de l’audiovisuel. La hiérarchie pense que la structure d’archivage doit être sous la coupe du Service des Programmes, mais c’est une erreur. La documentation doit être une direction parce qu’en documentation il y a plusieurs services, (la vidéothèque, la discothèque, la sonothèque, la documentation actualité, la photothèque-diapothèque, l’informatique, et dans chaque service, il y a le secteur administratif, le catalogage, la restauration, le prêt, etc. il faut aussi compter avec le secteur des langues nationales. Chez nous malheureusement une seule ou deux personnes assurent la gestion des archives. Quand on prend la chaîne documentaire c’est toute une équipe qui doit y travailler mais ici en Afrique on se rend compte que c’est une seule personne qui fait tout et c’est à prendre ou à laisser.
NNH: Et du coup le logiciel n’est plus utilisé au Bénin par exemple?
NAL: Je n’ose pas répondre à cette question, car il y a mille et une manières d’utiliser le logiciel! Vous savez il y a une réalité, qu’il ne faut pas occulter, celui de la connexion internet, celui de la sécurité des équipements informatiques, les antivirus, de la maintenance des équipements.
KDO: Et comment vous expliquez-vous qu’il y ait autant de partenaires finalement parce qu’il y a le CIRTEF, l’OIF, autant de partenaires qui s’intéressent aux ar- chives dans le cadre de l’audiovisuel des pays africains francophones, et que pourtant il y ait si peu de moyens au niveau du personnel de la télévision. Est-ce que c’est un manque de volonté politique des responsables des télévisions qui ne s’impliquent pas assez, qui pourraient demander plus de subvention pour maintenir un service d’archives correct parce que finalement il y a des parte- naires donc forcément il y a de l’argent?
NAL: Au delà de ce manque de volonté politique, il y a cette absence de la culture des archives, l’ignorance dans le domaine, parce qu’il faut que les responsables comprennent ce qu’est une archive, que les archives constituent une mine d’or!
Prenons, le cas de l’INA en France, qui aujourd’hui gagne des milliards grâce à ses archives, vous imaginez ce que ça rapporte. Quand Emmanuel Hoog lançait ce projet, il avait fait une prévision. Il pensait rentrer dans ses fonds en quatre ans mais c’est en quelque mois qu’ils ont récupéré tout ce qui a été investi tellement l’engouement des utilisateurs était grand.
NNH: Bien sûr, et ce qui est le plus révoltant c’est que l’INA vend beaucoup d’archives africaines.
NAL: Prenons le cas de la commémoration du cinquan- tenaire des indépendances en Afrique, ce sont nos propres archives que l’INA a conservé qui nous ont été rétrocédées à la demande des Responsables des archives publiques.
KDO: Tu peux parler de la série de documentaire que le CIRTEF avait produit pour le cinquantenaire?
NAL: L’INA nous a rétrocédé nos archives. C’était au cours d’une conférence annuelle de la fédération internationale des archives que la vice présidente Dominique, la responsable des archives à l’époque, vice présidente de la FIAT, nous a demandé « Mais qu’est ce que vous voulez bien avoir comme souvenir? » On lui a dit que dans le cadre du cinquantenaire, on aimerait bien avoir des archives africaines! Et nous les avons reçues. Tenez vous bien quand cela a été envoyé chez nous, nous avons exigé qu’elles soient remises en mains propres aux responsables des archives. Mais ce qui est tout à fait normal, la France a préféré les remettre au Ministère de la Communication. Dans certains pays, ces archives n’ont pas été rétrocédées à la documentation. Chez nous, par exemple, c’est le Directeur de la Radio, à ce qu’il paraît, qui les a reçues, qui a les a remises à un réalisateur. Et comme moi au retour de mission, j’ai informé les journalistes et producteurs de la prochaine arrivée des éléments d’archives pour la commémoration du cinquantenaire, le réalisateur à qui la cassette a été remise a eu le réflexe de me les apporter.
Dès la réception, je les ai dupliquées. Et en ai envoyé à la rédaction, la production, et j’ai joins la liste de tout ce qu’on avait en archives, parce que quand il y a un
événement comme celui-là, je fais des propositions d’émissions d’archives ou d’extraits d’archives, que j’ai pu récupérer des supports analogiques et je les envoie au programme, je les envoie à la rédaction.
NNH: Moi aussi, je me sens triste surtout que dans ce cas précis, il y aurait de l’argent, des subventions dis- ponibles pour travailler à la récupération des archives, il n’y aurait pas de problèmes. Tout le problème c’est l’ignorance des équipes dirigeantes de ces télévisions. Ils ne savent pas qu’en prenant mieux soin de ce maté- riel ils peuvent engranger des subventions et d’un autre coté c’est le manque de personnel.
KDO: Surtout en sachant qu’il y a beaucoup d’organismes qui s’intéressent aux archives et que des subventions qui sont disponibles et qui ne coûtent pas grand chose à l’Etat, mais ça c’est incompréhensible, ce sont les paradoxes de l’Afrique.
NAL: C’est un drame le problème des archives, et moi, qu’est ce que j’ai fait aussi pour la promotion des archives, pour amener les utilisateurs à comprendre le bien fondé des archives! Toutes les anciennes émis- sions que j’ai récupérées sur supports analogiques et transférées sur ces supports actuels, j’en fais une copie à chaque fois et les offre à l’auteur de l’émission comme souvenir. Et quand il le découvre « Mais ça fait dix, vingt ans que j’ai réalisé cela, mais bon Dieu comment tu as fait pour le récupérer? » J’ai dit que ce sont les partenaires qui nous soutiennent qui font qu’aujourd’hui on peut récupérer toute cette produc- tion, et je fais mes rapports au jour le jour.
Je vous donne un exempleà Madagascar, c’est la pre- mière monteuse de la télévision malgache, Monique Razafy qui a créé son association, « FLA », elle a pris le problème des archives cinématographiques de Mada- gascar à bras le corps, elle n’a eu aucun soutien des siens. Autour d’elle, les gens se disaient « Laissez-là, si elle veut s’amuser avec les films, c’est tant pis pour elle! » Elle avait sa petite équipe de moins d’une dizaine de bénévoles. Mais c’est sa passion des archives qui l’a poussée à un vrai travail de sauvegarde des archives cinématographiques de Madagascar.
En 2010, elle a réalisé un documentaire sur son projet et l’a présenté aux Awards de la FIAT. Les Awards de la FIAT est un prix qui est décerné à toute production réalisée à base d’archives par un membre de la FIAT. Monique dans le cadre des Awards a réalisé un documentaire pour montrer le travail immense qu’elle fait avec son équipe de bénévoles pour sauver les archives cinématographiques de Madagascar. Elle a été primée parce qu’elle a eu le cour- age de montrer les problèmes que sa structure rencontrait malgré sa passion pour les archives.
NAL: Les partenaires sont prêts à nous soutenir! Une place au sein du Comité Exécutif a même été réservée au Groupe OIF. C’est ainsi que je suis membre du Comité exécutif de la FIAT après mon homologue sénégalais. Parce que Dominique, la Vice Présidente de la FIAT, soucieuse du devenir des archives est une dame qui a une passion inimaginable pour les archives africaines. Donc soucieuse du devenir des archives africaines, elle s’est battue pour que l’Afrique Noire soit représentée au sein du bureau de la FIAT, au comité exécutif, ce qui n’est pas rien. C’est ainsi qu’il y a deux ans, c’était mon homologue sénégalais qui a été membre du bureau de la FIAT, du Comité Exécutif de la FIAT. Entre temps, il s’est retiré pour faire des recherches dans le cadre de son mémoire, de sa thèse de doctorat. J’ai donc été désignée par mes homologues pour le remplacer au sein du CE. Etant membre jusqu’à ce jour du comité exécutif de la FIAT, je représente toute l’Afrique Noire, mais j’ai demandé à être rem- placée, puisqu’étant à la retraite, que quelqu’un d’autre me remplace au sein du comité exécutif. Si j’ai intégré la FIAT, c’est bien parce que j’étais agent de l’ORTB, aujourd’hui n’étant plus agent de l’ORTB, je n’ai plus droit de participer aux conférences de la FIAT, à moins que j’y participe à titre privée.
NNH: Donc personne du Bénin ne sera à la FIAT 2012 en Angleterre?
NAL: Les partenaires attendent le nom de mon remplaçant.
KDO: Et personne ne vous remplace!
NAL: Pour le moment, non c’est dramatique. Moi je ne vais pas leur forcer la main. C’est eux qui en ont besoin. Moi ça me fait mal de constater que toute la bataille que j’ai menée n’a servi à rien! Je leur demande de me donner des moyens pour que je sauve les archives, je leur demande de me donner des moyens en ressources humaines. Le travail pour lequel je suis payée évitera que demain, nous soyons obligés de courir de partenaire en partenaire, afin de récupérer nos propres archives, les archives que nous avons produites.
NNH: Ce qui serait honteux quand même! C’est incroy- able on ne se rend pas compte, on n’imagine pas qu’un tel drame se joue sous nos yeux!
KDO: C’est incroyable! Et qu’est ce que vous préconisez si par exemple toutes ces organisations s’intéressant aux ar- chives, finalement investissent. Ne serait t-il pas possible de créer une entité pour les archives de toute l’Afrique de l’Ouest Francophone, financée par toutes ces organisa- tions, mais qui serait complètement indépendante des télévisions, est ce que vous pensez que ce serait une pos- sibilité?
NAL: Ce serait une possibilité, mais aujourd’hui quand je vois tous les méfaits de la politique sur la culture en Afrique, je mets un point d’interrogation sur cette idée. Quand je vois tout ce que nous vivons dans nos différentes structures d’archivage, moi je dis que nos problèmes viennent de notre hiérarchie. Vous imaginez, quand on enregistre une émission, après la diffusion, la cassette disparaît. Moi en 1995, 1996, j’ai été Chef des Programmes, j’ai instauré un système de sécurité avec les chutiers du montage film qui ne servaient plus. A l’époque on ne produisait plus en film donc j’ai pris d’anciens chutiers que j’ai amenés aux menuisiers. Ils les ont fermés et ils ont juste laissé l’ouverture pour y coulisser des cassettes. Il y avait le chutier « information » et le chutier « programmes ». Donc j’avais instruit le réalisateur pour qu’à la fin de la diffusion, il sache quelles sont les cassettes de l’information, de l’actualité qui doivent être coulissées dans le chutier. Il y avait une clé avec un cadenas. J’avais la clé en tant que chef des programmes, la responsable de la documentation qui me remplaçait à l’époque avait une clé, le rédacteur en chef avait la clé du chutier « Actualité ». Là aucune production ne disparaissait, mais le jour où j’ai quitté les programmes, ils ont fait sauter les verrous et le commerce a repris, je l’ai même dénoncé. Ce sont les sociétaires de l’entreprise même qui entretiennent ce marché. C’est un commerce très lucratif aujourd’hui. Tout ce que j’ai récupéré risque de disparaître.
NAL: Je disais plus haut que l’UNESCO a pris con- science de l’urgence à sauver les archives audiovisuelles, et c’est dans ce cadre que l’UNESCO a choisi le 27 octobre comme date pour la promotion et la sensibili- sation de l’urgence à sauver les archives audiovisuelles en péril. Le 27 octobre de chaque année, nous respon- sables d’archives, devons initier un programme pour amener les autorités à comprendre que nous avons des archives et qu’il faut les sauver. Les partenaires nous demandent à chaque SEFOR ou bien à chaque FIAT de dire quels sont les programmes que nous avons élaborés. Au niveau du ministère on devrait prendre le problème à bras le corps et se direil faut qu’on fasse quelque chose, faire le bilan et voir comment repar- tir sur de bonnes bases. Qu’est ce qu’on a fait jusqu’à ce jour? Moi j’ai fait des propositions de réalisations d’émissions pour montrer le processus de production d’une émission, l’état de nos archives, faire l’état des lieux en images de nos archives à l’ORTB. Trois agents du Service Production et un du Service Actualité ont déposé des projets d’émission dans ce sens, les patrons ont mis le coude sur ces différents projets, aucun n’a abouti. Au delà de cet état de lieux, qu’est ce que nous faisons?
KDO: Parce que normalement après l’état des lieux, il faut des actions?
NAL: Il y a des actions qu’on doit mener, on doit se dire « Vous croyez que les agents, des documentalistes aujourd’hui par ce temps de crise vont accepter d’aller travailler pour des prunes? Mes collaborateurs m’ont dit « Madame vous avez travaillé des décennies sans primes, mais nous on ne le fera pas! » J’ai dit « Merci de me le dire, mais moi c’était une passion! ».
KDO: C’est difficile quand même!
NAL: C’est difficile, il faut reconnaître!
KDO: Et juste pour conclure maintenant, je voulais te faire une remarque. Ce qui me trouble et qui me touche beaucoup dans la mesure où quand on parle des archives globalement en Afrique et pas uniquement au Bénin, mais dans tous les pays africains francophones; effective- ment c’est un triste constat mais en même temps je pense qu’il faut continuer la lutte, parce que le problème c’est que les images d’archives représentent l’avenir de nos enfants et en dehors de l’avenir de ce continent les images d’archives concernent finalement l’histoire du continent africain. C’est le patrimoine mondial, c’est en se basant sur le fait qu’il s’agit du patrimoine mondial, c’est la seule solution parce que je ne vois pas comment on peut mettre des choses en place pour sauver le problème des archives.
NNH: Et moi justement, l’échange que nous avons me fait penser qu’il faut absolument qu’on trouve un mode de fonctionnement qui permette que l’ORTB soit obligée ne serait ce que par l’UNESCO ou par l’OIF de céder la matière à une agence ou une association.
KDO: Il faut trouver un consensus de toutes les organisa- tions qui s’occupent des archives, qui ont les moyens de donner de l’argent au niveau de l’Afrique Francophone. Il faudrait mettre en place d’une entité indépendante qui conserve toutes les archives de toutes les télévisions; de tous les pays de l’Afrique francophone – parce que fina- lement, ça sort du giron de la télévision nationale – au niveau d’un continent et au niveau mondial. Pourquoi les autres pays, les autres continents le font et ça leur rap- porte de l’argent? Pourquoi ne pas le faire en Afrique? Il n’y a pas de raison que nous, nous allions payer les archives ailleurs et que ces gens là ne puissent acheter des archives chez nous, il faut trouver un consensus indépen- dant, en dehors des télévisions.
NNH: Et surtout qu’on ne retrouve pas toutes les archives à l’INA. Mais ça il y a moyen de le mettre en place, dans un intervalle de deux ans, je pense, car il y a énormément de fonds aujourd’hui.
NA: L’idée, je l’ai eu en 2004 à New York. On était parti à la FIAT à New York, et j’ai dit – l’idée est partie de moi – « Je souhaiterais que ce musée soit domicilié au Bénin parce que c’est mon idée à moi! » J’ai invité les partenaires à me soutenir pour qu’on puisse monter ce musée au Bénin. Quand je vois un équipement audiovi- suel sous la pluie, ça me fait mal, on peut le mettre dans un local, mettre de telle date à telle date, voilà le micro qu’on a utilisé, voilà la caméra qu’on a utilisée, voilà les mélangeurs qu’on a utilisés, voila comment la tech- nologie évolue. Parce que si on prend les caméras avant, elles pesaient des tonnes, aujourd’hui on a des caméras numériques très légères au point que le journaliste peut prendre sa caméra aller faire son tournage revenir sans problème. Et ce musée, vous mettrez la visite à cinq cent mille francs, ça vous fait des rentrées de fonds!
KDO: Puisque entre temps, il y a une école d’audiovisuel (ISMA) qui a été mise en place et qui aurait bénéficié de tout cela avec des cours?
NNH: Le problème c’est qu’ici c’est en même temps un enjeu économique si tu veux.
NNH: Ah, vu les conditions dans lesquelles tu es obligée de travailler. C’est vrai qu’il y avait la possibilité que tu restes après la retraite, mais il fallait que ça soit à dans certaines conditions.
NAL: C’est eux qui devraient m’appeler, qu’on s’entende sur une méthode en tout cas un certain chronogramme pour le faire.