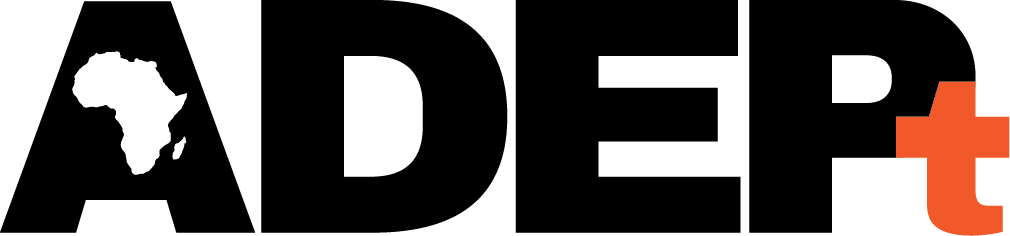Resources
ADFF - Africa Documentary Film Fund
INTRODUCTION
Reports
Since independence in 1960, Chad has experienced intense political turmoil, characterized by dictatorship, military rule and violent clashes between different political factions. This situation has profoundly impacted the state of cinema infrastructures in the country, almost condemning local production to inexistence. As reported by Vincent Malausa (Les Cahiers du Cinema, February 2011), beyond the few anthropological documentaries made by Eduard Sailly in the 1960s, the first Chadian film on record is Mahamat-Saleh Haroun’s first short film, shot in 1991. Since then, and beyond the two influential personalities of Haroun himself and Issa Serge Coelo, not much else has emerged.
However, over the past few years the State seems to have developed new interest in the media and cinema sector, but critics considers it an expression of the regime’s political propaganda. Nevertheless, as part of this new institutional effort, in 2003 the Bureau Tchadien du Droit d’Auteur (BUTRA) has been created and in 2011 one of the country’s oldest cinema, the “Normandie” in N’Djamena, has been restored and reopened.
Furthermore, with the introduction of new technologies, the television market has been revitalized. Since 2008 the local television network (ONRTV Office National de Radiodiffusion et Télévision du Tchad) has started a satellite channel and has begun to purchase local production to fill its broadcast windows. Within this context, a few local TV series and documentary films have appeared, highlighting the emergence of a small group of independent filmmakers and producers working with low-cost digital recording and editing facilities. Among them, Cyril Danina, Emmanuel Rotoubam, and André Diongar seem to be the best known. This new generation of film practitioners survive also thanks to the commissions coming from NGOs and international funders active in the country. Overall, today, the country can count twelve independent producers, seven production companies, fifteen projection halls and up to fifty television stations.
The only existing film festival (La semaine du documentaire, a week-long festival on human rights documentary films) takes place at the French cultural institute, and includes in the programme also some training activities. Beyond this, there are only a few training institutions, which include two Schools of Communication and a Fine Art School whose construction should be soon completed.
ADFF - Africa Documentary Film Fund
INTRODUCTION
Reports
Depuis son indépendance en 1960, le Tchad a vécu une crise politique intense, caractérisée par une dictature, un régime militaire et des affrontements violents entre les différentes factions politiques. Cette situation a profondément affecté l’état des infrastructures du cinéma dans le pays, condamnant l’existence même d’une production locale. Selon Vincent Malausa (dans Les Cahiers du Cinéma, Février 2011) et au-delà des quelques documentaires anthropologiques réalisés par Eduard Sailly dans les années 1960, le premier film tchadien recensé est celui de Mahamat-Saleh Haroun, un court-métrage tourné en 1991. Depuis lors, peu de choses ont vu le jour, au-delà de deux personnalités influentes : celle de Haroun lui-même ainsi que Issa Serge Coelo.
Cependant, au cours des dernières années, l’État semble nourrir un nouvel intérêt pour les médias et le secteur du cinéma bien que les critiques mettent cela sur le compte de la propagande politique du régime. Néanmoins, ce nouvel effort institutionnel a permis la création, en 2003, d’un Bureau Tchadien du Droit d’Auteur (Butra) ; puis en en 2011 l’une des plus vieilles salles de cinéma du pays, le “Normandie” à N’Djamena, a été restaurée et rouverte. En outre, avec l’introduction des nouvelles technologies, le marché de la télévision a été revitalisé. Depuis 2008, le réseau de télévision locale (ONRTV - Office National de Radiodiffusion et Télévision du Tchad) a lancé une chaîne satellitaire et a commencé à acheter également la production locale pour remplir sa grille de programmation. Dans ce contexte, une série télévisée locale et quelques films documentaires ont fait leur apparition soulignant l’émergence d’un petit groupe de cinéastes et producteurs indépendants qui travaillent avec de petits budgets en se servant d’équipements numériques et d’unités de montage accessibles. Parmi eux, Cyril Danina, Emmanuel Rotoubam, et André Diongar semblent être les plus connus. Cette nouvelle génération d’artisans de films survit aussi grâce aux commissions provenant des ONG et des bailleurs de fonds internationaux actifs dans le pays. Dans l’ensemble, aujourd’hui, le pays compte douze producteurs indépendants, sept sociétés de production, quinze salles de projection et jusqu’à cinquante chaînes de télévision. L’unique festival du film existant (La semaine du documentaire, un festival de films documentaires autour des droits de l’homme, qui dure une semaine) a lieu à l’Institut culturel français, et comprend également au programme des activités de formation. Autrement, il n’existe que quelques institutions de formation : deux écoles de communication et une école des Beaux Arts, dont la construction devrait être achevée prochainement.