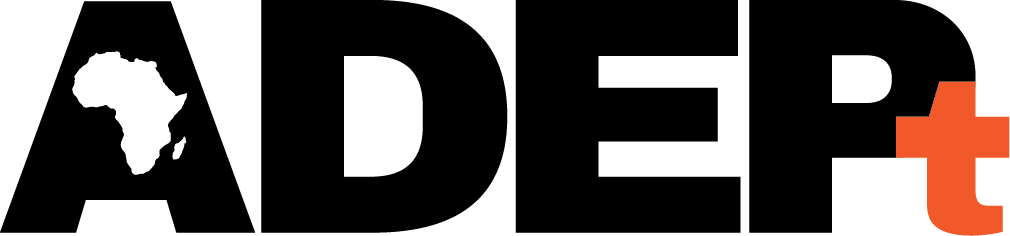Production quasiment inexistante
La production/réalisation de films documentaires au Cap-Vert est encore très limitée et concentrée entre les mains de quelques réalisateurs résidant au Cap-Vert, principalement Leão Lopes et Júlio Silvão Tavares.
Lors des dix dernières années ont été réalisés quatre longs métrages documentaires :
- BITÚ de Leão Lopes, 2005, 50’
- BATUQUE A ALMA DE UM POVO, Júlio Silvão Tavares, 2006, 52’
- EUGÉNIO TAVARES, CORAÇÃO CRIOULO, Júlio Silvão Tavares, 2009, 52’
- SÃO TOMÉ E PRINCIPE, MINHA MAE, MINHA TERRA, MINHA MADRASTA, Júlio Silvão Tavares, 2012, 52’
Seul le dernier film est une production capverdienne assumée par le propre réalisateur. Le premier est une production portugaise, le second une coproduction franco-portugaise et le troisième produit dans le cadre du programme Doc TV CPLP sur lequel nous reviendrons dans un autre chapitre. Le dernier, en revanche, a été produit par la société de production du réalisateur.
Il existe certes un certain nombre de films produits par des Capverdiens de la diaspora. On peut citer les longs métrages tournés au Cap-Vert des Américains- Capverdiens Guenny Pires (THE JOURNEY OF CAPE VERDE, 2005 et CONTRACT, 2010) ou Claire Andrade Watkins (OLÀ VIZINHO, 2010) ou encore les long et court métrage de Ana Fernandes, cap- verdienne résidant en Allemagne (REBELADOS, 2010 et GOLFO POPULAR, 2011) et quelques autres encore. Mais tous ces films sont produits par les pays de résidence des réalisateurs sans apport capverdien.
Il est donc difficile devant la rareté des films réalisés et produits au Cap-Vert de parler d’un « cinéma docu- mentaire capverdien ». Selon les propres termes de Júlio Silvão Tavares 6, les obstacles résident principale- ment dans le manque d’engagement de l’Etat quant au soutien du secteur et dans le manque de techniciens, scénaristes et autres professionnels capables d’assumer les phases préparatoires à la production d’un film.
L’accès aux coproductions est par ailleurs rendu diffi- cile par le manque de structures. Les aides à la co- production internationale sont généralement remises à un organisme spécialisé chargé de les redistribuer, or l’Institut Capverdien du Cinéma n’est plus qu’une institution fantôme obsolète.
Selon le réalisateur César Schofield7, l’essor de la production ne peut passer que par un modèle similaire à celui des industries créatives. D’un côté, le Cap-Vert bénéficie d’une population jeune, et un certain dyna- misme et intérêt envers le documentaire, l’audiovisuel, l’art vidéo et le multimédia est notoire à l’heure ac- tuelle. De l’autre, une grande quantité de matériel – caméras légères et ordinateurs – est disponible dans le pays. L’essor du secteur ne peut passer selon Schofield que par une phase d’expérimentation à partir de ce matériel disponible et aux faibles coûts de production, adaptés à la réalisation documentaire.
Diffusion Limitée
Le Cap-Vert comme la majorité des pays d’Afrique a souffert très largement de la fermeture progressive des salles de cinéma, généralement rachetées par des inves- tisseurs du tourisme étrangers ou converties en église. En 2007 le Cap-Vert ne comptait plus une seule salle de cinéma. Aujourd’hui, deux seulement sont en activité.
Le ciné club de Assomada sur l’île de Santiago a été à nouveau inauguré en octobre 2010 sur une initiative privée et avec le soutien de la municipalité. Equipée de ses anciens projecteurs et d’un appareillage numérique basique, la salle est en activité quatre jours sur sept. La programmation est conçue selon des critères de qualité et de diversité, une faible place étant cependant réservée au documentaire. Le prix des billets symbolique et une population apparemment cinéphile permettent une affluence assez importante. Par ailleurs, la salle fait partie depuis avril 2012 du Réseau National de Salles, projet mis en place par le Ministère de la Culture en vue d’établir en partenariat avec les autorités locales un circuit pour la divulgation de la culture capverdienne (musique, danse, théâtre, artisanat, arts plastiques, lit- térature). La multifonctionnalité des salles semble être une condition sine qua non pour leur viabilité.
L’autre salle encore en fonctionnement actuellement au Cap-Vert se situe à Mindelo. Elle propose deux titres par mois et consacre une importante partie de sa programmation aux productions des PALOP.
Néanmoins, la réalité du réseau de salles n’est vraisem- blablement pas une issue pour la diffusion du docu- mentaire. Les solutions à court terme sont à chercher du côté de la télévision. La Radio Télévision Capverdi- enne qui jusque là ne s’est consacrée qu’à la diffusion de documentaires d’origine étrangère, semble déterminée à faire de nouveaux efforts pour la diffusion du docu- mentaire capverdien et de pays africains lusophones.
Les festivals semblent aussi s’attacher à la diffusion d’une production plus locale. Depuis 2008, le Centre Culturel Portugais organise à Praia le festival Maio. Doc, réalisé à partir d’un programme d’extensions et itinérant du festival DocLisboa, en partenariat avec l’association portugaise Apordoc. Le festival ressemble cependant davantage à un cycle de cinéma limité à huit séances, et neuf des dix films présentés lors de l’édition 2012 étaient portugais, le dernier étant le documen- taire de Júlio Sivão Tavares. L’événement organisé par l’Institut Camões est davantage destiné à la promotion du documentaire portugais qu’à celui des PALOP.
Un autre festival qui a vu le jour en 2010 centre en revanche sa programmation sur le cinéma luso-phone. Même s’il n’est pas spécifiquement axé sur le documentaire, le Festival International de Films du Cap-Vert « Viva Imagens », célébré sur l’île de Sal, proposait dans sa dernière édition des documentaires capverdiens, de la diaspora capverdienne et d’Angola. Il proposait également un atelier documentaire animé par la réalisatrice Claire Andrade Watkins. La prochaine édition est prévue pour octobre 2012 et l’événement semble se consolider.
Enfin, le dernier festival actif aujourd’hui est le festival du court métrage « Culturamóvel » à Praia. Il s’inscrit dans un projet plus ample de coopération internationale sur lequel nous reviendrons ultérieurement, destiné à la formation en audiovisuel et à la stimulation du dialogue culturel par le biais des TIC. Les films projetés sont les fruits des ateliers organisés dans le cadre du projet.
Le principal obstacle à la diffusion du documentaire au Cap-Vert reste le même : le manque de soutien insti- tutionnel. Il existe de toute évidence un dynamisme de la part des activistes culturels locaux dont les initia- tives sont caduques par le manque de relais de la part des autorités publiques, mais aussi par le manque de disponibilité de professionnels du secteur et de travail en réseau.
La formation : une série d’initiatives récentes qui nécessitent une continuité
Le même phénomène se reproduit quant à la forma-tion. Une série d’initiatives récentes montrent une rée- lle volonté de dynamiser le secteur cinématographique et audiovisuel dans le pays. Mais ces initiatives restent ponctuelles et inscrites dans un cadre de coopération internationale à durée limitée.
En janvier 2011, sur l’initiative du réalisateur brésilien Joel Zito Araujo et sous la direction pédagogique du même réalisateur et du réalisateur capverdien Leão Lopes, un cours de spécialisation « Lato Sensu » en cinéma et audiovisuel de dix semaines a été organisé au M_EIA (Institut Universitaire d’Art, Technologie et Culture) de Mindelo, dans le cadre d’une collabo- ration entre le Ministère capverdien et la fondation culturelle brésilienne Palmares. Le projet destiné à stimuler l’échange interculturel et économique entre le Brésil et le Cap-Vert et à combler en partie les carences dans le secteur de la formation de professionnels du cinéma et télévision au Cap-Vert, a accueilli un ving- taine d’étudiants en grande majorité du Cap-Vert, mais aussi du Mozambique, du Portugal, du Brésil et du Sénégal, âgés de 26 à 58 ans et majoritairement profes- sionnels de la télévision ou de sociétés de production de vidéo locales. Des intervenants du Brésil, de Cuba et du Cap-Vert ont concentré leurs enseignements sur l’esthétique et l’histoire du cinéma, sur l’écriture de scé- nario, le regard critique, les techniques de production, de réalisation, de montage, son et caméra. L’expérience extrêmement positive selon Joel ZitoAraujo8, a débou- ché sur la production d’un long métrage documentaire, FRAGMENTOS DE MINDELO, qui a participé à divers festivals internationaux et de deux courts mé- trages de fiction. Le projet a été soumis de nouveau à la Fondation Culturelle Palmares en collaboration avec l’Agence Brésilienne de Coopération et du Ministère des Affaires Etrangères dans la perspective de le recon- duire lors du second semestre 2013. Cette seconde édi-tion prévoit une participation de membres d’autres pays PALOP et sera organisée de nouveau en partenariat avec le M_EIA.
« CulturaMóvel » est un projet d’un an destiné à « augmenter la croissance de l’industrie audiovisuelle du Cap-Vert par l’optimisation des nouvelles technolo- gies ». Organisé par les entités capverdiennes « O’Dam ONGD » et « Associaçao Assimboa », co-financé par l’Agence Espagnole de Coopération et de Développe- ment en partenariat avec le Ministère de la Culture capverdien, CulturaMóvel se développe en milieu sco- laire et vise à former les professeurs et les élèves dans la création audiovisuelle. Des ateliers de réalisation à partir de caméras légères, appareils photographiques, téléphones portables ou web cams, ont été organisés avec 990 élèves de 12 à 16 ans. Les courts métrages ré- alisés – pour certains documentaires – ont été présentés au Festival de Courts métrages à Praia. Le projet Cul- tura Móvel est de toute évidence une initiative positive pour la stimulation de l’intérêt porté à l’audiovisuel. Il est nécessaire d’impliquer le milieu scolaire dans la sensibilisation au cinéma. Cependant on ne peut parler ici que d’un projet de sensibilisation et non pas d’un projet de formation. On peut relever quelques autres projets ponctuels de formation comme le cours de trois semaines en produc- tion audiovisuelle organisé à Mindelo par ADECO, l’Association de Défense du Consommateur en 2010. Animée par le journaliste capverdien résidant aux Pays Bas Gui Ramos et ouverte à tous les publics, la forma- tion était centrée sur l’apprentissage du maniement de matériel audiovisuel moderne et de la production d’émissions et de reportages. De nature journalistique plutôt que cinématographique, la formation a cepen- dant été perçue comme positive par son animateur qui souligne un évident potentiel chez les jeunes partici- pants mais déplore un manque de prise en charge sous forme de stages dans des entreprises de communication après la formation.
Ces nouvelles initiatives montrent évidemment une réelle volonté de la part des professionnels. Ce que confirme la création en mars 2012 de l’ACACV, as- sociation du cinéma et de l’audiovisuel au Cap-Vert qui souhaite centrer ses activités en priorité sur la formation. Cependant, pour être réellement efficaces, ces initiatives doivent s’inscrire dans la continuité et la décentralisation. Aucune université capverdienne ne propose un cursus exclusivement consacré à la réali- sation et production de cinéma ou documentaire, la formation universitaire dans ce domaine étant reléguée à de brefs ateliers inclus dans les cursus de journalisme, communication et publicité.