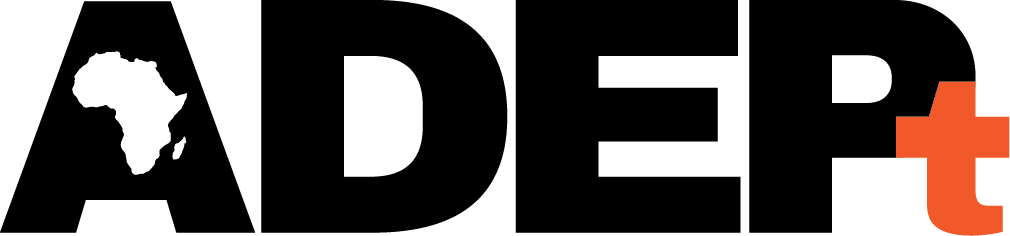Resources
ADFF - Africa Documentary Film Fund
CONTEXTE
Reports
Géographique et démographique
L’Angola est le pays le plus étendu de l’Afrique au sud du Sahara, après la République Démocratique du Congo, avec une superficie de 1 246 700 km2. Peuplé d’environ 18 millions d’habitants, il est composé de 18 provinces, majoritairement rurales, celles situées au sud, à la frontière namibienne, étant même désertiques. Les zones urbaines sont principalement situées sur la côte, à commencer par la capitale Luanda d’environ cinq mil- lions d’habitants et les villes de la province de Benguela : Lobito et Benguela. Huambo fait figure d’exception, située au centre du pays. Ces trois villes sont peuplées de moins de 300 000 habitants. Ces réalités géographiques et démographiques sont évidemment déterminantes pour le développement du septième art, secteur urbain par excellence : les activités cinématographiques sont presque exclusivement concentrées sur Luanda. En re- vanche, l’Angola possède de grandes richesses naturelles (pétrole, gaz, hydroélectricité, mines, diamants, agri- culture, pêche, eau), qui font de lui un pays au potentiel énorme sur le plan économique.
Economique
L’économie angolaise, extrêmement affaiblie par les 27 années de guerre civile dont le pays a souffert, a connu une croissance très rapide entre 2002 et 2008. Après une contraction en 2009-2010, effet de la crise économique mondiale, la relance est effective depuis 2011 sous les influences conjuguées de la forte hausse du prix du baril, du démarrage des exportations de gaz et de la relance des investissements publics. A tel point qu’il pourrait devenir en 2020 la 5ème puissance économique d’Afrique derrière l’Afrique du Sud, le Nigéria, l’Egypte et l’Algérie. Son PIB actuel dépasse les 99 milliards de dollars annuels.
Mais la croissance de l’Angola est largement tribu- taire du secteur pétrolier (40% de son PIB et 96% des exportations), insuffisamment lié à l’économie réelle du pays, employant seulement 1% de la population active. A l’inverse, le secteur primaire qui rapporte seulement 8% des richesses nationales, emploie plus de 85% de la population active.
L’économie angolaise reste donc une économie pauvre et aux structures peu avancées. Le revenu par habitants, même s’il a quintuplé depuis 2004, reste faible (8 par jour) et l’IDH est de 0,486. La moitié de la popula- tion angolaise est au chômage ou sous-employée et la fracture entre pauvres et riches ne cesse d’augmenter. Les avancées constantes de l’Angola sur le plan social depuis 2002 – les dépenses sociales représentaient en 2011 30% du budget de l’Etat – se heurtent à des dif- ficultés colossales pour faire reculer le chômage et la pauvreté. L’espérance de vie est encore très faible et le système éducatif est très insuffisant.
L’Angola est probablement, au vue de son potentiel et de sa croissance économiques, le pays des PALOP po- tentiellement le plus à même de développer une indust- rie cinématographique. Pourtant, au-delà des difficultés pour renforcer le développement humain, la situation politique de l’Angola représente un autre obstacle au développement du cinéma en Angola.
Politique
Après la révision constitutionnelle de 1992, la Répub- lique Populaire d’Angola – régime marxiste léniniste à parti unique – est une république à régime présidentiel multipartite. Cependant, ce multipartisme est assez superficiel. La constitution de 1992 prévoyait l’élection du Président au suffrage universel direct pour cinq ans, ce qui n’a jamais été appliqué. La révision constitution- nelle de 2010 a changé ce mode électoral : la tête de liste du parti remportant l’élection générale est automa- tiquement président, le second devenant vice-président.
Le régime offre au président des pouvoirs énormes –le président actuel étant en outre au pouvoir depuis 33 ans. Il est le chef de l’Etat mais aussi le chef du Gouverne- ment, contrôlant non seulement l’exécutif mais aussi le législatif et le judiciaire. Le législatif est en théorie partagé entre le gouvernement et l’Assemblée Natio- nale. Cette dernière, chargée de voter les lois, consentir l’impôt et contrôler les activités du gouvernement, a en pratique un champ d’action très limité : le président étant tête de liste et leader de son parti, il incarne le chef de la majorité et est la source originelle de la majorité des lois. Dans ce système multipartite l’opposition a un pouvoir minime, et l’indice de démocratie de 3,32 place l’Angola parmi les régimes autoritaires.
Par ailleurs, le président nomme les directeurs des prin- cipales institutions publiques et juridiques, et contrôle les institutions et entreprises clés du pays. Hormis SONANGOL (pétrole) et ENDIAMA (diamant), il contrôle également les médias : la Télévision Publique d’Angola, monopolistique à l’exception de la télévision privée TV Zimbo gérée par sa fille, la Radio Natio- nale d’Angola, la seule radio à couverture nationale et l’unique quotidien, Jornal de Angola, situation forte de sens quant à la véritable liberté d’expression dans le pays.
Dans ce contexte politique, le développement d’un cinéma documentaire – cinéma libre et critique par excellence – résulte difficile.
Cinématographique
Comme dans les autres pays africains lusophones, le cinéma a été considéré comme un important instru- ment de mobilisation idéologique et de communication d’idées au public lors de la lutte de l’Indépendance et dans les premières années de la nouvelle nation. Dès les premiers temps de l’Indépendance, l’Etat fort s’est impliqué très largement dans l’organisation du secteur cinématographique.
En 1976 la nouvelle République Populaire d’Angola inaugure la Télévision Populaire d’Angola, puis en mars 1977 est créé l’IAC (Institut Angolais du Cinéma) et enfin l’année suivante le LNC (Laboratoire National de Cinéma), institutions surgies de la confiscation et de la nationalisation des structures de production de l’époque coloniale, Cinangola, Promocine et Telecine. L’IAC est en charge de la mise en place des politiques à suivre du cinéma angolais alors que le LNC se charge de la production, en particulier de documentaires et du journal d’actualités filmé présentés dans toutes les salles de cinéma du pays. Naît donc à la fin des années 70 une tradition du documentaire qui atteint une grande qual- ité avec les films d’Antonio Ole, des frères Henriques et surtout de Rui Duarte de Carvalho qui confèrent au cinéma angolais une reconnaissance internationale. En 1981 est créée la Cinémathèque d’Angola, rapidement membre de la FIAF. Durant cette période, le cinéma est entièrement subventionné par l’Etat avec des inves- tissements et des objectifs dirigés : transmettre sa vision de la nouvelle nation aux masses.
Cette période de faste est pourtant brève. Dès 1982 on assiste à un grand recul de la production et seules quelques œuvres des cinéastes de la décennie précé- dente voient le jour. Avec le développement de la télévision, la crise économique et la guerre civile, l’Etat se désengage rapidement du secteur au profit de la télévision, plus économique que le cinéma. Le manque de moyens démotive la nouvelle génération de cinéastes et poussent les anciens vers d’autres arts. Les institu- tions mises en place après l’Indépendance disparaissent peu à peu ou voient leurs activités réduites à néant. Par conséquent, la production devient presque inexistante.
Les années 90 marquent une nouvelle étape : dans le cadre de la politique des alliances définie par le gou- vernement, l’Etat décide d’abandonner la distribution et l’exploitation à l’entreprise privée EDECINE qui convertit les salles de cinéma en salles de cabarets plus rentables. Par ailleurs, les investissements des compag- nies privées – craignant de ne jamais les récupérer – dans la production sont quasiment nulles.
Le bilan est qu’à la fin de la guerre civile, en 2002, le secteur cinématographique est dans une situation extrêmement critique. Pour un nouvel essor du cinéma angolais, l’implication de l’Etat dans les mécanismes de financement et la restructuration institutionnelle et juridique est nécessaire. Depuis 2002, il évolue lente- ment dans ce sens.
ADFF - Africa Documentary Film Fund
POLITIQUE NATIONALE ACTUELLE DE SOUTIEN AU CINEMA
Reports
En 2003, le gouvernement inaugure le nouvel Institut Angolais du Cinéma, de l’Audiovisuel et du Multimédia (IACAM), destiné à promouvoir le secteur à tous les niveaux et à coordonner son développement, créant ainsi un nouveau cadre institutionnel. Si le soutien financier de l’IACAM est encore limité aujourd’hui, un effort vient d’être réalisé pour doter le secteur d’un cadre juridique, avec l’approbation le 30 novembre 2011 de la proposi- tion de loi du cinéma et de l’audiovisuel. L’initiative a été motivée en autre par les changements politiques survenus dans la société angolaise et par l’évolution des condi- tionnements propres aux relations internationales, en par- ticulier avec l’Union Africaine, la SADC (Communauté des Pays d’Afrique Australe), la CPLP (Communauté des Pays de Langue Portugaise) et l’Union Européenne / ACP, et par l’innovation technologique.
La loi prévoit donc, outre de réguler le secteur ci- nématographique, de protéger les activités ciné- matographiques et audiovisuelles, et de donner au secteur un cadre juridique indispensable à l’essor de la production, la distribution et l’exploitation ciné- matographiques, de faciliter l’obtention de fonds de coproduction qui exigent l’accomplissement de cer-taines normes. Elle est également destinée à faciliter le développement de l’entreprise dans les domaines ciné- matographique et audiovisuel grâce à la mise en place de mécanismes fiscaux et financiers au bénéfice des entre- prises soutenant le secteur. Le dernier point fondamental est le développement de l’enseignement et des études, des formations professionnelles et de la recherche dans le cadre des activités cinématographiques et audiovisuelles et l’encouragement à des relations institutionnelles et intersectorielles entre les organismes de l’audiovisuel et ceux de l’éducation, de la communication sociale, de l’enseignement supérieur et des sciences et des technolo- gies. Les intentions du gouvernement dans le secteur de la formation visent non seulement l’organisation de formation de professionnels à travers d’ateliers et forma- tions ponctuelles, mais aussi l’introduction de cursus liés à l’audiovisuel dans le système universitaire. Enfin, la loi prévoit l’investissement de l’Etat dans la restauration, la conservation et la valorisation du patrimoine ciné- matographique et audiovisuel.
La création de l’IACAM et l’approbation de la loi du cinéma et de l’audiovisuel prouvent les efforts réalisés pour donner un cadre institutionnel et juridique au secteur. Il faudra maintenant attendre les prochaines années pour voir si sont réellement mis en place des mécanismes financiers qui permettraient à la nouvelle génération de cinéastes de produire dans des conditions décentes des films qui arrivent au public angolais, et au secteur privé de s’impliquer réellement dans ce secteur.
Le gouvernement à travers de l’IACAM a pris égale- ment certaines mesures en ce qui concerne la diffusion, en créant en 2008, le Festival International de Cinéma de Luanda (FIC). Le festival, sur lequel nous revien- drons ultérieurement, cherche à promouvoir le cinéma angolais non seulement par la diffusion des dernières œuvres nationales à chaque édition, mais aussi en ser- vant de cadre à des formations courtes et à des journées professionnelles destinées à stimuler l’industrie ciné- matographique. Par ailleurs, une partie de la program- mation du FIC est rediffusée dans les provinces de Benguela et de Huila, dans un souci de décentraliser les activités de diffusion cinématographique.
Enfin, Pedro Ramalhoso, directeur de l’IACAM, men- tionne dans un article de Jornal de Angola daté du 15 avril 20121 un projet de création d’un centre de produc- tion cinématographique spécialisé en documentaires, sur lequel nous reviendrons ultérieurement.
Cette série de mesures prises par les autorités publiques montre donc une volonté politique évidente d’essor du secteur cinématographique, voire de création d’un véritable marché national de l’audiovisuel et du cinéma. En revanche, cette politique ne semble pas, au contraire du Cap-Vert par exemple, chercher à privilégier la pro- duction documentaire, production généralement plus économique que celle de la fiction.
ADFF - Africa Documentary Film Fund
LE DOCUMENTAIRE ANGOLA
Reports
Production
En Angola, le gouvernement et les professionnels du cinéma ne semblent pas chercher à renouer avec la tradition documentaire des premières années de l’Indépendance. La nouvelle génération de cinéastes est en général plus attirée, à quelques exceptions près, par la fiction ou la série télévisée que par le documentaire.
La production sporadique, donc, compte moins d’une dizaine de longs métrages réalisée lors des six dernières années. On citera :
- OXALA CRESÇAM OS PITANGAS, Kiluanje Liberdade et Ondjaki, 2006
- RAP DO QUINTAL, Mário Bastos, 2007
- TCHIOLI, MASSAS E MITOS, Kiluanje Liberdade et Ines Gonçalves, 2009
- LUANDA, A FABRICA DA MÚSICA, Kiluanje Liberdade et Ines Gonçalves, 2009
- VIAGEM AO KUROCA, Nguxi dos Santos, 2010
- NO TRILHOS CULTURAIS DE ANGOLA CONTEMPORÂNEA, Dias Junior, 2010
Ces films ont tous été réalisés par des cinéastes angolais de la nouvelle génération – appelée la Seconde Généra- tion – et trois sont des productions ou coproductions angolaises.2 Ainsi, quelques jeunes noms se démarquent dans le panorama du documentaire angolais, marqués par une grande détermination et une volonté de faire des films malgré les faibles ressources disponibles.
La figure de proue de ce petit groupe d’indépendants est sans aucun doute Kiluanje Liberdade, impliqué exclusivement dans la réalisation de documentaires. Il est l’un des rares cinéastes angolais actuels à avoir une esthétique et un style propres, suivi de près par le prometteur Sergio Afonso, photographe d’origine récemment formé en cinéma et décidé à se lancer dans la réalisation documentaire. Mário Bastos quant à lui mêle les genres et son travail est axé sur la musique angolaise, le rap en particulier. Ces jeunes cinéastes, tous décidés à créer et donner une nouvelle image de l’Angola au reste du monde et à participer au dével- oppement du secteur, représentent un terreau humain nécessaire à la dynamisation du secteur.
Par ailleurs, quelques sociétés privées de production ont vu le jour et commencé à participer dans des coproduc- tions internationales. C’est le cas de Nguxi de Santos, dont la société Dread Locks a coproduit le film de la portugaise Dulce Fernandes, CARTA DE ANGOLA (2011). La devise de la dynamique société Geraçao 80, résume assez bien l’esprit de cette Seconde Génération : « le monde est en crise, l’argent est de plus en plus difficile d’accès pour certains, et la technologie de plus en plus accessible à tous »3, et témoigne de ce nouveau dynamisme et de cette nécessité de faire avancer la création audiovisuelle en Angola.
La Télévision Populaire Angolaise a participé égale- ment à la production de quelques films réalisés en Angola, comme ceux du Portugais Jorge Antonio sur la musique traditionnelle angolaise. Elle a aussi fait partie du programme Doc-TV CPLP sur lequel nous revien- drons dans un prochain chapitre. Mais de manière gé- nérale, son implication dans la production audiovisuelle nationale reste très ponctuelle et quasi inexistante.
Comme évoqué précédemment, l’IACAM a l’intention de créer prochainement un centre de production ciné- matographique . Cependant, la décision du gouvernement est très orientée : il s’agit d’encourager la production de documentaires illustrant les manifestations culturelles et la croissance des villes, notamment de Luanda.
Déjà en 2010, lors des secondes Rencontres de Créa- tions Audiovisuelles organisées à Luanda, la minis- tre de la culture, Rosa Cruz e Silva, avait témoigné de l’importance de produire des documentaires qui « révèlent de manière artistique les actions du gou- vernement et les paysages naturels du pays, princi- palement les zones inexplorées du point de vue ciné- matographique »4. Même si Ramalhoso précise qu’il s’agit également de créer de l’emploi pour les jeunes récemment formés en audiovisuel, l’objectif est clair. Les démarches du gouvernement tendent vers le con- trôle de la production, vers l’essor d’un documentaire de propagande plutôt que d’un documentaire de créa- tion libre et indépendant.
Diffusion
L’évolution des réseaux de salles angolais ne fait pas figure d’exception dans le panorama de l’exploitation cinématographique africain. Si dans les années 1990, les salles – concentrées presque exclusivement à Lu- anda – étaient au nombre de treize, il n’en reste plus que deux en activité actuellement : le Cinema Atlântico et le Corimba, auquel s’ajoute le complexe de salles Cineplace Belas Shopping inauguré en mars 2007 et qui propose à sa clientèle une programmation de blockbuster hollywoodiens et de films commerciaux internationaux. Le ministère de la culture et l’entreprise Endecine ont annoncé un plan de récupération et de modernisation des anciennes salles de Luanda et de re- vitalisation de la distribution qui nécessite le soutien de la société civile et du secteur cinéma. Son impact sera effectif seulement s’il est accompagné d’une revalorisa- tion du cinéma comme activité culturelle et de loisir et dans le cadre d’un développement humain général.
L’IACAM a créé en 2008 le Festival International de Cinéma de Luanda qui représente actuellement la plus grande opportunité pour les documentaristes angolais (et cinéastes en général) de montrer leurs œuvres dans le pays. Bien qu’il soit international, la programmation réserve une grande place aux cinémas africains actuels et en particu- lier aux films des pays africains lusophones. En 2011, le FIC Luanda présentait trois documentaires angolais (deux courts et un long métrage) et trois documentaires mozambicains en compétition. La direction artistique est d’ailleurs assurée par deux cinéastes de la Seconde Génération, Nguxi dos Santos et Dias Junior. Quant à la direction générale, elle est assurée par le directeur de l’IACAM en personne, Pedro Ramalhoso. Encore une fois, n’existant pas d’autres festivals à l’échelle nationale, cette situation confère à l’Etat un contrôle en solitaire et à tous les niveaux du secteur cinématographique.
Le FIC Luanda représente ainsi la plateforme prin- cipale de rencontres de cinéastes en Angola. Des rencontres professionnelles sont organisées chaque année, invitant des acteurs de l’audiovisuel interna- tional et en particulier de la Communauté de Pays de Langue Portugaise (CPLP), des PALOP et du secteur cinématographique africain en général, dans l’objectif d’échanger sur les différentes stratégies de développe-ment du secteur. Le FIC propose également des ateliers de formation.
L’une des missions de la Télévision Publique Ango- laise consiste à « promouvoir la production nationale de matériel télévisuel et autre audiovisuel, en particu- lier d’auteurs qualifiés dans les domaines de la fiction angolaise et du documentaire ».5 Pourtant, au vu de sa programmation, l’espace réservé à la diffusion de documentaires nationaux ou d’autres pays africains lusophones est très réduite. Les « documentaires » dif- fusés sont principalement des reportages TV, les deux chaînes consacrant également un large temps d’antenne au parti politique au pouvoir. Les programmes de la TPA dépendant directement du gouvernement sont principalement des programmes de propagande qui font l’éloge des actions de ce dernier.
Formation
La formation représente un volet prioritaire pour l’IACAM. Cependant jusqu’à maintenant, seulement quelques menues initiatives ont été mises en place dans ce sens, bien qu’elles soient très insuffisantes. C’est d’ailleurs pourquoi les documentaristes de la Sec-onde Génération se sont formés à l’étranger: Kiluanje Liberdade au Portugal, Mário Bástos aux Etats-Unis et Sergio Afonso au Brésil.
Le festival de Luanda organise chaque année un atelier dont l’objectif est la réalisation d’un court métrage par les participants pendant le festival. En 2009, un atelier de production a été également organisé dans le cadre du FIC Luanda par l’Institut Camoes, en partie pour combler le vide existant en matière de formation en Angola. Animé par le Portugais Marcos Pimentel, il vi- sait la création d’un réseau de coopération audiovisuelle entre les producteurs de langue portugaise, en plus d’offrir une formation aux jeunes réalisateurs d’Angola, Mozambique, Portugal, Brésil et Cap-Vert qui leur permettrait de perfectionner leurs projets en cours.
Par ailleurs, le ministère de la culture a organisé les rencontres de Création audiovisuelle en collaboration avec l’Alliance Française de Luanda. Deux éditions ont eu lieu jusqu’à aujourd’hui, animées par des spécialistes étrangers du secteur de la production et la distribu- tion et chargés d’orienter les réalisateurs sélection- nés à élaborer des projets capables d’attirer des fonds d’institutions étrangères.
L’objectif actuel du ministère de la culture en terme de formation est de constituer un groupe de cinéastes dont la production soit compétitive à l’échelle internationale. Il s’agit donc non seulement de formation continue pour les professionnels nécessitant compléter leurs connais- sances, mais aussi d’intégrer des cursus spécifiques de cinéma et audiovisuel dans les universités. Dans ce sens, le ministère de la culture élabore en ce moment un projet d’Ecole des arts dont le cinéma serait une des filières.
Quoiqu’il en soit, à l’heure actuelle, le secteur de la formation est à l’état embryonnaire et les formations ne sont que très ponctuelles et jamais orientées sur le documentaire en particulier. En revanche, il est évident qu’il représente l’étape primaire et fondamentale pour un possible développement du secteur.